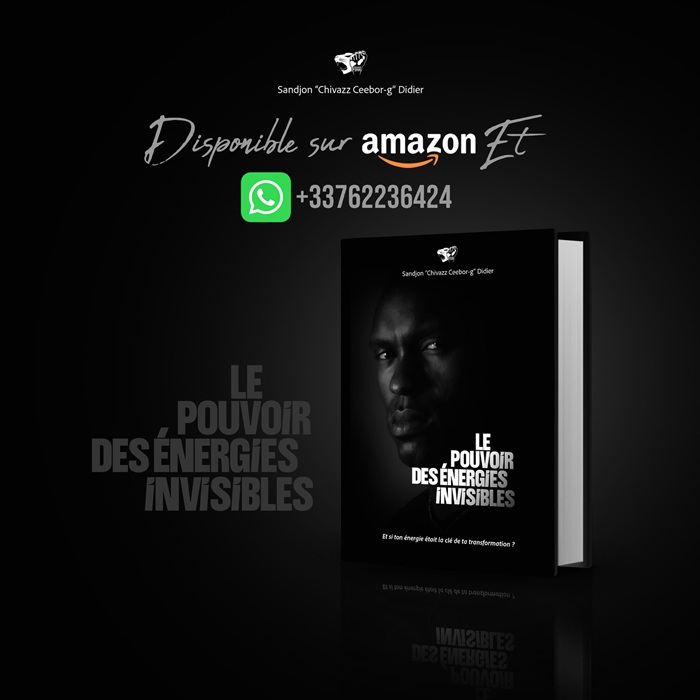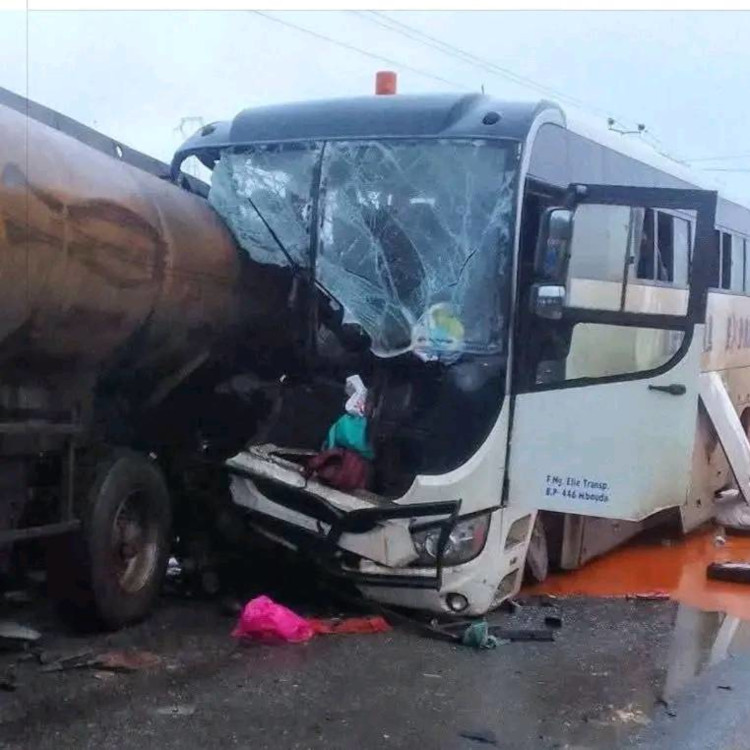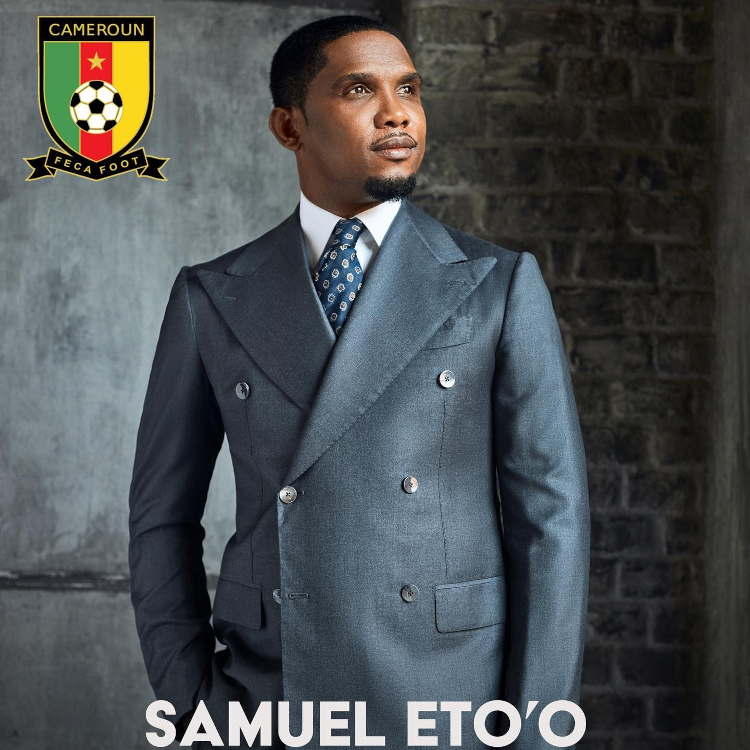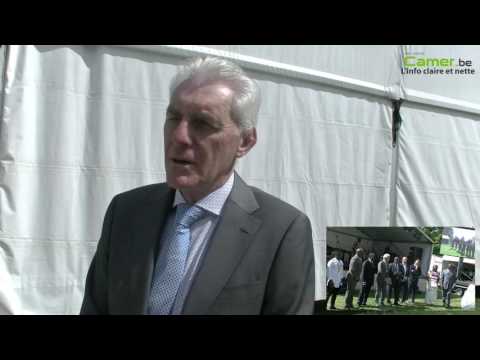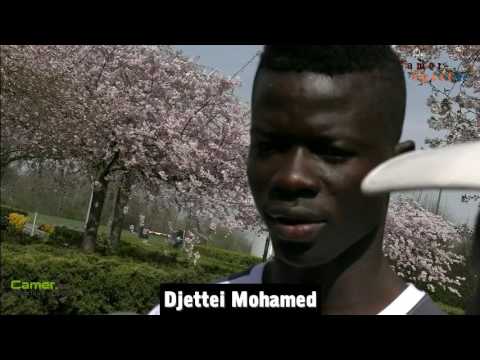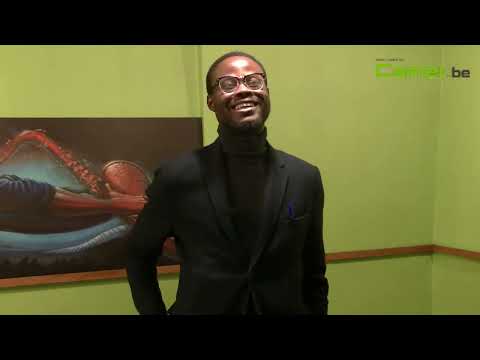-
© Correspondance : Jean Robert WANKO
- 02 Oct 2025 07:53:21
- |
- 3570
- |
Présidentielle du 12 octobre 2025 : Le Cameroun face à ses démons ? Une Analyse :: CAMEROON
Le 12 octobre 2025, le peuple camerounais se rendra aux urnes pour élire son prochain président. Ce scrutin, bien loin d'être un simple exercice démocratique, est un moment de vérité pour la nation, un miroir qui reflète ses blessures, ses espoirs et ses luttes inachevées. Le Cameroun est confronté à lui-même, car derrière l'acte de voter se joue l'avenir d'une jeunesse en quête de dignité et d'opportunités, le sort d'une économie en panne, et la capacité de l'État à relever les défis du XXIe siècle, tels que le changement climatique et la révolution numérique.
Le pays est à bout de souffle, avec plus de 70 % de sa population ayant moins de 35 ans. Marginalisée, cette jeunesse est contrainte à l'exil ou à l'errance sur un marché du travail saturé, où les diplômés peinent à trouver leur place, les talents s'expatrient, et les espoirs s'évanouissent face aux promesses non tenues. L'élection du 12 octobre 2025 ne sera donc pas une simple formalité, mais un véritable tournant, un jugement.
Répression et verrouillage institutionnel
Depuis son indépendance en 1960, le Cameroun n’a connu qu’un seul véritable changement de président : celui d’Ahmadou Ahidjo à Paul Biya en 1982. Ce passage de témoin, loin d’être le fruit d’une dynamique démocratique, a marqué le début d’un régime de pouvoir personnel, où l’État s’est progressivement confondu avec la figure du président.
Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun, a rapidement instauré un régime de parti unique, consolidant un pouvoir centralisé et répressif. Les mouvements indépendantistes furent brutalement écrasés, leurs leaders traqués, emprisonnés ou assassinés. Cette répression a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire nationale, nourrissant une culture politique de la peur et du silence.
Après son accession au pouvoir en 1982, l'arrivée de Paul Biya ne fut pas une rupture avec le passé, mais plutôt une consolidation et une intensification de la concentration du pouvoir. La tentative de coup d'État de 1984, menée par des partisans de l'ancien président Ahmadou Ahidjo, a servi de catalyseur. Cet événement a renforcé la paranoïa du nouveau régime et a fourni le prétexte idéal pour une purge massive de l'armée et de l'administration. À la suite de cette crise, le régime s'est considérablement durci, réduisant les libertés publiques et étouffant toute forme d'opposition. La peur s'est installée, et le culte de la personnalité du président s'est imposé, devenant un pilier de la gouvernance. Cette période a ainsi scellé la transition d'une succession de pouvoir à l'établissement d'un régime autoritaire, marquant durablement la vie politique camerounaise.
Le multipartisme sous surveillance
En 1990, sous la pression croissante de la communauté internationale et des mouvements populaires internes, le régime de Paul Biya cède à une exigence fondamentale : la réintroduction du multipartisme. Ce tournant, présenté comme une avancée démocratique, est en réalité une manœuvre stratégique. Le lancement du Social Democratic Front (SDF) par John Fru Ndi à Bamenda, le 26 mai 1990, est marqué par une répression sanglante : six manifestants pacifiques sont tués par les forces de l’ordre. Ce jour devient un symbole du prix à payer pour la liberté politique.
Les premières élections pluralistes de 1992 suscitent un immense espoir. Le SDF, fort d’un soutien populaire, semble en position de remporter la présidentielle. Pourtant, malgré des résultats serrés et des soupçons de fraude électorale, Paul Biya est déclaré vainqueur. Des observateurs internationaux dénoncent des irrégularités massives, mais le pouvoir reste sourd. L’alternance est avortée, et le multipartisme devient un décor sans profondeur.
Au fil des décennies, les institutions démocratiques sont progressivement vidées de leur substance. Le parlement devient une chambre d’enregistrement, la justice perd son indépendance, et les médias critiques sont harcelés. Les partis d’opposition, bien que nombreux (plus de 300 officiellement), sont fragmentés, infiltrés ou marginalisés.
L’arrestation de Maurice Kamto en janvier 2019, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle, illustre cette dérive autoritaire. Sa détention arbitraire pendant plusieurs mois, sans jugement, provoque une vague d’indignation internationale, mais ne freine pas la répression.
Le Cameroun vit ainsi sous un régime hybride : officiellement démocratique, mais pratiquant un autoritarisme déguisé. Les élections sont organisées, mais sans réelle compétition. Les opposants sont tolérés, mais surveillés. Le multipartisme existe, mais l’alternance est verrouillée.
L'urgence d'une rupture face à un modèle en faillite
Le Cameroun est une nation portée par une jeunesse vibrante, mais confrontée à un paradoxe déchirant : son avenir est confisqué par un passé politique qui s’accroche et refuse de céder la place. La jeunesse camerounaise aspire à une rupture radicale et à des réformes fondamentales. Elle réclame une justice équitable, une gouvernance transparente, et surtout, des opportunités économiques réelles, afin de s'épanouir sans être contrainte à l'exil.
Cependant, ce désir de changement se heurte à un système qui a perfectionné l'art de la répression, utilisant la peur et la résignation comme outils de contrôle. Les arrestations arbitraires, la surveillance numérique et la manipulation des médias ont érigé un mur de peur, mais la voix de la jeunesse continue de résonner, car elle sait que son avenir ne peut être construit sur les fondations d'un passé qui a déjà échoué.
Le modèle centralisé a révélé ses limites avec la crise anglophone de 2016. Né de revendications légitimes de la marginalisation linguistique et administrative, ce conflit s'est transformé en guerre larvée. La réponse militaire et répressive du pouvoir a entraîné des milliers de morts, des déplacements massifs et une radicalisation des positions, plongeant le pays dans une instabilité chronique.
Ces politiques ont eu de lourdes conséquences, fragilisant l'économie par l'incertitude politique et les tensions internes, ce qui a découragé les investissements et aggravé le chômage et les inégalités régionales. Face à cette situation, une partie de la jeunesse, désabusée par l'absence de perspectives, s'est tournée vers l'exil, l'économie informelle ou la contestation.
Selon l'intellectuel Achille Mbembe, le Cameroun est devenu « un État postcolonial qui a intériorisé les logiques de domination » : un système où la verticalité du pouvoir écrase la pluralité, où la souveraineté populaire est confisquée, et où l’avenir semble suspendu à une volonté présidentielle quasi monarchique.
Le miroir africain : des ruptures possibles
Contrairement à l'idée reçue, l'alternance politique en Afrique n'est pas un mirage. De nombreux pays, même dans des contextes complexes, ont prouvé qu'il est possible de rompre avec le statu quo. Ces expériences montrent que le changement est réalisable lorsque les citoyens se mobilisent et que les institutions restent solides.
Le Ghana est un modèle de stabilité démocratique avec plusieurs alternances pacifiques depuis 2000. Le Bénin (2016) et la Gambie (2016), avec la chute de Yahya Jammeh après 22 ans de règne, illustrent également un renouvellement politique significatif. Le Kenya a connu une alternance majeure en 2002 avec l'élection de Mwai Kibaki, suivie par la victoire de William Ruto en 2022. La Tanzanie a également connu une transition de pouvoir apaisée en 2015. Malgré la tendance à l'autoritarisme en Afrique centrale, des signes d'alternance sont apparus. En RDC, la victoire de Félix Tshisekedi en 2018 a marqué la première transition pacifique de pouvoir depuis l'indépendance, malgré les controverses. La Zambie (2021) et le Malawi (2020) ont démontré leur dynamisme démocratique avec des alternances pacifiques. En Afrique du Sud, le renouvellement des élites au sein du parti au pouvoir (ANC) entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa a également illustré un changement de leadership.
Ces exemples, fruits de la mobilisation citoyenne et de la pression institutionnelle, prouvent que l'alternance est une exigence démocratique et non un luxe. Comme l'a souligné le politologue Babacar Justin Ndiaye, l'alternance est "le vaccin contre la dictature chronique".
Les voix critiques du pouvoir en Afrique
Un courant de pensée critique, porté par des intellectuels et des activistes souvent marginalisés, s'est élevé sur le continent africain pour dénoncer la stagnation, l'autoritarisme persistant et les démocraties de façade. Leurs analyses, fondées sur une observation fine des réalités politiques et sociales, appellent à une lucidité collective et à une réinvention du politique, encourageant les citoyens à se réapproprier leur destin.
Le dramaturge et philosophe togolais Kossi Efoui dénonce une « démocratie sans démocrates », une formule qui s'applique cruellement au Cameroun. Les institutions démocratiques y sont présentes en apparence, mais vidées de leur substance, ce qui se manifeste par des élections sans réelle compétition, la neutralisation des contre-pouvoirs et une alternance politique qui demeure un mirage.
Le prêtre et sociologue camerounais Jean-Marc Ela appelait, quant à lui, à une « insurrection de la conscience » contre les régimes qui confisquent l’avenir. Dans ses ouvrages, il dénonçait la pauvreté, la répression et l'aliénation intellectuelle comme les symptômes d'un pouvoir qui refuse la participation populaire. Son appel à la conscience est plus que jamais d'actualité dans un pays où la jeunesse est désabusée, les élites sont figées et les voix critiques sont muselées.
Le philosophe camerounais Achille Mbembe affirme que « l’Afrique ne manque pas de ressources, elle manque de liberté ». Selon lui, le problème n’est pas l'absence de richesses, mais l’incapacité des régimes à garantir les libertés fondamentales. Il qualifie les quarante-trois ans de règne de Paul Biya d’« ère de captivité », marquée par la répression et l'absence de perspectives, insistant sur le fait que la liberté ne viendra que d'un soulèvement pacifique des consciences.
Conséquences et perspectives
Ces analyses mettent en lumière une crise de confiance généralisée, où la manipulation des institutions et la répression ont engendré une méfiance profonde envers l'État. La stagnation politique qui en résulte bloque le renouvellement des élites, créant un fossé grandissant entre une classe dirigeante vieillissante et une jeunesse dynamique, mais marginalisée. Ce verrouillage du système empêche l'émergence de nouvelles idées et de leaders.
De plus, l'absence de dialogue national et la gestion autoritaire des crises, comme la crise anglophone, ont conduit à une fragmentation sociale et à une crise identitaire. Le sentiment d'appartenance à une nation commune s'effrite au profit de replis communautaires. Ce désengagement se traduit également par une fuite des cerveaux, les jeunes diplômés préférant l'exil à la paralysie politique et économique. Finalement, cette stagnation se traduit par une paralysie économique, car sans liberté politique, il n'y a ni transparence, ni justice, ni climat propice à l'innovation, à l'investissement et à une prospérité partagée.
Paul Biya et l’énigme d’un pouvoir sans fin
À 92 ans et au pouvoir depuis 1982, le président Paul Biya incarne une longévité politique exceptionnelle, soulevant la question de la capacité du Cameroun à se réinventer sous un leadership inchangé depuis plus de quatre décennies. Loin d'être une simple formalité, la prochaine échéance électorale pourrait être un véritable tournant, interrogeant le contrat social rompu entre l'État et ses citoyens.
Le régime a instauré une stabilité apparente par un verrouillage autoritaire : une concentration des pouvoirs, un affaiblissement du Parlement et une instrumentalisation de la justice ont étouffé les contre-pouvoirs. La démocratie est restée un idéal de façade, les élections étant entachées de fraudes massives et l'alternance politique un mirage.
Sur le plan économique, la croissance n'a pas résolu les inégalités sociales criantes. Le chômage des jeunes est élevé, l'accès aux services de base reste limité, et la corruption entrave le développement. La crise anglophone, avec son conflit meurtrier depuis 2016, est la conséquence d'une réponse militaire disproportionnée à des revendications légitimes. Cette fracture met en évidence l'incapacité du régime à dialoguer avec sa propre diversité et à offrir un avenir commun à tous les Camerounais.
Pour un nouveau Cameroun : l’appel à voter, veiller et résister
Le changement que le Cameroun appelle de ses vœux ne se résume pas à l'acte de voter. Il ne viendra pas uniquement des urnes, mais d'une mobilisation citoyenne profonde et durable. Il s'agit de transformer la passivité en action, la frustration en stratégie, et l'indignation en un projet de société audacieux.
Voter ne suffit plus. Le défi du renouveau exige une vigilance constante. Il est impératif non seulement de glisser son bulletin dans l'urne, mais aussi de veiller à la transparence du processus électoral, de documenter les irrégularités et de dénoncer chaque tentative de fraude. C'est en s'exprimant collectivement que les citoyens pourront s'organiser pour résister aux intimidations et aux menaces qui visent à étouffer la voix du peuple.
Refuser la manipulation est un acte de résistance, mais il doit être suivi par la construction d'une alternative crédible. Il ne s'agit plus de se contenter de rejeter le statu quo, mais de proposer une vision d'avenir claire et audacieuse pour le Cameroun, une vision qui rompe avec les vieilles logiques et qui réhabilite le contrat social entre l'État et ses citoyens.
Le Cameroun est à la croisée des chemins. Le prochain scrutin est bien plus qu'une simple élection : il pourrait être un tournant historique ou une répétition tragique. L'avenir dépendra de la capacité des citoyens à transformer leur indignation en une force d'action inarrêtable.
Refonder la République ou reconduire l’impasse ?
Le Cameroun est à l'heure d'un choix historique. Le scrutin du 12 octobre 2025 ne doit pas être une simple formalité électorale, mais un véritable acte de refondation nationale. Après plus de quatre décennies de pouvoir sans alternance, il ne s'agit plus de changer un président, mais de réinventer la République elle-même.
Le pays est miné par l'usure du pouvoir, la confiscation des institutions et la marginalisation de ses forces vives. La jeunesse, les femmes, les artistes, les intellectuels, la société civile et la diaspora ne peuvent rester les spectateurs d'un cycle qui se répète sans fin. Ils doivent devenir les acteurs d'une rupture démocratique, d'un sursaut collectif capable de transformer le désespoir en espoir, l'indignation en action.
La politique ne peut plus se réduire à la gestion du statu quo. Elle doit retrouver son sens, redevenir un espace de débat constructif et de projet collectif. Le 12 octobre 2025 doit marquer la fin de la résignation et le début d'une nouvelle ère, fondée sur les piliers de la justice, de la transparence et de la dignité citoyenne.
Mobiliser, voter, veiller, résister : voilà les impératifs d'un renouveau. Comme le disait Thomas Sankara, « l'esclave qui ne se révolte pas mérite son sort ». Le Cameroun mérite mieux que le silence et la soumission. Il mérite une insurrection des consciences, une révolte pacifique, mais déterminée, pour reprendre en main son destin et construire un avenir digne de ses aspirations.
Jean Robert WANKO
237-Scoailists & Democrats
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Cameroun : la paralysie politique, symptôme d'une démocratie en crise ?
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
POUR UN DEVOIR D’EQUITE
Le Nigéria et le Maroc ont rendez-vous en demi-finale
POINT DE VUE :: les + lus





Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 106101
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 222624

Vidéo de la semaine
évènement