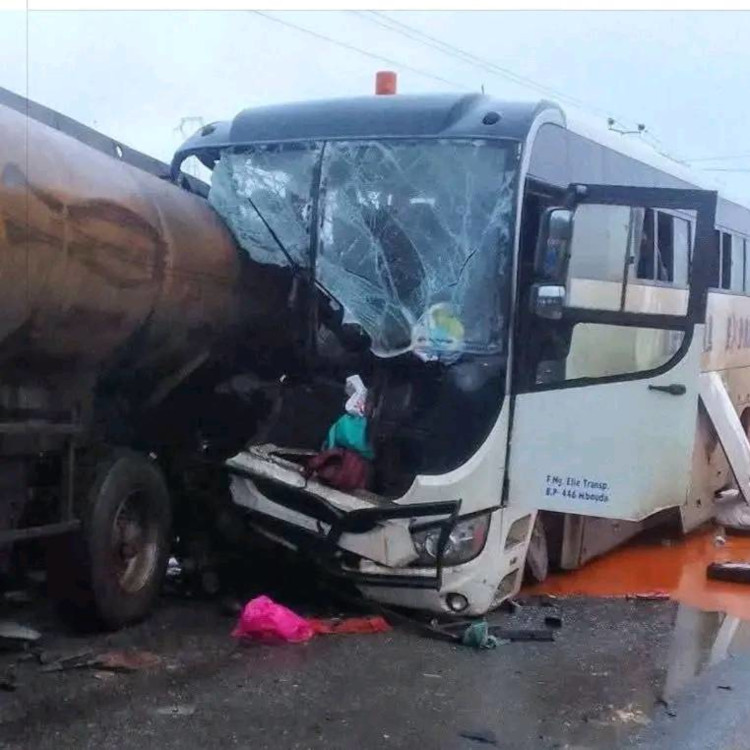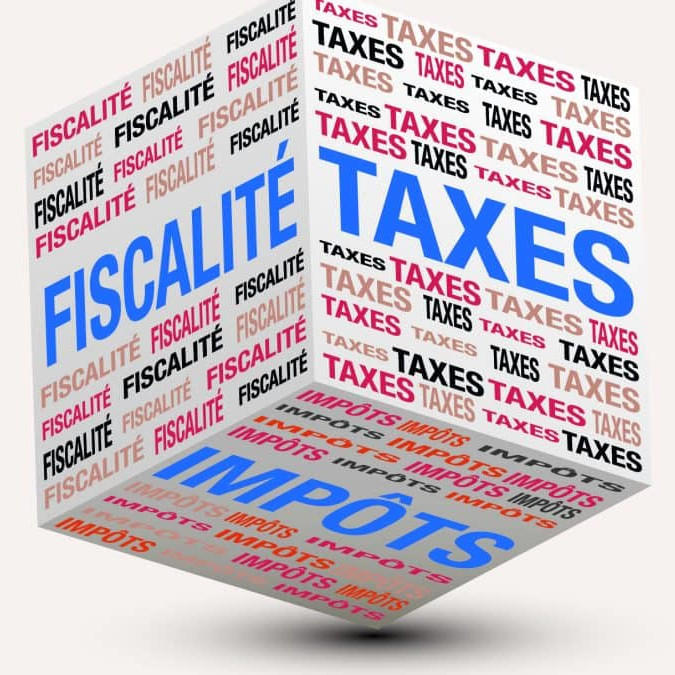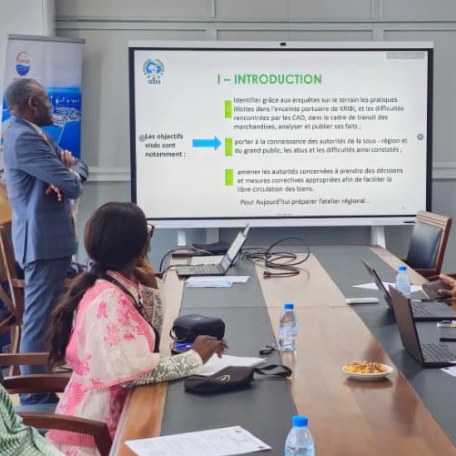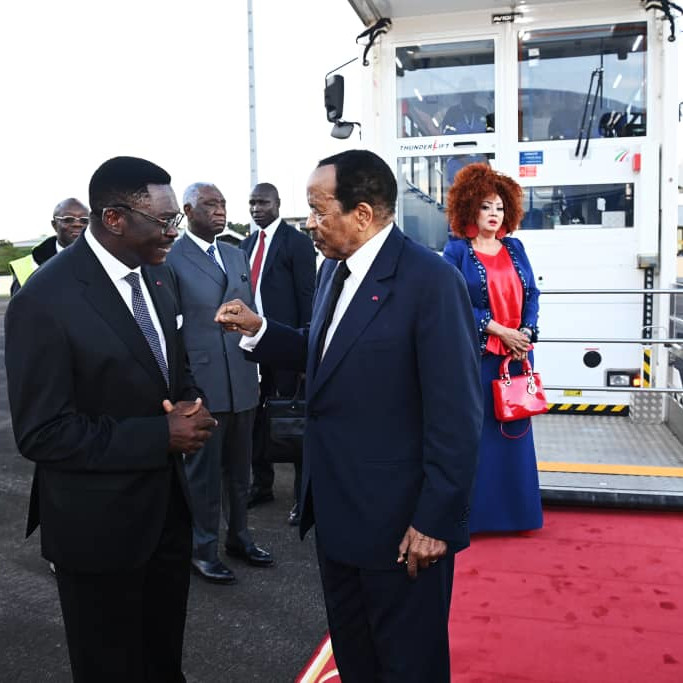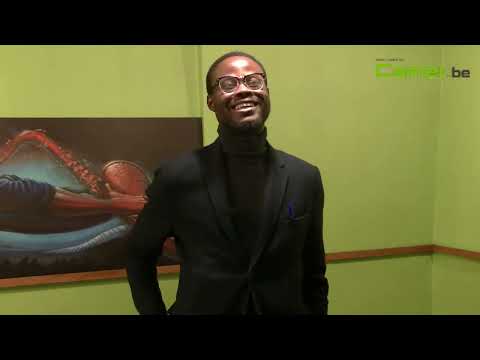-
© Correspondance : Bernard Tchami
- 21 Oct 2025 13:48:24
- |
- 2217
- |
CAMEROUN :: Les crises électorales en Afrique :: CAMEROON
Les contestations des élections présidentielles ne sont-elles pas dues, à l’héritage colonial que traîne le continent ?
Après une soixantaine années d’exercice sans discontinuité majeure, l’élection, dispositif hérité des dernières décennies de la colonisation, puis imposé de l’extérieur comme une conditionnalité des aides occidentales, est devenue la modalité centrale du jeu politique en Afrique.
Cet article, veut porter un regard critique sur le processus démocratique amorcé en Afrique depuis 1990, particulièrement les élections qui constituent la pierre angulaire de ce renouveau politique. Avant, les batailles électorales ne créaient pas d`engouement. Pierre Jacquemot dans son livre intitulé « Trente ans D’ÉLECTIONS EN AFRIQUE BILAN ET DÉFIS NOUVEAUX » est assez illustratif là-dessus et fait une étude comparative avant de revenir sur les causes des crises post-électorales
Mais avec le retour du multipartisme qui favorise l`existence de plusieurs partis politiques, elles deviennent un enjeu pour tout le monde. Est-ce pour cela que les élections entraînent de plus en plus des affrontements souvent meurtriers ? Partout en Afrique le spectacle est triste, mettant à
mal l`évolution démocratique.
Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple devient de ce fait cauchemardesque pour les populations africaines qui, désabusées, commencent à regretter l’époque du monopartisme
.
Les Causes des Crises Électorales En Afrique
Avant d’aborder les origines des crises électorales en Afrique, il nous est important de les présenter. Elles font partie de ce qu`on appelle violence politique. Elle « appartient à la catégorie des conflits anarchiques et destructives, destinés à atteindre un but politique, comme paramètre de la stratégie.» La violence électorale vise le contrôle du pouvoir étatique par l`usage de la force.
Leurs causes sont à la fois internes et externes. Toutefois dans cette partie, nous allons mettre l`accent sur les causes propres aux africains. Car, il ne sert à rien de jeter la caillou aux autres. Certes, on connaît les effets des causes exogènes dans le déclenchement des crises électorales, mais nous avons choisi de nous appesantir sur les causes internes.
Les causes ; endogènes les plus déterminantes
Elles sont nombreuses et sont les plus déterminantes. Toutefois, nous allons énumérer celles qui, à notre sens, semblent pertinentes. Ce sont : l`inculture démocratique des africains, l`attrait du pouvoir chez l`africain et la lutte pour le contrôle des structures en charge des élections.
L`inculture démocratique des africains
Les crises post-électorales en Afrique sont dues en partie au manque d`éducation démocratique des populations qui a pour nom une méconnaissance des règles démocratiques : la liberté de presse et de l’information, l’existence de l’alternance véritable
du pouvoir, le respect de la Constitution, l’existence de plusieurs partis politiques aux idéologies différentes et qui luttent sainement pour la conquête du pouvoir, la séparation réelle de l’exécutif d’avec le législatif et le judicaire, le respect de la dignité humaine, la liberté de travail…
Cette méconnaissance des règles de la démocratie est observée.
Pour cerner cette situation conflictuelle qui inquiète de plus en plus les africains et la Communauté internationale, il nous a paru nécessaire qu’entre 1990 et 2020, près de six cents élections présidentielles et législatives ont été organisées sur le continent africain. Tous les États y tiennent périodiquement des scrutins à l’échelle nationale, régionale ou locale. Un seul pays ne vote pas, et s’apparente à une dictature : l’Érythrée.
Pierre Jacquemot affirme qu’ « après trente années d’exercice sans discontinuité majeure, l’élection, dispositif hérité des dernières décennies de la colonisation, puis imposé de l’extérieur comme une conditionnalité des aides occidentales, est devenue la modalité centrale du jeu politique en Afrique ».
Mimétique à ses débuts, la démocratie électorale issue du scrutin pluraliste est désormais une réalité incontournable, issue de trajectoires souvent singulières, hybride dans ses modalités de fonctionnement, diluée dans le « système socioculturel africain». Elle fait sens au regard des logiques sociales de la négociation et de la répartition du pouvoir, de ses privilèges et de ses rentes.
Pourtant, on observe que la qualité des processus électoraux demeure douteuse dans de nombreux pays, où ils sont sources d’instabilité, de division et parfois de violence. La recevabilité des élus n’est pas telle que les citoyens se retrouvent dans les choix de société qui sont faits. La « fatigue du vote», perceptible depuis le début de la décennie 2010, révèle les limites des modes classiques de représentation.
En 2020, alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a interpellé les États dans leur capacité à satisfaire la demande sociale, nombreux sont ceux qui voudraient puiser dans le réservoir
des pratiques issues des mouvements citoyens ou s’en inspirer afin d’accompagner la grande transition économique et politique qui pourrait s’annoncer
Entre 1990 et 2020, près de six cents élections présidentielles et législatives ont été organisées sur le continent africain. Tous les États y tiennent périodiquement des scrutins à l’échelle nationale, régionale ou locale. Un seul pays ne vote pas, unedictature : l’Érythrée.
Après trente années d’exercice sans discontinuité majeure, l’élection, dispositif hérité des dernières décennies de la colonisation, puis imposé de l’extérieur comme une conditionnalité des aides occidentales, est devenue la modalité centrale du jeu politique en Afrique.
Mimétique à ses débuts, la démocratie électorale issue du scrutin pluraliste est désormais une réalité incontournable, issue de trajectoires souvent singulières, hybrides dans ses modalités de fonctionnement, diluée dans le « système socioculturel africain». Elle fait sens au regard des logiques sociales de la négociation et de la répartition du pouvoir, de ses privilèges et de ses rentes.
Pourtant, on observe que la qualité des processus électoraux demeure douteuse dans de nombreux pays, où ils sont sources d’instabilité, de division et parfois de violence. La redevabilité des élus n’est pas telle que les citoyens se retrouvent dans les choix de société qui sont faits. La « fatigue du vote», perceptible depuis le début de la décennie 2010, révèle les limites des modes classiques de représentation.
En 2020, alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a interpellé les États dans leur capacité à satisfaire la demande sociale, nombreux sont ceux qui voudraient puiser dans le réservoir des pratiques issues des mouvements citoyens ou s’en inspirer afin d’accompagner la grande transition économique et politique qui pourrait s’annoncer.
A titre de rappel, entre février 1990 et août 1991, le Bénin, qui fut pionnier en ce domaine, puis le Gabon, la République démocratique du Congo, le Mali, le Togo, le Niger et le Zaïre organisèrent des conférences nationales sous la pression des forces pro démocratiques. Au même moment, des demandes identiques émergèrent en Mauritanie, en République centrafricaine, au Cameroun, à Madagascar, au Burkina Faso et plus tard au Tchad, avec des résultats variés.
L’éclosion d’institutions
Ces conférences furent un moment d’insoumission, offrant un espace public à la libre expression. Leurs animateurs souhaitaient l’éclosion d’institutions génératrices d’une nouvelle distribution des pouvoirs. Le débat public devint plus vivace parmi diverses associations en pleine efflorescence.
Les conférences nationales eurent un impact non négligeable puisque le nombre de régimes de parti unique dans la région, tomba de vingt-neuf en 1989 à trois en 1994.
Des conditionnalités intéressées
Le déverrouillage démocratique fut soutenu par des prises de position étrangères. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France annoncèrent une conditionnalité de leur aide aux pays africains, associée aux progrès dans le respect des droits humains. Mais il serait erroné d’accorder un rôle déterminant aux injonctions extérieures (comme celle du discours de La Baule de François Mitterrand, le 20 juin 1990). Les avancées démocratiques furent avant tout la conséquence d’un élan local, fait de succès souvent obtenus dans le combat politique.
Cent quatre-vingt-douze élections présidentielles et législatives, précise Pierre Jacquemot, furent organisées durant la décennie 1990-2000 au sein de quarante-cinq pays. « Dans certains cas, on assista à l’entrée en scène de nouveaux dirigeants et à l’éviction d’autocrates (Mobutu Ses Seko au Zaïre, Didier Ratsiraka à Madagascar, Haïlé Mariam Mengistu en Éthiopie) », ajoute-t-il.
Ailleurs, les élections offrirent l’opportunité à d’anciens partis uniques de se« recycler» sous un vernis démocratique en bénéficiant de la légitimité conférée par le suffrage universel. Il est vrai que le juge constitutionnel se montra souvent « complice d’une démocratie électorale émasculée conçue au profit d’un pouvoir manifestement nostalgique de l’époque du parti unique ». D’anciens putschistes en profitèrent pour sanctifier par les urnes leur volonté manifestement prononcée.
En parcourant le livre de Pierre Jacquemot, on note que sur les quatre-vingt-onze chefs d’État qui exercèrent le pouvoir de 1989 à 2014 dans un pays africain, 45% avaient eu une expérience significative au sein de l’armée ou dans des groupes rebelles. Certains gouvernants saisirent l’occasion du vote pour instrumentaliser la situation afin de mettre en place ce que l’on a appelé au Zaïre le « multi mobutisme », un système où chacun trouve son compte, Il est confortable de penser qu’à chaque élection il y a un apprentissage quelquefois aboulique, parfois tumultueux, mais souvent concluant de la démocratie, via l’adoption de règles plus équitables et une progression dans la société
Rôle de la société civile
Depuis le début des années 2010, les conquêtes politiques – en Tunisie, en Algérie, au Burkina Faso, en Éthiopie, au Soudan, par exemple –, même si elles ont été obtenues de manière périlleuse et dans la douleur, auguraient d’un renforcement démocratique au travers d’une maîtrise croissante du jeu institutionnel. De telles avancées ne résulteront pas de la pression de la communauté internationale. Déjà, elles viennent de celle de la société civile, des mouvements citoyens qui s’y constituent et du contrôle vigilant qu’elle exerce, efficacement relayés par les réseaux sociaux. La tendance est désormais à la quête d’institutions fortes plutôt que d’hommes forts, ce qui renforce le sentiment d’appartenance à une communauté de destin.
Agissant peu à peu comme un contrepoids aux divisions ethniques, cette tendance est particulièrement forte au sein d’une jeunesse de plus en plus éduquée, connectée, et qui représente la majorité de la population. Si la marge de manœuvre âprement conquise est suffisamment large, alors le jeu politique progressera.
Au Cameroun, rien n’empêche de penser que les mutations en cours engagés par le gouvernement de la République, pleines de sens, déboucheront sur l’émergence d’un autre modèle assis sur des fondements solides, sur des démocraties de substance et non des démocraties de façade.
Les forces de chargement
La certitude de certains groupes d’appartenir aux forces du changement pourrait peu à peu prendre la place de l’anxiété existentielle. De nombreux intellectuels africains ont saisi l’opportunité qu’a constituée de 2020 afin d’exhorter l’imagination créatrice nécessaire pour trouver des solutions à la hauteur d’une nouvelle situation exceptionnelle, soixante ans après celle des indépendances, trente ans après celle des conférences nationales. Ils répondent ainsi à l’injonction de sortir du « mimétisme» formulée par l’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo,
En somme, on note que les violences électorales sont récurrentes en Afrique depuis le retour du pluralisme en 1990. Cette situation qui est due à plusieurs facteurs se présente de plus en plus comme un désastre pour le processus démocratique amorcé depuis 1990. Ainsi, à l`annonce d`un processus électoral dans un pays africain, l`on s`attend au pire.
A telle enseigne que la communauté internationale, comme moyen de prévention,joue les bons offices entre pouvoir et opposition sans empêcher pour autant les crises électorales qui font désormais partie du paysage électoral du continent. Cette situation qui est due à plusieurs facteurs, se présente de plus en plus comme une limite pour le
processus démocratique amorcé depuis 1990.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Le Maire AYAMBA Jacques d'Eyumojock, Enlevé par les Ambazoniens, la Comocodi félicite sa libération
Muea sous les balles : une femme tuée dans une attaque ciblée en région Sud-Ouest
POLITIQUE :: les + lus

.jpg)
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 113280

Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103596


Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82879
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 222624

Vidéo de la semaine
évènement