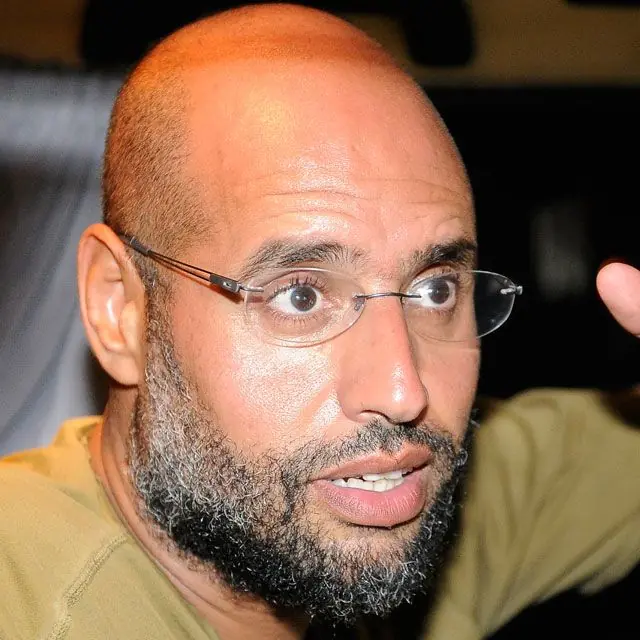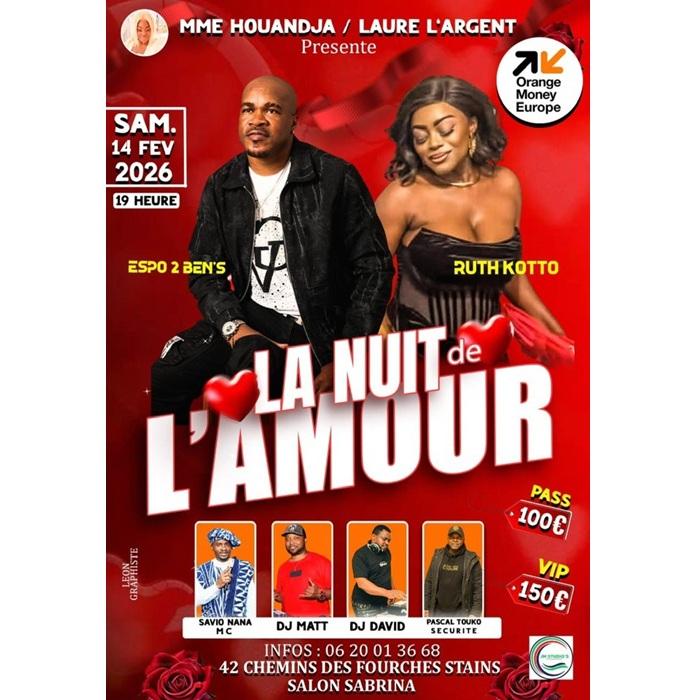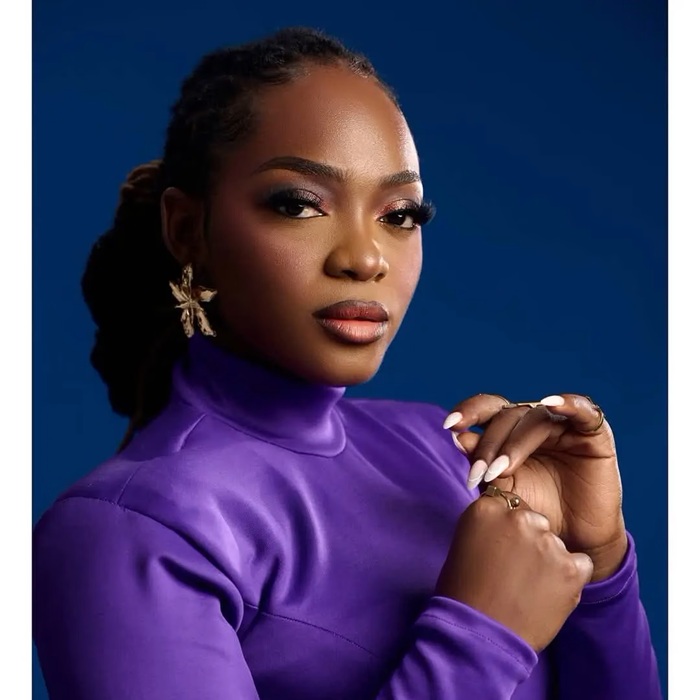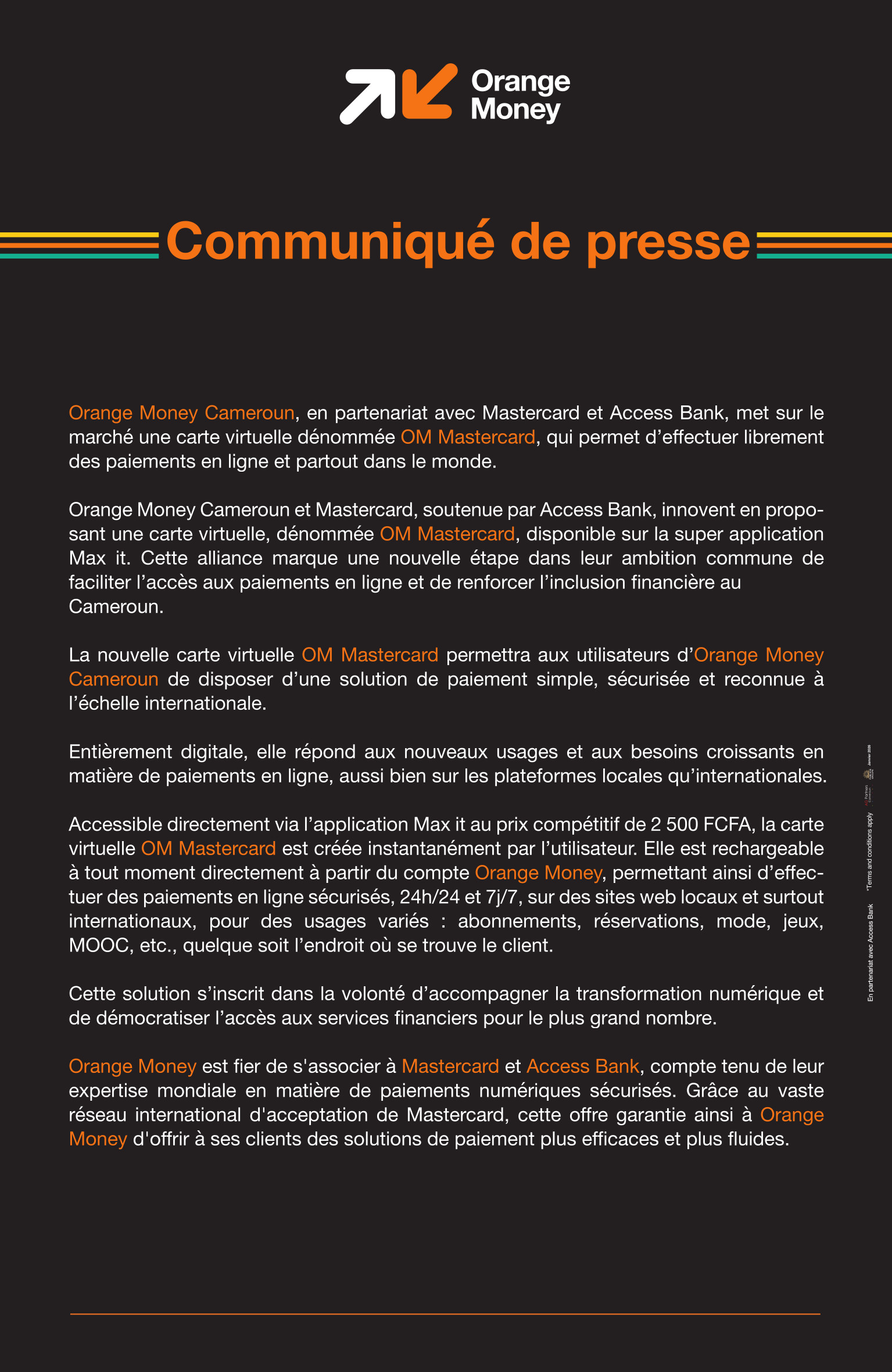-
© Correspondance : Alex SIEWE
- 21 Oct 2025 13:31:07
- |
- 2251
- |
élection présidentielle du 12 octobre 2025 au cameroun :: CAMEROON
L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun n'a pas été une élection comme les autres. Elle a marqué un tournant décisif dans la manière dont la vérité électorale se construit, se conteste et s'impose dans l'espace public africain. Dans un pays où Paul Biya brigue un nouveau mandat à 92 ans, la séquence post-électorale a révélé une mutation profonde des stratégies de communication politique, où les récits traditionnels s'effacent devant l'empire des preuves vérifiables.
Le dispositif du calme : une chorégraphie bien huilée… mais à crédibilité décroissante avec la République comme metteur en scène
Dès le lendemain du scrutin, le gouvernement a orchestré une communication d'une stabilité millimétrée. Le communiqué du ministre de la Communication René Sadi, daté du 15 octobre, a posé un principe simple mais puissant : seul le Conseil constitutionnel détient la légitimité de proclamer les résultats. Cette stratégie, classique dans les régimes institutionnellement verrouillés, transforme la procédure en preuve et la légalité en vérité absolue.
À cette légalité de façade s’ajoute une stratégie du tempo. Le Conseil constitutionnel fixe l’audience du contentieux au 22 octobre, comme pour donner l’image d’un État confiant et en contrôle. L’effet recherché : épuiser la fièvre par la lenteur administrative. Le Cameroun n’est pas le premier à jouer cette carte : au Kenya en 2017, Uhuru Kenyatta avait lui aussi misé sur le calendrier judiciaire pour éteindre la colère des rues. Le pouvoir camerounais applique la même recette : “Respectons les formes, le fond s’épuisera.”
Mais la lenteur procédurale n’est qu’une moitié du plan. L’autre moitié, c’est la dissuasion douce : préfets et gouverneurs convoquent les “chefs de communautés” à des “séances de travail”, en apparence anodines, en réalité destinées à resserrer le contrôle social. À Edéa, le préfet réunit les leaders Bamiléké, du Grand Nord et anglophones. Message subliminal : “On vous tient à l’œil, mais dans la paix.”. Le pouvoir ne veut pas des manifestants, il veut des messagers communautaires du calme.
Mis bout à bout, ces messages dessinent une architecture de stabilisation politique :
- le gouvernement impose le cadre légal,
- les préfets neutralisent les tensions locales,
- le Conseil constitutionnel scelle le récit,
- l’opposition modérée fournit la caution démocratique,
- l’Église rappelle que la paix sans vérité n’est qu’un silence.
Le tout compose une chorégraphie du contrôle, presque parfaite dans sa coordination. Mais comme toute mise en scène, elle souffre d’un risque : l’écart entre la performance et la perception.
Car si la paix est perçue comme un couvercle plutôt qu’un accord, elle explose tôt ou tard. C’est ce qu’a vécu le Sénégal en 2021, quand la “paix imposée” autour du régime Macky Sall s’est fissurée sous la pression d’une jeunesse désabusée. Le Cameroun n’en est pas là, mais la tension générationnelle silencieuse, connectée, numérique s’épaissit.
L'attribution de 53,66% des voix à Paul Biya par la Commission nationale de recensement des votes, annoncée dans la presse proche du pouvoir, s'inscrit dans cette logique : l'institution crée la réalité politique. Le Conseil constitutionnel va parachever la mise en scène d'un État calme, procédural et sûr de lui.
En s'accrochant exclusivement au registre légal, le pouvoir abdique le monopole du récit moral et factuel aux nouveaux acteurs de la vérification citoyenne.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora
POLITIQUE :: les + lus

.jpg)
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 113399

Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103683


Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82957
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577

Vidéo de la semaine
évènement