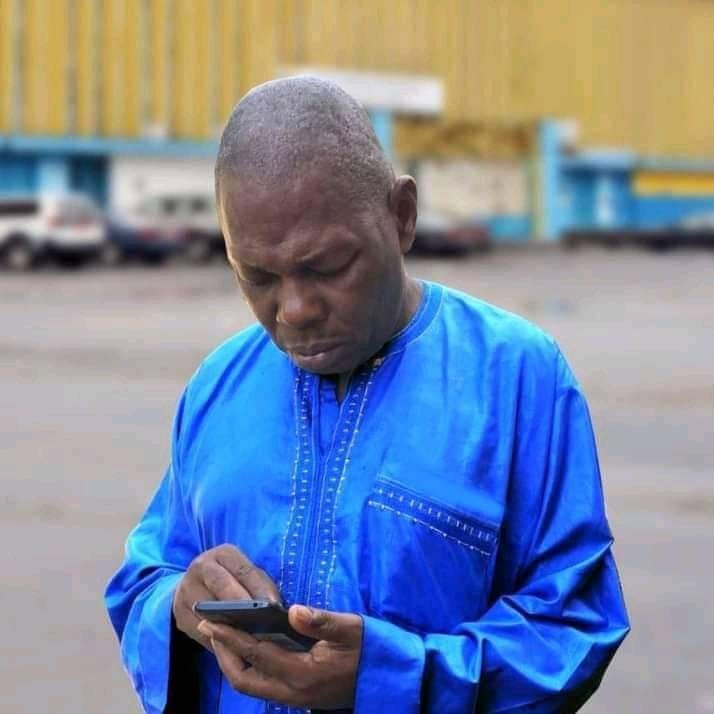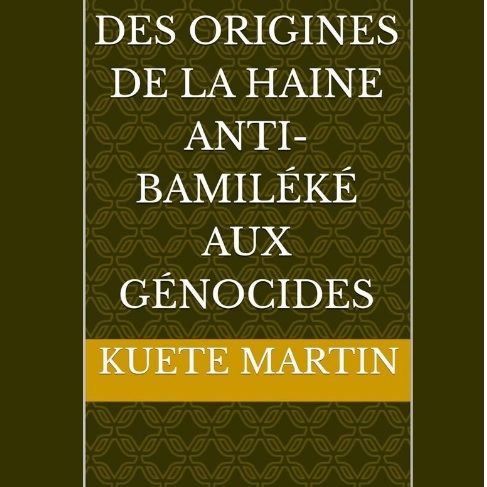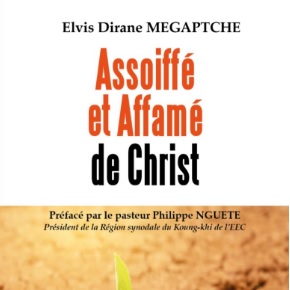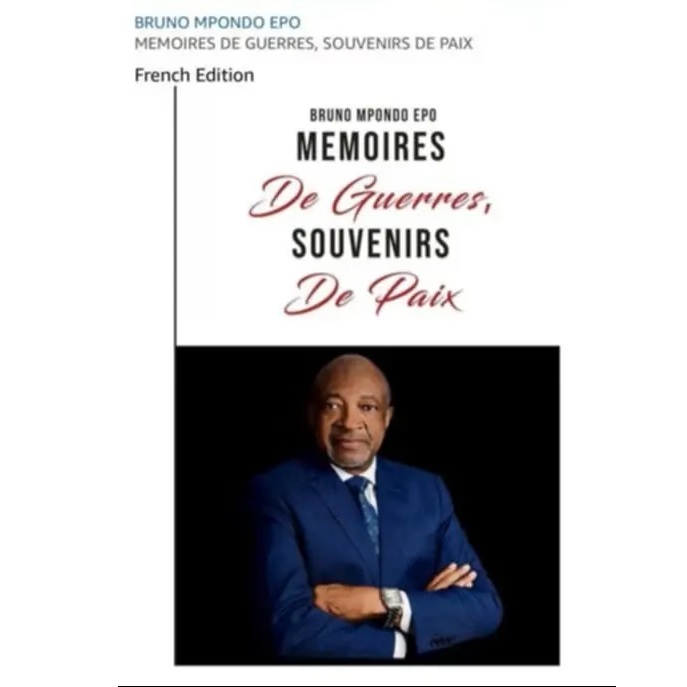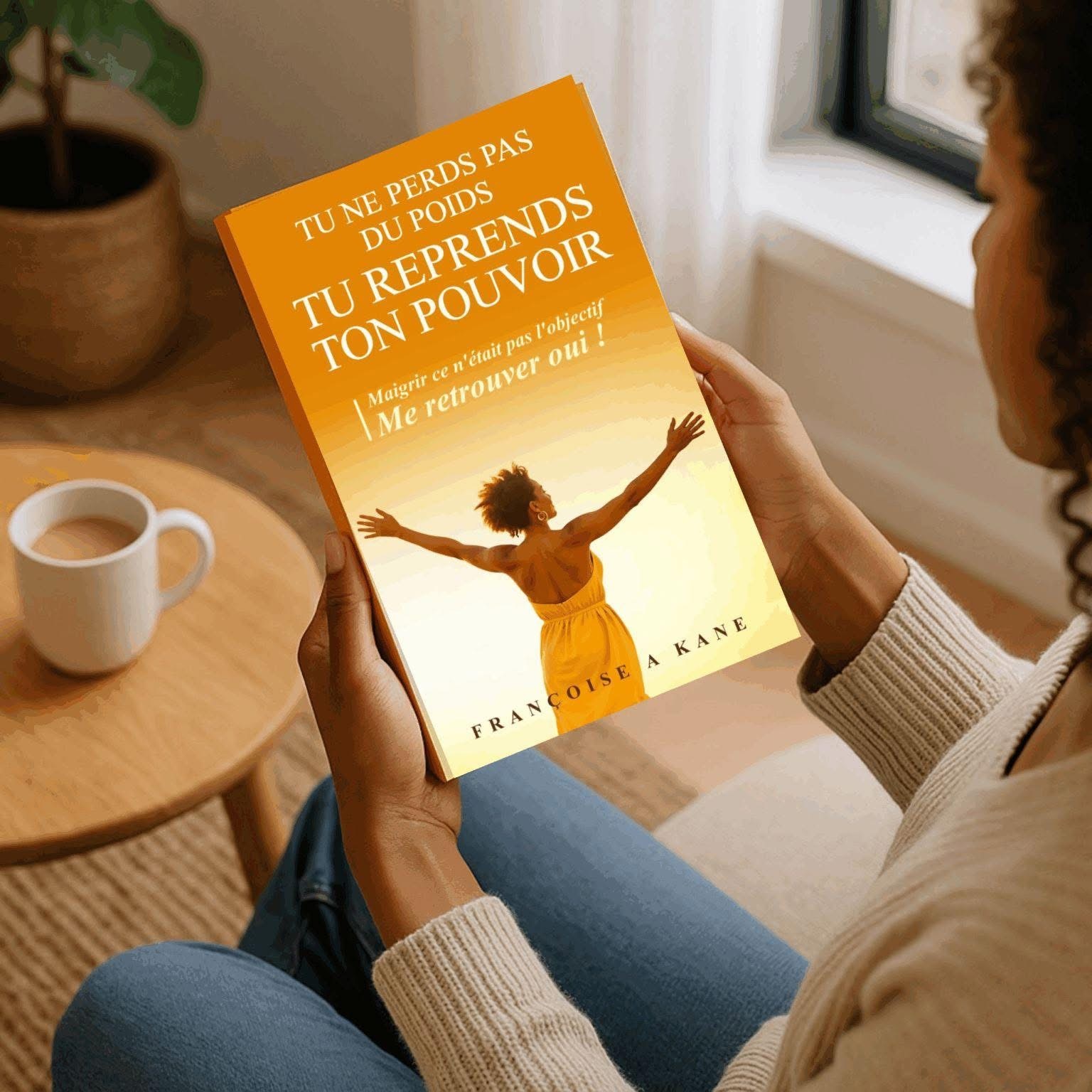-
© Correspondance : Enoh Meyomesse
- 23 Jul 2017 16:50:38
- |
- 8060
- |
Cameroun, Roman : « Mendomo Hans revient de guerre » :: CAMEROON
Au début de l’année 1941, en pleine seconde guerre mondiale, Mendomo Hans, un paysan du village d’Ozem, se rend à Ebolenji pour vendre un sac de cacao. Il y est arrêté par la milice coloniale et enrôlé de force dans les Forces Françaises Libres, FFL. Puis, il est envoyé en Afrique du Nord au front libyen combattre l’armée italienne. Au mois de décembre 1944, il est démobilisé et rapatrié dans son pays. Mais, il n’est plus le même homme. La crainte de l’homme blanc s’est évanouie en lui.
A travers ce récit, c’est la révolte des anciens combattants africains de la seconde guerre mondiale de retour dans leurs pays qui est décrite, et tous les changements politiques qui en ont découlé en Afrique où plus rien ne pouvait plus être comme avant entre les colons et les indigènes. Les travaux forcés et les corvées de portage ont été supprimés, le code de l’indigénat a été abrogé, la citoyenneté française a été accordée aux indigènes, et le 21 octobre 1945 ont été organisées les toutes premières élections de députés de l’histoire africaine.
Au Cameroun, Alexandre Douala Manga Bell a été élu, et a été ainsi le tout premier indigène à représenter le pays à l’Assemblée nationale française à Paris.
EXTRAITS :
Chapitre III
Le camp Lafayette était situé au quartier des Blancs à Ezezamville. Il était constitué de quelques bâtisses et d’une grande cour, le tout logé dans une grande clôture en fils de fer barbelés. Il hébergeait le commandement militaire français de la région, les logements des officiers et sous-officiers français. Les hommes de troupe indigènes quant à eux étaient logés dans une caserne située non loin de là et appelée « camp indigène ». Au milieu de la cour de ces deux camps, flottait gaiement le drapeau bleu, blanc, rouge.
Mendomo et ses compagnons avaient été transportés dans des camions jusqu’au camp Lafayette. Ils y avaient été déversés dans la cour. Peu de temps après leur arrivée, le commandant du camp, le Colonel Cadoux, était venu vers eux. « Garde-à-vous ! » Il s’étaient raidis. C’était un manchot. Il avait perdu un bras au combat. Une grenade le lui avait arraché. Il avait le regard mauvais, une voix nasillarde, des épaules de catcheur et était de grande taille. Il avait sensiblement deux mètres. Il impressionnait par sa corpulence.
─ Mes petits gars, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, et vous félicite pour le travail accompli en Afrique du Nord. Il a été admirable. Vous avez vaincu la vermine allemande. (Il s’était arrêté de parler, s’était mis à dévisager les soldats noirs en rangs devant lui. Puis avait
repris la parole). A présent que vous êtes de retour, la guerre étant finie, vous allez regagner vos villages. Vous passerez la nuit à la caserne, au « camp indigène » ce soir, le temps de nous permettre d’apprêter votre pécule. Demain matin, vous reviendrez ici, et nous nous dirons au revoir. Voilà ce que j’avais à vous dire. Il y aurait-il des questions ? (Il s’était mis à survoler du regard les soldats indigènes devant lui).
─ Oui, ma Colonel, avait après un moment répondu un soldat.
─ Je t’écoute.
─ Sergent Mpele, numéro matricule 425.
─ Oui, Sergent « M » Pele, je t’écoute.
─ Ma Colonel, « la » pécule là c’est combien ?
Tout comme pour l’officier du « Général Lyautey », cette question avait décontenancé le Colonel Cadoux.
─ Euh… le montant du pécule est calculé en fonction de la distance séparant Ezezamville du village de chacun de vous. Il va sans dire que celui par exemple dont le village est situé avant Meyega, tout près d’ici, percevra bien moins d’argent qu’un autre dont le sien est situé dans la banlieue de Fort-Foureau, à la frontière avec le Tchad. Autre question ?
Un autre doigt s’était aussitôt levé.
─ Oui !
─ Caporal Emgbwang, numéro matricule 719. Ma Colonel est-ce que la pécoule-la c’est seulement Ezezamville de mon village ? Il n’y a pas rien, dedans, un petit cadeau pour guerre que nous les Noirs nous gagnez pour vous les Blancs ? Ma Colonel, il faut nous répondez.
L’embarras du Colonel était visible, tout comme son agacement. C’était la toute première fois depuis qu’il était arrivé en Afrique, qu’un indigène s’adressait à lui de manière si effrontée. Pis encore, ces Noirs devant lui étaient avant tout des soldats, et lui un Colonel de l’armée française, ils lui devaient respect et considération, en plus, il était un Blanc.
─ Caporal euh… ton nom, désolé, est trop compliqué. D’abord, il n’est pas juste de prétendre que les soldats africains ont gagné la guerre pour les Blancs, non. C’est l’armée française qui a remporté la guerre, l’armée française et rien d’autre. Ensuite, demain, j’ai oublié de vous l’annoncer, je vous prie de m’en excuser, vous tous serez décorés de la médaille de la « Bravoure de guerre », une grande distinction de l’armée française, que même des Français de France engagés dans la guerre n’auront nullement le privilège de recevoir. Enfin, vous emporterez avec vous, votre paquetage, c'est-à-dire, les uniformes de l’armée française que vous portez en ce moment, les chaussures, la couverture qui se trouve dans votre sac à dos, et, naturellement, le sac à dos lui-même. Vous devez, mes chers amis, remercier profondément la France pour ces cadeaux d’une valeur inestimable. Combien, parmi vos congénères, dans leurs villages disposent-ils d’une couverture dans leurs lits ? Pas grand monde, n’est-ce pas ? Or, vous, vous rentrerez avec des vêtements, des paires des chaussures, etc. C’est beaucoup.
A ces mots, des murmures avaient envahi les rangs. Rapidement, ils s’étaient nués en chahut. Le Colonel Cadoux, d’abord désemparé par la réaction des soldats indigènes, avait aboyé : « silence ! ». Peu à peu, les murmures avaient cessé. Son regard était devenu plus mauvais que jamais. Il s’était mis à arpenter la cour, le regard rivé sur les soldats, tel un fauve sur sa proie. Sur ces entrefaites, un doigt s’était de nouveau levé. Cadoux s’était figé, avait foudroyé du regard le soldat qui l’avait fait. Ce dernier, indifférent, s’était mis à parler sans attendre qu’il le lui permette.
─ Serzan-sef Makouta, numéro matricoule 215. Ma Colonel, pas fâcher, pardon, pas fâcher. Nous, boucoup donner la France. Boucoup boucoup. Nos camarades, mourez, mourez boucoup. Boucoup boucoup. Nous veut récompensez, nous veut cadeau, gros cadeau. La pécoule-là, faut zouter. (Aux autres indigènes). Est-ce que zé mentez ?
─ Applaudez ! avait enchaîné un autre. Tous s’était mis à applaudir bruyamment et longuement.
Le Colonel Cadoux était tétanisé. Les yeux s’étaient mis à rouler dans leurs orbites telles des boules de feu, tellement ils étaient devenus rouges de colère. Des Nègres étaient en train de le défier, lui un Colonel de l’armée française, et il ne pouvait plus rien leur faire, dès lors
qu’ils étaient en train de retourner à la vie civile. Au bout d’un moment, il avait ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n’en était sorti. Il l’avait finalement refermée.
─ Nous pas bisoin médailles, nous bisoin zouter, ma Colonel, bisoin zouter, c’est tout, avait rajouté à haute voix, un autre soldat dans les rangs. Cadoux était fou de rage, des Nègres le défiaient impunément. C’était trop. Il avait explosé de colère.
─ Fermez vos gueules, bande de connards. Vous vous attendez à quoi ? Que la France vous paie ! Que la France vous paie ? Eh bien, laissez-moi vous dire, que celui qui n’est pas content aille se pendre, vous avez compris ? Qu’il aille se pendre. C’est pas vrai ça ! Pour qui vous prenez vous ! Hein ? Pour qui vous prenez vous ?
Du tac au tac, un autre soldat lui avait répondu :
─ Nous pas pendez, nous pas pendez, nous bisoin zouter, c’est tout.
─ Bon, mes Négros, cela ne va pas se passer comme vous le pensez. Pour commencer, (à un soldat français) adjudant Dumontier !
─ Oui chef ! avait répondu ce dernier tout en se tenant au garde-à-vous après avoir claqué le talon.
─ Tu me prends tous ces chimpanzés qui font l’andouille depuis un moment-là devant moi, tu me les jettes en cellule après les avoir fessés publiquement ici devant nous tous. Cinquante coups, pas un de moins compris ? Exécution !
─ A vos ordres !
L’adjudant Dumontier, après avoir une nouvelle fois claqué les talons, s’était avancé vers les soldats noirs, puis, au vu de leur nombre, il avait compris qu’il ne pouvait exécuter l’ordre du Colonel et s’était arrêté. Il s’était mis à regarder alternativement ce dernier et la foule noire effrayante devant lui. Cadoux avait une fois de plus explosé de colère, il s’était mis à agiter nerveusement son seul bras, en direction des Noirs, en aboyant littéralement.
─ Ouai ! Je vois, vous vous prenez déjà pour des Blancs, parce que vous revenez de guerre. Vous vous permettez désormais de parler aux Blancs comme s’ils étaient vos égaux. Ah là là ! Ah là là ! Je le savais ! Je le savais ! Ces Nègres n’allaient pas manquer de revenir différents, transformés par la guerre. Je savais qu’ils n’allaient plus avoir aucun respect pour nous. Je savais qu’ils n’allaient plus avoir aucun respect pour la France. Je ne maudirai jamais assez ce criminel d’Adolf Hitler. A cause de lui, les Nègres ont changé. Ils n’ont plus peur de nous. « Zouter ! Zouter ! » Ils n’ont plus que ce mot à la bouche. Zouter quoi ? Zouter rien, rien du tout. Vous avez compris ? Zouter rien du tout. C’est moi qui vous le dis…
………………………….
Chapitre IV
Lorsque Mendomo avait été enrôlé dans les Forces Françaises Libres, FFL, comme conséquence de son arrestation à la suite de la bagarre de « nda Kpwata », il avait été conduit à Ewondo, ainsi que tous les indigènes enrôlés de force comme lui à Ebolenji, menottes aux poignets. Au camp militaire Jeanne d’Arc, qui servait de lieu de regroupement pour tous les indigènes désormais soldats français, les menottes lui avaient été enlevées lors qu’il avait été présenté au capitaine Dareau, pour les formalités militaires.
─ Hé, toi, avance ! ce dernier lui avait-il dit. Il s’était exécuté. Ah bon, toi au moins tu comprends le français. Les choses sont plus faciles dans ce cas, très bien. Quel est ton nom ! J’espère qu’il n’est pas compliqué comme tous les autres, sinon…
─ Mendomo Ondja’a Hans, avait répondu Mendomo.
─ Hé là, doucement. Répète-moi ça.
─ Hein ?
─ Répète ton nom, macaque, tu comprends le français, oui ou non ?
─ Zé comprendez, sef, zé comprendez.
─ Alors, c’est simple ce que je te demande. Répète ton nom.
─ Oui, Mendomo Ondja’a Hans.
─ Pas question. C’est trop compliqué, encore un nom à coucher dehors. Pas question. Bon, désormais, tu t’appelles Madamou, et comme Hans signifie en français, Jean, hé bien, tu
t’appelles désormais Madamou Jean. Voilà, c’est fini avec ton nom à la con. Men machin chose, plus question. Madamou Jean voilà, c’est désormais ton nom compris ?
─ Hein ?
─ Hein, hein, abruti. Je t’annonce que j’ai changé ton nom. Je l’ai modernisé, si tu veux, je l’ai rendu en quelque sorte plus comestible. Tu me vois en train d’écrire ton baragouin de nom que tu m’as dit là, ho, mais, pour qui me prends-tu ? Madamou Jean, tel est ton nom à partir de maintenant. T’as compris ?
─ Zé… euh…
─ Dis oui, t’as pas à réfléchir, de toute façon, ce n’est pas moi qui vais t’appeler par ton nom complétement stupide collé à un prénom allemand. Pas question. Allez, réponds. Madamou Jean…
─ ….
─ Si tu réponds pas, je t’en file une, moi je ne blague pas avec les Nègres moi. Il avait levé la main comme s’il allait gifler Mendomo.
─ …
─ Pour la seconde et dernière fois, Madamou Jean…
─ …
─ Gare à toi, je vais t’en coller une …
─ …
─ Madamou Jean…
Pendant que Mendomo continuait à chercher à comprendre la raison pour laquelle ce Blanc avait décidé de changer son nom « vlan ! », une gifle d’une rare violence avait atterri sur son visage. Celle-ci avait été si forte qu’il avait failli se renverser. La marque des cinq doigts de la main du Blanc était restée sur sa joue.
─ T’as vu ? Moi je blague pas moi, ok ? Alors, pour la dernière fois, Madamou Jean…
─ … Oui …
─ Madamou Jean…
─ Oui !
─ Plus fôrt ! Madamou Jean !
─ Oui !
─ Voilà, tu vois, hé bien nous allons devenir de bons amis, mon cher Madamou. Bon, j’écris sur mon registre ton nom. Ma-da-mou, prénom, Jean. Village d’origine. On va pas compliquer, Ebolenji. De toute façon, c’est de là que tu viens. Donc, village d’origine, E-bo-le-nji. Voilà. Race. Race, race, race… Euh, les gens d’où tu viens sont des Pahouin, si j’ai bonne mémoire. Donc, race, Pa-hou-in. Parfait. Age. T’as quel âge ? Hein ? Attends, laisse-moi deviner, c’est pas la peine de me le dire, vous les Nègres vous ne savez jamais quel est votre âge. Bon, voyons, voyons…euh… attends un peu… euh… vingt… deux… ans. Voilà c’est ton âge. T’as vingt-deux ans. Alors j’écris, âge, vingt-deux ans. Bon, tu pourrais avoir vingt-trois ou vingt-quatre, ce n’est grave. Vingt-deux ans, ça te convient très bien. Voyons, euh… ouvre ta bouche, que je vérifie si t’as toutes tes dents. Allez, ouvre-là, ta bouche. (Mendomo avait grandement ouvert sa bouche. Le Blanc en avait aussitôt éloigné son visage) Oh là là ! Quelle épouvantable haleine, on dirait une bête. Et même, ça dépend de laquelle, celle d’un cochon. Les chèvres et compagnie, ont une haleine… euh… disons, … euh…, en tout cas meilleure que la tienne. Bon, ouvre-là ta gueule. (Il s’était mis à lorgner à l’intérieur de la bouche de Mendomo). Ok, t’as toutes tes dents. Bien mieux, elles ne sont pas taillées. C’est normal, t’es pas un pygmée. Ce sont ces bestioles-là qui taillent leurs dents pour mieux découper la viande. (A ces mots, il avait éclaté de rire longuement). Ah, les Nègres, j’aurai tout vu avec eux ici en Afrique. Ils ne sont pas simplement sauvages, ils sont plus que ça, primitifs. Et, finalement, ils sont sympas, marrants. Bon, on continue, euh… est-ce que tu as eu la maladie du sommeil ?
─ Hein ?
─ La maladie du sommeil, euh… cette maladie qui fait dormir tout le temps ceux qui en sont atteint. L’as-tu ?
─ Non, zé pas malade.
─ Ok pas de maladie du sommeil. Dans ta famille, il y a-t-il quelqu’un atteint de lèpre ? Il y a-t-il un lépreux ?
─ Non, zé pas malade.
─ Ok pas de lèpre. Bon, retourne-toi. C’est ça. (Il s’était mis à scruter le corps de Mendomo). Très bien. Pas de plaie purulente, juste une petite éraflure au mollet. Fais voir tes orteils que je puisse vérifier si t’as des chiques. Apparemment, t’as pas de chique. C’est bon, c’est bon. A présent, euh… voyons, voyons, sais-tu faire la cuisine, parce que l’on pourrait t’utiliser comme marmiton ?
─ Non, les hommes pas faisez la cuisine.
─ Tais-toi, gros bêta, je retiens que tu ne sais point en faire. Ok Bon, euh… voilà. Taille, tu dois avoir, voyons… un mètre soixante-quinze. C’est une taille moyenne, t’es pas un nabot. On saura où t’utiliser. Bon, ok. C’est tout. Alors, reprenons. Nom, Madamou, Prénom, Jean, race, Pahouin, village, Ebolenji, état de santé… oh là là ! J’ai oublié de te demander si tu fumes.
─ Non, zé me fumez pas.
─ Ne fume pas. De toute façon, si tu mens, on le saura. Et puis, est-ce que tu bois ? Oh, ne réponds pas. Existe-il un Nègre qui ne s’enivre pas de ces breuvages nauséabonds et extrêmement dégueulasses que cette race distille ? Donc, je te pose même pas cette question, t’es un ivrogne comme tous ceux de ta race. Ok je crois qu’on a fait le tour. Donc Madamou Jean, je t’attribue le numéro matricule 2376. Ok ? Il faut le retenir. Toutes les fois où tu auras à te présenter, tu diras, tirailleur Madamou Jean, numéro matricule 2376, voilà. A présent, va te tenir là-bas on va d’abord te tondre la tête, puis on va te remettre ton paquetage, uniforme, gamelle, chaussures, sac à dos. Tu devrais te réjouir, ce sera très probablement la première fois de ta vie que tu porteras une paire de chaussures, et peut être même tu seras le premier de tout ton village à le faire. Tu vois combien la France est généreuse ?
……………..
Chapitre VI
─ Tirailleur Madamou Jean, noumérou matricule 2376 !
Mendomo avait claqué les talons devant Lepreux, le régisseur de la prison d’Ezezamville. C’était un petit homme sec, les cheveux taillés en brosse, avec un cou allongé. Il était un freluquet.
─ Ouai, qu’est-ce que tu veux tirailleur ? Et puis, que fais-tu ici, tu devrais être au front, en Afrique du Nord. C’est pas ça ? avait-il répondu avec mépris à Mendomo.
─ Guerre finie. Nous, rentrez la nuit nous tous. Nous démobilisez.
─ Ah bon ! J’étais pas au courant. Bon, si vous êtes rentrés, ça veut dire tu n’es plus un soldat. Pourquoi t’a-t-on pas retiré tes vêtements militaires ? Hein ? Il faudrait pas laisser des individus comme toi dans la nature avec l’uniforme de l’armée française. C’est une négligence qui pourrait avoir des conséquences graves. Normalement, je devrais t’arrêter et te jeter en prison. T’as plus à porter cet uniforme. En tout cas, je vais en parler au colonel Ca-doux. Bon, qu’y a-t-il ?
─ Missié, mari de ma sœur-là, (il avait présenté Abengdang) est dedans-là. C’est beau-frère il faut libérez.
Lepreux avait d’abord regardé, éberlué, Mendomo. Puis, il avait été pris d’un fou rire, avait ri longuement aux larmes, et avait achevé celui-ci d’une quinte de toux.
─ Mon petit bonhomme, avait-il finalement dit, t’as de la chance que je sois de bonne humeur. T’es vraiment un chanceux pour ce que tu viens de faire, je devrais te jeter dedans, immédiatement.
Il avait de nouveau éclaté de rire lorsqu’il avait fini, il avait repris la parole.
─ Hé ! Tirailleur de mes bottes, tu as cinq minutes pour vider les lieux, cinq minutes, pas une de plus, compris ?
A ces mots, Abengdang s’était blottie contre Men-domo et s’était mise à le supplier de renoncer à son désir de libérer son mari. « Laisse-moi tranquille », lui avait-il rétorqué.
─ Il reste quatre minutes…
Mendomo sentait une immense colère monter dans son cœur. Il s’était mis à regarder, avec des yeux de flammes, Lepreux. Son corps s’était mis à trembloter légèrement. Ses mains étaient devenues moites. Sa gorge était devenue douloureuse. C’était comme si un gros caillou rugueux s’y était logé.
─ Il reste une minute.
─ Il restez ziro ! avait rétorqué Mendomo, zé né bouzez pas.
Lepreux avait frappé les mains sur la table, et avait aboyé : « hors d’ici ! Chimpanzé ! » Puis voyant que Men-domo ne bougeait toujours pas, il avait contourné nerveusement sa table de travail et l’avait bousculé. Ce dernier n’avait plus demandé son reste. Il l’avait soulevé du sol avec ses mains, posé sur son épaule, ouvert la porte de son bureau, transporté dans la cour de la prison, projeté rageusement au sol. Puis il s’était jeté sur lui, s’était installé sur son torse, et s’était mis à lui rouer le visage de coups de poings, tout en l’abreuvant d’injures. Abengdang, à son tour, s’était jetée sur lui, s’était saisie de sa ceinture et l’avait projeté en arrière. Elle s’était retrouvée au sol avec lui, s’était levée la première et s’était agenouillée devant lui. « Mendomo, pitié, sauve-toi, ils vont te tuer, ils vont te tuer, sauve-toi ! ».
Lepreux s’était rapidement relevé. Il avait une lèvre fendue, un œil au beurre noir. Un filet de sang serpentait sur sa lèvre supérieure, s’écoulant du nez, et son corps était entièrement couvert de poussière, pour avoir été plaqué au sol par Mendomo. « Macaque, je vais te montrer de quel bois je me chauffe moi », avait-il beuglé. Il s’était aussitôt jeté à son tour sur lui, avant qu’il ne se relève.
Mendomo s’était rapidement retourné et l’avait de nouveau plaqué au sol. Cette fois-ci il s’était saisi de sa gorge et s’était mis à la serrer fortement. Il désirait l’étrangler. « Mendomo, ne le tue pas, ne le tue pas ! » hurlait pour sa part de nouveau Abengdang affolée, pendant que Lepreux ne se débattait plus que par les jambes, incapable de desserrer le terrible étau des mains de Mendomo autour de son cou.
Un gardien de prison, voyant son patron en difficulté, avait sorti sa matraque et en avait assené à Mendomo plusieurs coups sur le dos. Ce dernier avait lâché le cou de Lepreux, s’était relevé, avait raclé du pied les jambes du gardien. Celui-ci était tombé à la renverse. Toute une meute d’autres gardiens avait encerclé Mendomo qui avait plié ses poings et vociférait : « Approchez ! Approchez ! Zé vous montrez que zé sortez de guerre, que zé tuez boucou Blancs avec mon fusil comme avec mes mains ! Approchez ! Approchez ! Si vous êtez des hommes ! Bande d’imbéciles. Zé corrigez un Blanc qui nous maltraitez, nous les Noirs, et vous prendez sa défense ? Hein ? Imbéciles ! »
* *
*
Une réunion des dirigeants français de la ville s’était tenue dans les services du Haut-commissariat de la France à Ezezamville. Des quatre cents tirailleurs noirs qui avaient débarqué le matin au port d’Ezezamville et qui avaient été logés au « camp indigène », une quarantaine avait déclenché des bagarres contre des Européens, Français, Grecs, Libanais, etc., à travers la ville, suite au quartier libre qui leur avait été accordé. Cette situation était inquiétante. Les Nègres de retour de guerre n’avaient plus de toute évidence aucune crainte de l’homme blanc. Cela constituait une grosse menace pour la présence française sur le territoire. Le nombre de tirailleurs démobilisés allait être de trois mille. Si déjà les premiers arrivés, tout juste quatre cents, avaient commis tant de dégâts en une journée à peine, que pouvait-il en être lorsque les trois mille allaient être répartis à travers tout le territoire ?
A l’issue de la réunion, plusieurs décisions capitales avaient été prises. Les tirailleurs qui avaient commis des exactions, n’allaient pas être punis pour celles-ci, d’autant que la plupart, pour ne pas dire leur écrasante majorité, allaient quitter Ezezamville pour leurs villages respectifs. Il fallait impérativement accélérer leur départ. Leur présence dans la ville était une source de dégâts. Dans la matinée, ils s’étaient plaints de ne pas pouvoir bénéficier d’un pécule consistant, en tout cas, nettement supérieur à leurs frais le transport d’Ezezamville à leurs villages. Il avait été décidé que tous bénéficieraient d’un forfait égal en guise de « cadeau » pour leur participation à la guerre, en plus de ces frais de transport.
Pour acquérir le livre : www.amazon.fr, taper le titre ou Enoh Meyomesse
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LIVRES
Les + récents
Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577

Vidéo de la semaine
évènement