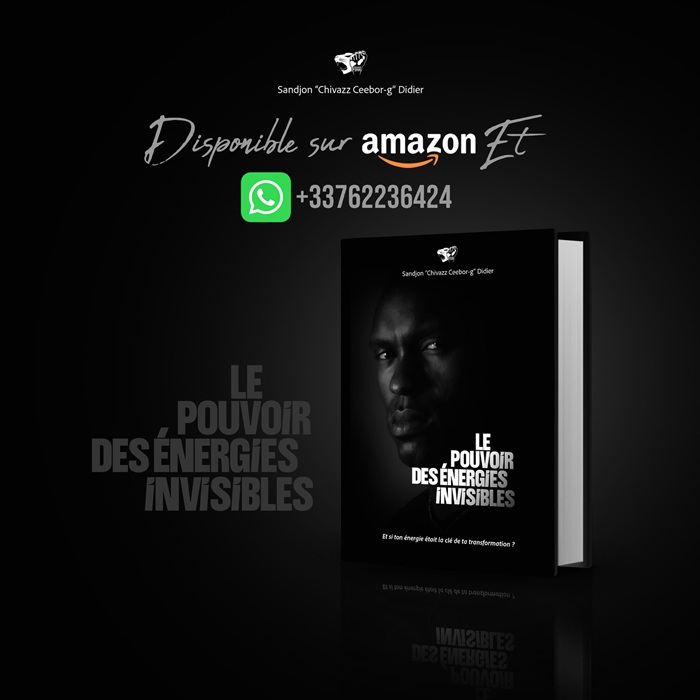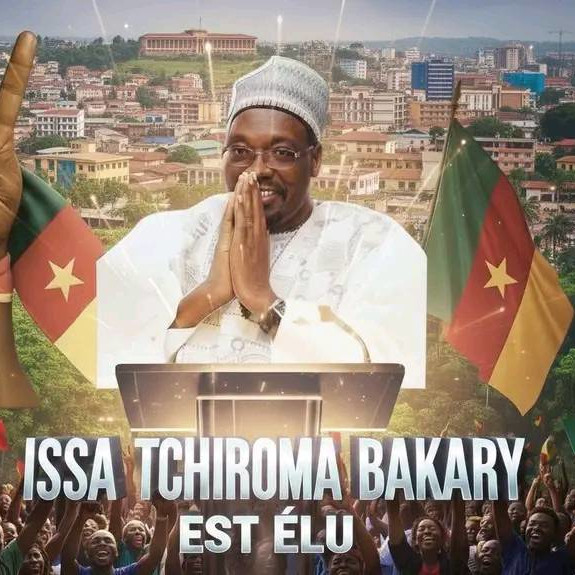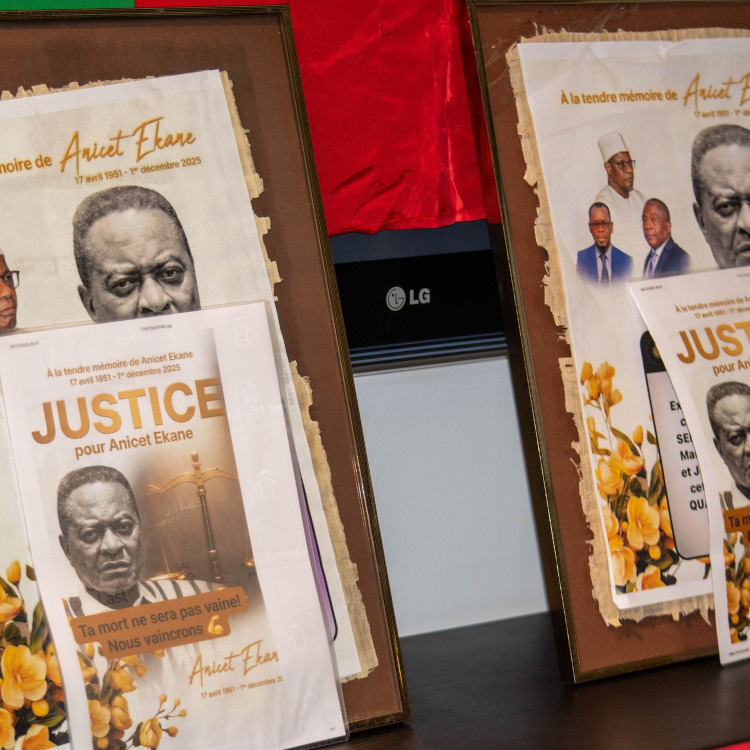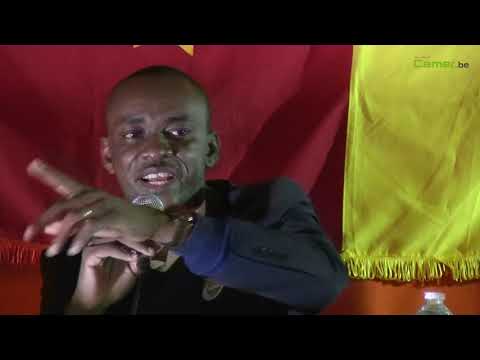-
© Camer.be : L rédaction
- 10 Jun 2024 15:46:10
- |
- 2940
- |
CAMEROUN :: Maroua : 20 morts en un mois, l'axe Para-Pesage devient un enfer routier ! :: CAMEROON
Un véritable drame se joue sur la route reliant le carrefour Para au pesage à Maroua. En l'espace d'un mois, plus de 20 personnes ont péri dans des accidents de la circulation sur ce tronçon de seulement 2 kilomètres, plongeant la ville dans l'émoi et la consternation. Face à ce carnage routier, les autorités locales et la population appellent à une action concertée et urgente pour stopper ce fléau.
Un tronçon meurtrier
Le tronçon reliant le carrefour Para au pesage est devenu un véritable point noir de la sécurité routière à Maroua. Les accidents y sont d'une rare violence, et les causes multiples : vitesse excessive, imprudence des conducteurs, état des routes dégradé, manque de signalisation... L'ampleur du problème a conduit le délégué régional des Transports pour l'Extrême-Nord à annoncer une série de mesures visant à améliorer la sécurité routière dans la région.
Des mesures pour endiguer le fléau
Parmi les mesures annoncées, la construction rapide de nouveaux axes routiers, la réforme des centres de formation des conducteurs et la signature de conventions avec les communes locales pour renforcer la prévention des accidents. Des actions de sensibilisation à grande échelle sont également menées auprès des populations vulnérables, en partenariat avec les syndicats de conducteurs, de motocycles et de transporteurs routiers.
Un appel à la mobilisation collective
Malgré ces efforts, les chiffres alarmants d'accidents de la route persistent à Maroua. La situation est d'autant plus inacceptable que les causes de ces drames sont souvent connues et identifiées. C'est pourquoi un appel à la mobilisation collective est lancé pour mettre un terme à cette spirale de tragédies.
"Nous déplorons le comportement des éléments de la brigade routière qui ne contrôlent que les gros porteurs, laissant passer les véhicules aux pneus usés", s'indigne Ousmaila Souba, habitant du quartier Mesquine.
En mémoire des victimes innocentes de ces accidents et pour que nos routes redeviennent un espace sûr, il est impératif que chacun prenne conscience de sa responsabilité. La sécurité routière est l'affaire de tous, et seule une mobilisation collective permettra de mettre fin à ce carnage routier qui endeuille trop souvent la communauté de Maroua. L'heure est à l'action, la vie n'attend pas !
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Noël à Buea : ENEO installe des transformateurs après un an d’obscurité
Crise anglophone : Sylvanus Mutagha du MRC kidnappé sur l’axe Bamenda-Kumbo
David Pagou : de l'exil à Salapoumbé au triomphe des Lions à la CAN 2025
CAN 2025 : Etta Eyong offre au Cameroun une entrée victorieuse à Agadir face au Gabon
Message du président élu et légitime ISSA TCHIROMA au peuple Camerounais
SOCIETE :: les + lus

26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1024673

Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 561254

Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448746

Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386160

LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 219660

Vidéo de la semaine
évènement