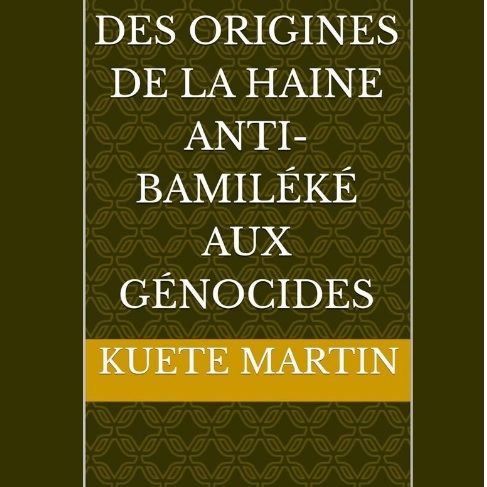-
© Correspondance : Serge Alain GODONG
- 18 Dec 2025 11:45:11
- |
- 335
- |
CAMEROUN :: ANICET EKANÉ : ARCHÉOLOGIE D’UNE MORT RÉUSSIE par Serge Alain GODONG :: CAMEROON
La stupeur générale dans laquelle a été accueilli le passage à trépas de cette figure éminente de la scène politique camerounaise, depuis quasi cinquante ans, nous conduit finalement vers une réflexion inattendue : Et si, contrairement aux premières apparences, la disparition du Président du MANIDEM dans les conditions que l’on sait, était le meilleur moment mis à disposition par la nature, pour le retirer du vivant ? La scénarisation de son extinction porte en effet à ce que Michelle Perrot appelait « la leçon des ténèbres ».
En ce sens qu’une « bonne mort », parfaitement réussie, demande une pleine maîtrise technique : nécessaire en effet de disposer d’un lieu public, d’une communauté de spectateurs, d’une dramaturgie, d’une énergie mortifère, d’un « sorcier » coupable, des exécutants et un corps disponible comme réceptacle de la souffrance et du démantèlement du vivant. Sur ce plan et de façon quasi christique, Anicet Ekane s’approche du chef-d’œuvre.
ANICET EKANÉ : ARCHÉOLOGIE D’UNE MORT RÉUSSIE
Par Serge Alain Godong
Universitaire
Réussir ses conversations avec le monde
Sans trop croire en la possibilité d’une quelconque réponse positive, j’avais composé les neuf chiffres encodant son numéro de téléphone et avais fait retentir la sonnerie à l’autre bout de la ligne, injectant dès lors directement ma voix dans le périmètre de sa conscience. Avec le professionnalisme d’un vendeur de détergent, j’avais entrepris de lui proposer de venir, de Douala pour Yaoundé, une semaine plus tard, afin d’offrir son visage à ce moment j’avais imaginé comme devant rassembler la communauté du groupe de discussion dénommé « Innovation politique », que j’avais fondé deux ans plus tôt.
Et, à ma grande surprise, il m’accorda grande écoute dans le grésillement tortueux des communications électroniques camerounaises et répondit, d’un ton – comme à son habitude – très doux, feutré, toujours un tantinet confidentiel, presque ecclésiastique, soigneux mais d’une teinte joviale : « oui, je viendrai, je serai là ». Je me soupçonnais jusqu’alors quelques capacités de persuasion dont je découvrais ce jour-là les effets, au sommet de ce charme mondain qui confère de bon goût une sorte d’âme spirituelle à ceux qui font bonne société.
Anicet Ekane vint effectivement finalement à notre belle petite fête. Il portait ce soir-là une chemise blanche immaculée sur des mocassins noires, traînant son éternel air de poète désabusé, on aurait dit un homme engagé dans une rage secrète contre sa propre vie. Le lendemain, nous fîmes le voyage retour sur Douala à bord de sa Toyota Corolla grise, véhicule aux finitions sommaires et à l’espérance de vie difficile, dont on voit, vieillir quelques exemplaires dans la circulation urbaine de nos villes, l’air dépenaillé. C’est ce jour-là que nous parlâmes le plus abondamment, le plus intensément de sa vision politique et de ses combats de saison. Epuisé par le fête de la veille et lourdement menacé par le sommeil, je l’écoutais dans une sorte de longue divagation aérienne, l’esprit perdu dans le fouillis de la lutte du corps contre la fatigue et le crépitement d’une narration à la tonalité presque eschatologique.
D’étranges et turbulentes interconnexions et reconnexions mentales se croisaient dans mes neurones et j’avais un peu l’impression d’effectuer un voyage imaginaire, vers une destination illusoire. Le monde rebondissait et nageait sous mes yeux, onduleux, comme des reflets dans un miroir déformé et chaque fois que je m’efforçais de regarder aux devants de chaque kilomètre avalé, je voyais la cime des arbres dandiner aux confins de mon imagination et la vie se dessiner sous des réverbérations solaires. Dans « Un samedi soir sur la terre », majestueux album sorti 1993, Francis Cabrel se questionnait sur la façon dont Dieu lui-même, assis sur les rebords du monde, regarde les titubations de sa Création éperdue. A ce moment précis en effet, Monsieur/Madame Dieu avait sans aucun doute les yeux sur nous.
En effet, des voix célestes avaient subrepticement pris possession de ses cordes vocales et nous parlaient, au loin. Anicet Ekane se mit à me proposer de m’engager plus férocement à ses côtés, de vraiment esquisser un chemin sur la politique. Il me dit : « il n’est pas normal qu’un bonhomme comme toi reste en dehors des luttes ». Je lui répondis, « d’accord ». Et nous avançâmes, jusqu’au terme des quelques 270 km. Ainsi, commençai-je à mettre un tout petit peu les affaires en perspective : Anicet Ekane n’était pas tout à fait un ami, mais une personne dont je m’étais rendu familier de la conversation sur quelques années, lorsque – en transit à Douala dans une brève expérience professionnelle – nous nous retrouvions généralement la nuit, pour explorer les frontières morales et tactiques nous séparant de quelques oiselles esseulées dans le blafard des éclairages publics, à cette heure du crime où les sorciers sont réputés voler dans des avions surpeuplés, part de mystère que mettait parfaitement en chorégraphie le chanteur Michael Jackson dans le plus splendide vidéogramme musical de tous les temps : « Thriller ».
Il buvait alors des signatures racées d’origine écossaises et maturées 18 ans, à 41 degrés de contrôle absolu sur sa lucidité. Lorsqu’on lui parlait, en ces moments-là, son œil se remplissait de cette humidité qui en augmentait la pénombre, faisant craindre l’imminence d’un danger public. Une autre fois nous nous retrouvâmes un peu au hasard à Kribi, dans un restaurant spécialisé dans les grillades de poulet. Il me dit : « Hey, Serge, ça fait longtemps ! ». Les occupants de stables voisines se mirent alors à nous observer et écouter aux portes de notre conversation, très crûment politique, achevant de nous dépeindre moralement comme des auteurs d’une infraction. Puis, commença l’ère d’une collaboration professionnelle, née de mon indignation à le voir résister à la tentation de coucher ses souvenir par écrit.
Je lui dis : « Président, tu ne peux pas faire ça, continuer ainsi. Il faut que tu partages tes souvenirs de lutte, ton expérience politique si unique ». Ce à quoi il répondit : « On va le faire ». Nous commençâmes donc à nous voir pour travailler ; lui parlant et moi enregistrant. Souvent à distance : moi posant des questions, lui me faisant parvenir ses réponses par des enregistrements vocaux. Nous étions encore assez loin du compte, surtout du fait de l’érosion de sa santé, qui le rendit plus distant dans la transmission de mes attendus. J’en étais assez mécontent, déçu et ne manqua pas de l’accabler de reproches, me désolant de l’occasion unique qui m’échappait ainsi de faire bel exercice littéraire à partir d’un matériau et d’une personnalité exceptionnels. Et c’est au milieu de cette ambition qu’il s’en est allé, m’abandonnant au milieu du fleuve Wouri, sans ressources pour nager.
Réussir sa mort au plan médical
Les données officielles font du Cameroun un pays où l’on vit, en moyenne, jusqu’à l’âge de 58 ans, selon les statistiques de santé publique diffusées par le Ministère éponyme. Anicet Ekane lui, s’en va à 74 ans, soit après avoir tenu dans sa chair et ses os, quelques seize années de plus que la moyenne. Rien que cela est une victoire : Marc-Vivien Foe a manqué 28 ans pour faire ce chemin ; Christian Penda Ekoka a, à 69 ans, manqué 05 ans, au ravage d’un impitoyable cancer, le chanteur lui s’en est allé à 33 ans, Jean-Miché Kankan s’est éclipsé à seulement 41 ans, le jeune médecin lui a été avalé par un serpent venimeux à seulement 30 ans.
Un nombre incalculable de personnes décèdent à 20 ans, d’autres à 30, beaucoup à 40, ainsi de suite. Certains enfants ne connaissent même pas le privilège de la respiration : ils sortent de l’utérus déjà épuisés par les horribles combats de la vie. Beaucoup d’autres brûlent leur espérance à 02 ans, les plus chanceux à 05, certains téméraires à 10. Tenir jusqu’à 74 ans après avoir vécu la vie âpre, acrobatique et bien souvent dangereuse que monsieur Ekane a parcourue, en soi, relève de la performance. Et il faut l’en féliciter : beaucoup de ceux qui lisent ce texte (et peut-être même, celui qui l’écrit) ne connaîtront rien de cette grâce.
Dans le raisonnement darwinien de la sélection naturelle, Anicet Ekane fait partie des éléments supérieurs de la race, les durs à cuire, les champions. Et bien que sa santé soit notoirement reportée comme ayant été fragilisée sur les dernières années, il est même plutôt décédé en relative bonne condition, sans entaille sur une dégradation physique monstrueuse, sans se rendre invalide et donc dépendant de soins gériatriques. Certes, connaissait-il des problèmes respiratoires ; mais il y a pire en termes de lacération de la vie, lorsque celle-ci décide de vous vider de son suc.
Ainsi, 74 ans apparaît franchement plutôt comme un bel âge pour mourir ; une sorte d’âge médian : encore assez jeune pour profiter du résidus de force qui reste afin de croquer dans la chair mais pas tellement motivé pour commencer à voir son corps et son esprit partir en dégénérescence et donc rendre la suite du vivant fastidieuse pour soi et pour les autres. Car, quel intérêt peut-il y avoir à continuer de s’accrocher à sa chair lorsque celle-ci ne devient que réceptacle du délitement, du démantèlement pièce par pièce d’un corps jadis robuste, de la douleur, de la gêne, de l’inconfort, de la diminution de sa liberté à agir, de la frustration, de diverses restrictions et de tant d’accablements pharmaceutiques ?
C’est ici où je trouve intéressant de raisonner à partir d’une catégorie théorique en économie que l’on nomme « l’optimum de Pareto ». Que dit la notion ? Qu’il s’agit d’une situation où l'on ne peut améliorer la satisfaction d’un besoin ou le bien-être d'un individu sans possiblement établir le début d’une quelconque autre insatisfaction. En clair, il s’agit d’un critère d'efficacité maximale où les ressources sollicités pour une tâche ou une action sont pleinement disponibles et en production de ce à quoi elles sont mobilisées. Pour le dire de façon précise dans le cas qui nous intéresse, l’on peut établir que – une fois que l’on a atteint 74 ans – la zone de mobilisation optimale de ses ressources de corps, d’esprit et de vie sont depuis longtemps passées et que s’est par contre engagée un autre théorème de l’économie politique que l’on nomme la « loi des rendements décroissants ».
Laquelle loi stipule qu’il s’agit de la zone d’impossibilité où l'augmentation d’un facteur de production (dans le cadre de notre raisonnement, imaginons que l’on ait fourni à Anicet Ekane le fameux appareil respiratoire et qu’il ait continué de vivre, à l’heure où nous parlons) tout en gardant les autres fixes (qu’on l’ait donc maintenu en détention), la production totale des ressources nécessaire à la bonne vie de l’Homme se serait donc sans doute poursuivie, mais à un rythme de plus en plus lent et de plus en plus coûteux pour d’autres organes (jambes, épaules, cœur, yeux, oreilles, etc.). Cela, jusqu'à ce que le rendement supplémentaire (productivité marginale – donc l’intérêt de continuer de s’accrocher à la vie) devienne nul, voire négatif, en raison de la saturation des facteurs fixes.
Je pense ne pas devoir expliquer beaucoup ce que je viens ainsi d’écrire, au croisement de ces deux concepts, et qui sont générateurs dans la médecine de ce que l’on nomme « l’acharnement thérapeutique ». A savoir, cette sorte d’« obstination déraisonnable » si propre à certains soignants notamment en Occident, où des traitements inutiles, disproportionnés ou sans bénéfice autre que le maintien artificiel de la vie (généralement en fin de vie) sont souvent prodigués à des patients largement épuisés par le poids de leurs propres os et de leur lourde chair.
Disons-le donc clairement, il y a un âge au-delà duquel vivre n’est plus si intéressant, à moins de prendre pour acquis de devenir une coûteuse charge pour sa Famille, ses Enfants, son partenaire de vie désespéré (et objectivement impatient de vous voir partir) et bien entendu, pour soi-même. Au vu de ce qui est établi comme augmentation des complications sur ses capacités respiratoires (entre autres) mon intuition est que – pour aussi choquant que cela puisse être à entendre – c’était peut-être finalement, pour Anicet Ekane,,le bon moment de partir.
Il ne faut donc pas exagérer ses pleurs sur mon Ami Anicet. La vie n’a métaphysiquement de l’intérêt que si l’on peut en faire quelque chose, si l’on peut lutter pour quoi que ce soit, si l’on peut se donner à une cause ; et donner sa respiration et sa foi à une cause, quelle qu’elle soit, demande justement, d’avoir le physique – et donc la santé. Dès lors que Monsieur Atangana Clément et ses amis – et bien en amont, Eric Essousse de même que, en chef d’orchestre Paul Atanga Nji – avaient fait ce que nous savons sur la Présidentielle d’octobre dernier, quelle sorte de lutte restait-il raisonnablement à Anicet Ekane pour donner sens à ses futures années ?
De quel profit une vie sous respiratoire lui aurait été, dès lors que l’objet de capitalisation de son souffle que lui-même s’était défini comme tel, à savoir aider au remplacement de Monsieur Biya Paul à la tête de l’Etat, lui avait été enlevé ? De ce fait, partir maintenant était, à bien y penser, la seule solution de portée. L’homme était arrivé au point d’intersection entre le souhaitable et l’impossible, à cette ligne de césure où le corps se reconnaît installé dans cette sorte de théorème que l’économiste américain Arrow appelle celui de « l’impossibilité »
Réussir sa mort au plan scénographique
C’est une chose en effet que de s’en aller. C’en est une autre de savoir théâtraliser ce départ, en lui donnant l’aspect raisonnable d’un spectacle. Peu y réussissent comme l’a fait jadis Mgr Jean Zoa, archevêque de Yaoundé, mort de désenchantement, d’amertume et de colère (contre Paul Biya) en pleine cène de la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de la capitale le 20 mars 1988, en présence de son contempteur et de l’ensemble des évêques du pays, clôturant leur annuelle conférence épiscopale. Le moment est épique en effet, dans ces souvenirs embarrassants que les hagiographes actuels de l’homme demi-dieu de la quarantaine tentent de toutes leurs forces de nous effacer.
Ce jour-là donc, le prélat pénètre dans la chapelle, enfile sa chasuble, s’enroule l’abdomen de la ceinture cléricale rouge, revêt sa cape céleste et s’en va ouvrir l’office, sous la voûte de ces chants grégoriens qu’il avait en affection. Il ouvre la célébration, fixe un regard ténébreux en direction de qui on sait, enfouit ses épaisses phalanges dans les pages de son énorme bible, bredouille quelques cantiques de caverne, fixe à l’horizon, voit s’envoler quelques pigeons qui peuplent d’ordinaire le silence du bâtiment, sent son cœur se serrer, sa respiration diminuer, la froid parcourir ses jambes et ses forces le quitter. Il s’écroule, d’une masse : sous le regard pétrifié de qui on sait.
Quelques minutes plus tard, dans les titubations de son transport d’urgence à l’hôpital général, il est déclaré mort. Une mort formidablement réussie ; tout comme l’a été – à sa manière – celle de Marc-Vivien Foé, celle de Michael Jackson parti en pleines répétitions pour un spectacle en préparation, celle d’Anouar El-Sadate pulvérisé lors d’un défilé militaire au Caire. Rien à avoir en tout cas avec ces morts niaises qui ne laissent aucun souvenir spécifique, perdues dans les tréfonds de chambres d’hospitalisation aux murs couleur de lait, dans les lacérations de toutes sortes de tubes transperçant le corps, dans des appareils qui mesurent le battement des cœurs et d’autres organes, dans les pertes de connaissances, dans de longues séances de réanimation, dans l’épuisement des siens, le tumulte des angoisses, les questionnements, les achats de médicaments qui ne s’arrêtent pas, les guérisseurs, les marabouts, les prêtres, les séances d’exorcisme, les prières de pasteurs.
Mais aussi, les prêts d’argent à l’usure, la vente précipitée de pièces essentielles du patrimoine accumulées à l’issue de longues années d’abnégation, d’isolement et de moqueries, les interminables querelles dans la famille, les disputes entre enfants, la trahison anticipée de l’épouse, la perfidie de tant d’autres. Toutes ces morts cauchemardesques qu’Anicet Ekane a épargnées à ses proches, à sa Famille, à ses Enfants, à tous ceux-là qui devraient aujourd’hui raisonnablement le remercier pour son infinie bonté, son élégance sans mesure, sa générosité. Il s’en est allé en effet en spectacularisant sa mort et en la domiciliant dans des geôles, ce qui donne à l’ensemble un caractère d’installation (au sens de l’art contemporain).
On y retrouve ces traits d’une chorégraphie mortuaire, parfaitement christique, de jésus sur le Mont des Oliviers : arrestation expéditive, procès sommaire, preuves inexistantes, acharnement total, corruption morale totale des juges et autres parties prenantes de la captivité, transfert des supplices sur le corps. Il y avait ainsi dans le refus des hiérarques du système de détention de voir alloué un appareil respiratoire approprié, le désir explicitement intentionnel de faire de la douleur un sujet en soi, sur le corps fragilisé de M. Ekane.
C’est d’ailleurs ce que donne à lire Michel Foucault dans son impressionnant « Surveiller et punir » (Gallimard, 1975), l’un des ouvrages les plus fantastiques, les plus extravagants, qu’il m’ait jamais été donné à lire. Où l’on apprend à décrypter – par effet d’analogie – la technologie du corps capturé et défait, que les autorités de Yaoundé ont sciemment instrumentée sur la personne d’Anicet Ekane. Tout avait commencé par ce ramassis de « preuves » ramenées de son domicile, pour donner à établir qu’il préparait un « complot contre la sûreté de l’Etat » : deux Kalachnikovs, deux pistolets, des billets de banque et d’autres broutilles. Tout cela, afin d’établir aux yeux de quelques crédules, en blason, la marque spécifique du crime ou le statut social du criminel.
Dès lors, Anicet Ekane avait été placé en détention pour une garde-à-vue non déterminée dans sa durée ; laquelle devait conduire à sa mort. Une sorte d’exécution clandestine dont la mise en œuvre était théorisée pour atteindre, non seulement la vie dans son essence même, mais aussi, plus prosaïquement, le corps en tant qu’objet de figuration de la déchéance. De façon calculée, un peu comme cela fut sophistiqué en son temps lors des arrestations de Jean-Marie Atangana Mebara et Urbain Olanguena, tous les deux tenus de se coucher sur des matelas dénudés posés à même le sol dans les locaux de la Police judiciaire de Yaoundé, la mort physique devait être précédée par une mort sociale, chorégraphie par des interruptions de soin calculées, démultipliée dans une série d'atermoiements et d’allées et venues inutiles et palabreuses entre la justice, la gendarmerie et les soins médicaux.
A la pleine mesure des horribles descriptions que donne à lire Michel Foucault dans son livre, tout est fait comme si Anicet Ekane avait été – à l’instar des condamnés à mort du 18ème et 19ème siècle en Europe – attaché sur la roue de la potence sociale, puis fouetté jusqu'à l'évanouissement, avant de le suspendre avec des chaînes, et le laisser lentement mourir de faim (dans son cas, de privation d’oxygène). Ce que Michelle Perrot, appelait « la leçon des ténèbres ». Une « bonne mort », parfaitement réussie, demande donc à cet égard la pleine maîtrise technique : il est nécessaire d’avoir un lieu public, les yeux grands ouverts de spectateurs en mesure de témoigner, une dramaturgie, une énergie mortifère, des exécutants et un corps disponible pour l’extinction. Sur ce plan, Anicet Ekane approche le chef-d’œuvre.
Réussir sa mort au plan sorcellaire
C’est connu : chez les Africains – et encore plus chez les Camerounais – on ne meurt jamais pour rien. Chaque mort a donc un coupable, toujours. Chaque mort doit être indexé dans une causalité qui procède de l’imaginaire du mal et de la malveillance qui n’est guère que celui de la sorcellerie. La construction du récit sorcellaire pour ainsi dire procède d’abord d’une temporalité : la nuit. Et d’une modalité d’action : le complot, la manigance. De Personnages aussi, devant incarner le bien et le mal, Dieu et le Diable : celui qui fait du mal et celui qui est la victime.
Aucune mort en Afrique, ne peut être considérée comme « réussie », si elle n’épouse pas et n’épuise pas la totalité de cette cartographie. Dans le cas d’Anicet Ekane, une fois encore, le tableau de la fin des temps.
« Fait social total » pour reprendre à notre compte les mots de Marcel Mauss, la sorcellerie n’en demeure pas moins au cœur d’immenses difficultés définitionnelles, du fait de son ambivalence, relevant à la fois du monde visible et de l’invisible, du jour comme de la nuit, du bien comme du mal. Un principe neutre donc, incertain mais aux conséquences concrètes dans la vie des gens, en ce qu’elle est réputée fonder la puissance, la connaissance de tout être humain et sa capacité à agir, y compris jusqu’à l’extrême. De lui, dépend donc – comme l’explique le chercheur gabonais Tonga – la portée d’un individu à réaliser l’inhabituel, l’exceptionnel, la grandeur comme le péril. Pour Max Weber comme pour Maurice Godelier, le sorcier est cette personne qui se dote, de façon plus ou moins fantasmée, d’éléments de puissance qui, dans la réalité, dépassent l’homme ordinaire.
Ce qui est fascinant dans le phénomène et le raisonnement sorcellaire, c’est qu’il crée une unité de sens, un imaginaire commun, une façon commune de percevoir, analyser et se projeter dans un fait social quelconque. Il donne une forme homogène à ce que le grand sociologue américain Robert Merton appelle le « groupe de référence », défini en tant que « ensemble social auquel un individu se compare, s'identifie ou aspire à appartenir, servant de point de repère pour ses valeurs, normes, attitudes et comportements ».
De par son univocité, la mort – et le soupçon de sorcellerie qu’elle génère automatiquement – en désignant par avance un coupable, subjugue donc les liens familiaux (généralement tumultueux de la vie d’adulte) en leur conférant une unité de circonstance, qui peut réunir des membres éloignés mais aussi désunir beaucoup d’autres. La mort, comme le soupçon ou l’accusation de sorcellerie, peuvent dans ce cas s’afficher comme une modalité de pacification, de redéfinition d’une ligne d’intérêt commune, ne serait-ce que par la détermination d’un ennemi commun, l’exhumation de ce que Philippe d’Iribarne appelle les « peurs primitives ».
Dans le cas d’Anicet Ekane, le « sorcier » est tout trouvé : Paul Atanga Nji. Ce personnage au caractère tempétueux et au regard assombri sous son intense chevelure de danseur disco des années James Brown ou Bee Gees, en direction de qui les regards et l’indignation générale se sont aussitôt tournés. Car, soupçonné plus que d’autres d’avoir « mangé l’âme » de Monsieur Ekane dans la nuit, aux confins d’obscures manigances, et l’orchestration d’une détention de celui qui n’était nulle personne d’autre que son ancien acolyte. La réalisation de l’acte sorcelleraire est en effet indubitablement celui d’une méchanceté qui se nourrit en première ressource de la proximité : on ne peut « manger » que son « frère », sa « sœur », son « père », sa « mère », son « fils » ou sa « fille », ses proches cousins ou neveux ainsi que, bien sûr, ses « amis ». Pas de mise en sacrifice sans l’inextricabilité de ces liens présumément indissolubles car la « victime » ne doit pas soupçonner que le « méchant » puisse le « manger » ou l’« offrir à manger » !
Monsieur Atanga Nji Paul, qui l’a d’ailleurs largement confessé dans une interview télévisée, donnée dix jours après la mort de l’Opposant, était notoirement établi comme « l’ami » de Monsieur Ekane. En langage sorcellaire, il n’y a donc qu’un ami pour « manger » un autre ami, ou – à tout le moins – le « vendre ». Dans ce travail exceptionnel qu’elle a consacré à la lutte indépendantiste au Cameroun sur le couloir 1950-1965, avec pour titre, « Nation of Outlaws » (Ohio University Press, 2014), l’historienne canadienne Meredith Terretta explique de façon magistrale à quel point, justement, l’imaginaire autour de la sorcellerie a joué un rôle fondamental dans la structuration des luttes du maquis et la construction de toute une grammaire anthropologique dont on voit largement les effets aujourd’hui et qui est, chez quasiment tous les Camerounais, la hantise de la « trahison », l’obsessionnel questionnement autour de la loyauté de ceux qui nous entourent et, ainsi, la peur de la malveillance qui me semble être aujourd’hui, au plan culturel, l’une des teintes les plus dominantes.
Paul Atanga Nji donc, figure ministérielle d’autant plus aisée à établir dans cette culpabilité que lui-même s’y est largement facilité la tâche, en multipliant aussi bien avant, pendant qu’après, des déclarations tonitruantes tendant à expliquer, justifier et se gargariser de la détention de l’Homme politique originaire de Douala. Dans la tournée qu’il a aussitôt entreprise dans les régions échaudées peu après la prestation de serment, le Ministre n’a fait l’économie d’aucune déclaration carnassière, ne rechignant jamais à faire ressortir la longueur de ses canines pour impressionner son auditoire avec des formules chaque fois agitant la perspective de la mort à ses contestataires. Dans ce portait de loup-garou ou de panthère (pour en rester à l’univers de la forêt), il n’a plus été nécessaire à aucun des exégètes de la mort d’Anicet Ekane de s’interroger sur cette chaîne causale. C’était bel et bien lui, Paul Atanga Nji, le « sorcier » de la mort de M. Ekane.
Travail d’autant plus rendu aisé que lui-même, comme je l’indiquais ci-haut, est venu s’asseoir tout nu sur la cour du village, afin de se sacrifier au rite de l’explication publique, de la dénégation et de l’expiation du sorcier maudit qui a avalé son « frère » dans la nuit. Comme on le faisait alors pour « enlever la sorcellerie » aux jeunes de mon enfance à Nguelemendouka à la fin des années 80, c’est la presse entière et l’opinion des réseaux sociaux qui est venue se placer dans le dos de Monsieur Atanga Nji afin de le lacérer de tiges de macabo.
Dans la clameur des pleurs qui sortaient alors de sa bouche, ce qu’il a expliqué devant le journaliste Jean Atangana est la chose suivante : il n’est pas nécessaire de m’accuser de la mort d’Anicet Ekane puisque, de son vivant, je l’avais moi-même beaucoup aidé lors de ses épisodes de maladie. Monsieur Atanga Nji Paul a donc essayé d’effectuer ici le retournement de perspective qui appartient au monde forestier de l’évu, et qui stipule que la frontière entre le bien et le mal est, par nature, indéterminée et qu’il est donc tout à fait dans l’ordre de cette métaphysique qu’il soit plutôt du côté du bien et pas tout à fait de celui du mal.
En tout état de cause, Anicet Ekane se dresse sur une mort formidablement réussie. Réussie en ce qu’elle diminue le coût d’accès à l’information sur le sorcier coupable. En faisant de Monsieur Atanga Nji Paul la figure d’incarnation de cette finitude, elle raccourcit les délais, rend explicite la demande de châtiment et tend vers l’horizon le spectre de la vengeance. Pour parfaire le modèle, il est attendu que les membres de la Famille de Monsieur Ekane soient donc, depuis, engagés dans la recherche d’un marabout, d’un guérisseur ou toute autre figure équivalemment sorcellaire, en mesure de « manger » également l’âme du Ministre.
Juste retour des choses, dira-t-on dans cet univers où seul le mal parle au mal, où la maladie se rend coup pour coup avec la maladie, les sortilèges par des gris-gris encore plus redoutables. Possible donc que, par avance, Monsieur Atanga Nji Paul soit déjà allé se « blinder » quelque part, bien que l’on sache de lui ses fréquentations tardives de chapelles catholiques, sans doute parfaitement informé par le peu de clémence avec lequel les Sawas le verront passer devant leurs portes.
Réussir sa mort au plan réputationnel
Le caractère notoirement torturé du parcours de vie, et donc politique de Monsieur Ekane Anicet l’a longtemps placé, de son vivant, sur la lignée des personnages intraçables : marcheur de jour mais manouvrier de nuit, familier de conversations avec des gens qui se détestaient, idées anticoloniales mais art de vivre affiché comme ploutocratique, sobre et en même temps flambeur, discret autant que flamboyant, héroïque sur ses combats passés et dans le même temps perdu dans les méandres sinueux de Douala qui lui conféraient une certaine banalité. Le cœur autant que le cœur de l’homme s’étaient ouverts sur le vivant avec la témérité de ceux qui ont déjà tout vu passer dans une direction puis dans d’autres. Art des mélanges qui en faisait au bout du compte un politicien indéchiffrable, introuvable, illisible, à la fois souple et obstiné, à la fois rugueux dans certaines de ses prises de position mais dans le même temps, d’une affabilité assez extraordinaire.
Dans les faits il était difficile de ne pas aimer cet Homme ou, à tout le moins, difficile de s’engager dans les rangs de ceux qui auraient pu avoir une dent contre lui. Il aimait les gens, ce qui lui est largement rendu aujourd’hui dans la stupeur et le concert de voix unanimement éplorées qui lui rend hommage, partout. De souvenir, il m’est difficile de retrouver – je parle du Cameroun – quelqu’un dans le champ public, positionné plutôt sur les marges, qui ait bénéficié d’un tel halo. La disparition d’Anicet Ekane est, de ce fait, une formidable réussite pour lui-même et pour ses légataires, en ce qu’elle l’établit comme une figure intouchable, absolument romanesque, en bien de choses romantique, presque monastique.
Il n’est pas un seul organe d’information, quel qu’il soit, qui n’ait pas accordé d’importance à ce sujet depuis la date fatidique d’annonce de son décès, pas un groupe de conversation sur infrastructure électronique. Dans la presse internationale, l’émoi a été aussi grand, y compris dans des pays aussi inattendus que l’Allemagne et l’Italie, dont les médias sont, à l’ordinaire en retrait sur ce qui touche à la scène publique de ce pays exportateur de 300 000 tonnes de cacao. En décalque de cette distinction épigonale, le Cameroun s’en est tiré avec une aggravation de son effondrement, l’éparpillement d’une image déjà largement malmenée, détricotée, massacrée.
C’est là l’une des caractéristiques spécifiques que l’on tient de la philosophie antique des Stoïciens et dont le Français Luc Ferry a brillamment rendu compte dans un ouvrage de 2002 intitulé : « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » (Grasset). Où il propose une relecture des principales eschatologies humaines, les grandes directions explicatives par lesquelles Femmes et Hommes de tous les temps ont essayé de résoudre l’indicible équation du salut – donc, de la vie après la mort. Nietzche proposait d’aborder le problème par l’idée (en bien de points, scandaleuse) d’une « mort de Dieu » qui supposait d’établir tout schéma de transcendance sur le désir intense de bien vivre sa vie sur terre et donc, de ne point différer ses attentes dans quelque forme d’illusions. Ainsi, « à coup de marteau » donc comme le recommandait l’Allemand, il faut vivre sa vie comme l’a vécue Anicet Ekane, dans cet « amor fati » qui suggère de ne point se soucier ni du demain et même du qu’en dira-t-on.
Car à la fin, les vivants ont leur vie et les morts la leur. La « vie bonne » est peut-être avant tout, comme le recommandaient les stoïciens de la Grèce antique, de structurer son chemin terrestre sur des bases non nécessairement religieuses mais se destinant à faire de l’humain son unique chemin. Anicet Ekane a également réussi en cela, en parvenant à faire reconnaître à tous ceux qui l’ont connu, même de loin, la force décisive de son choix pour la vie et pour les autres, lui qui avait pourtant été formé dans les sciences sociales et administratives en France et qui aurait largement pu, sur ces seuls atouts, réclamer de bénéficier d’une prépondérance professionnelle dans le champ public, en mesure de rendre justice à ses sacrifices d’adolescence.
Les partis pris qui ont été les siens ont été ceux de la généralité sociale, de la forme d’abstraction qui donne à chaque être une conscience spécifique de son temps, ce que l’intellectuel et ancien Premier ministre tchèque appelait une « quotité morale unique ». Au bout de cette quête, personne ne vous demande si vous avez construit une maison ou laissé des cantines de chemises de marque au fond de votre chambre. Non, ce qui vous est immédiatement reconnu comme une richesse incessible, c’est le fait précisément d’avoir agi sur ce que chacun porte mais que tout le monde ne possède pas : la capacité à faire humain avec les autres et à s’y reconnaître par le vecteur mystique qui fait du vivant la chose unique qu’il est.
Réussir sa mort au plan de la mémoire vivante
Au bout du bout, chacun de nous se bat pour la mémoire, pour sa mémoire, sa capacité à survivre dans le vivant même après sa sortie de la vie. D’abord, selon Spinoza, à tout faire pour nous accrocher à la vie – c’est le principe même du désir de conservation – et, plus sournoisement, à en croire Arthur Schopenhauer, à transmettre de notre souffle de vie alors même que rien n’y incite, au regard du désastre dans lequel se déroulent et s’achèvent la plupart de nos vies. Eu égard au désenchantement et aux nombreuses vexations de ce parcours que nous devrions objectivement être assez nombreux de vouloir quitter au plus vite, le même Schopenhauer se risque à une explication contre-intuitive, mais puissante : malgré le malheur consubstantiellement inhérent à la vie, nous continuons tout de même à nos y accrocher et même à y procréer, ce qui représente selon ses mots un pur acte de folie.
Quelle raison en effet à s’obstiner de transmettre les structures du même malheur que nous vivons et avons vécu, que nos parents et grands-parents ont vécu et dont nous avons que nos enfants eux-mêmes connaîtront les ravages ? Tout simplement, répond l’auteur, parce que nous sommes tous, les uns autant que les autres, pris au même piège sournois : celui de l’amour et du plaisir sexuels, qui corrompent nos âmes et les obligent à fétichiser quelque chose dont tout le monde sait parfaitement, de sa propre expérience, qu’elle ne fonctionne pas. A savoir, la vie. Selon lui, ce ne sont guère que ces deux points de capture émotionnelle, ce qu’il qualifie comme des « ruses de la nature », qui peuvent expliquer que l’on veuille tant perpétuer la vie, de générations en générations, sous le vaniteux prétexte que chacun doit laisser une trace.
Laquelle « trace », aimons-nous à nous convaincre, est intrinsèquement posée sur la tête de nos Enfants, après notre nu passage aux alcôves de la nuit. Après son extinction, le premier témoignage de son vivant est donc celui-là : tous ces mouflets qui respirent et marchent à partir de votre propre sang. Anicet Ekane en avait-il, sur ce rayon ? Peu a jusqu’à présent filtré sur son patrimoine, à cet effet. Personne non plus pour se préoccuper de s’il avait des terrains, des maisons, des voitures, des vêtements de luxe : ces sordides obsessions de notre temps qui justifient largement, dans le cas du Cameroun, qu’environ 40% des ressources publiques du pays soient ouvertement volées annuellement, pas la kleptocratie gouvernante. La grandeur d’Anicet Ekane est-elle pour autant diminuée ? Non, elle en paraît paradoxalement augmentée de par ce quelque chose de distinct qui donnerait à emprunter la catégorie nietzchéenne de « grand style » commune avec le socle existentialiste de Sartre, à savoir, comme il l’expliquait, « tout prendre […] dans un même amour du réel » qui se donne donc comme unique condition pour « se sauver soi-même ».
Anicet Ekane incarnerait donc à sa façon cette radicalité philosophique et existentielle ; celle qui suggère de sublimer la « vie quotidienne », la vie de bohème » et la « vie créative ». Ainsi à travers sa personne, les Camerounais découvrent soudainement – comme déjà, des figures comme Ruben Um Nyobe, Ernest Ouandié, Baba Simon, Jean-Marc Ella, Mongo Béti, Ebousi Boulaga, le Cardinal Tumi – que l’on peut être grand sans être riche de matériel, que l’on peut être célébré à sa mort sans nécessairement l’avoir été de son vivant et que, en fin de compte, seule l’infinie perspective du passage dans l’au-delà permet de situer l’ampleur, la nature et la nécessité des combats que l’on établit aujourd’hui. D’une façon ironique, c’est là un absolutisme qui établit une jonction aussi inattendue que stupéfiante avec le christianisme que, justement, Nietzsche avait abondamment persifflé de son vivant : l’idée d’attendre que seule la mort nous offre l’ultime moment de la félicité et de la reconnaissance.
Pour sûr, Francis Fukuyama qui reprenait dans « La fin de l’histoire » une grande partie des thèses d’Alexandre Kojève, philosophe français d’origine russe, sur les « théories de la reconnaissance » (chantier sur lequel ont également travaillé des auteurs tels que Charles Taylor, Paul Ricoeur et Axel Nonneth, surtout, tous installés sur les épaules originelles de Hegel), serait à contre-courant de ce récit. Dès lors que, pour chacun d’eux, la quête métaphysique fondamentale de chaque humain est d’être reconnu pour la spécificité de ses talents et de ses accomplissements, la distinction de sa vie unique, de son vivant.
C’est cela qui fonde le désir de suprématie sportive, la recherche de distinction artistique, le besoin de différenciation dans l’entrepreneuriat, la culture des objets dont parlait Jacques Baudrillard, celle du capitalisme, la quête du pouvoir et, y compris de sa conservation obsessionnelle au-delà de toute raison, sur une quarantaine d’années. En se portant donc à la tête du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) qu’il fonda avec d’autres, Anicet Ekane s’est garanti l’accès à une portion de reconnaissance qui surclasse aujourd’hui, en termes de résonnance, tout ce qui existe comme appareil politique au Cameroun. Ne comptant guère qu’un seul conseiller municipal, il s’est forgé une position focale lors de la dernière présidentielle, installé comme faiseur de roi, aussi bien pour Monsieur Kamto Maurice que, par la suite, pour Monsieur Tchiroma.
La décision du pouvoir de Yaoundé de le capturer et de le jeter à l’endroit où le trépas a fait son chemin montre bien que, en fin de compte, c’était lui le Grand de l’affaire. Lui, le cerveau, lui, la pièce matricielle. Sa mise à mort n’est pas un acte anodin, un simple incident, mais bel et bien une démarche réfléchie tendant à coucher sur le ventre celui qui refusait de se résigner à l’indignité.
Le Cameroun a donc, pour sûr, perdu l’un de ses meilleurs Fils ; mais il est largement préférable qu’’il s’en soit allé ainsi, dans cette position altière d’Homme debout, et qui aura consacré la partie la plus utile de son chemin à dessiner une empreinte dont l’écho est encore plus massif avec l’évidence de son extinction. Car mourir pour mourir, il aurait été injuste et tout à fait inapproprié que cet Homme s’épuise dans un scénario de dépareillement du corps. Il est parti en nous laissant en mémoire, la meilleure représentation de lui-même, la plus solide. Il est parti en nous offrant pour leçon que la vie ne porte à son utilité suprême et absolue que lorsqu’elle est portée à la projection, à la construction et à l’amour de ce qui est plus grand soi ; cette chose plus grande que soi n’étant en fin de compte que la vie des autres.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
ANICET EKANÉ : ARCHÉOLOGIE D’UNE MORT RÉUSSIE par Serge Alain GODONG
Hommage de la Comicodi à l’honorable Daniel Kalbassou: Un grand commis la nation
ANICET EKANE AU PANTHEON, ATANGA NJI DANS LA POUBELLE DE L'HISTOIRE
Mort tragique d'un ressortissant guinéen à Namur:Le communiqué de l'ambassade de la Guinée
Lettre ouverte à André Onana, Gardien malgré l'Injustice, Par Jean-Claude Mbede Fouda
SOCIETE :: les + lus

26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1023916

Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 560591

Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448060

Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386074

LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 218760

Vidéo de la semaine
évènement