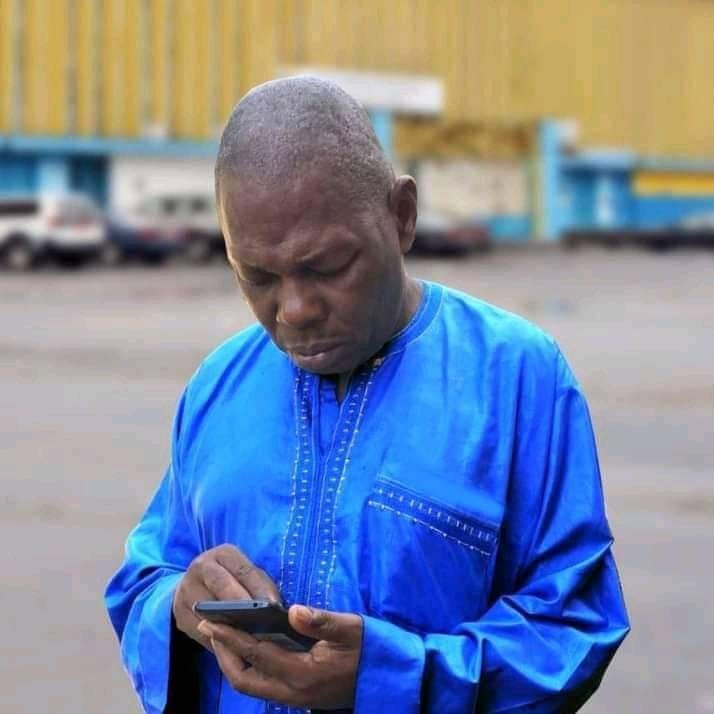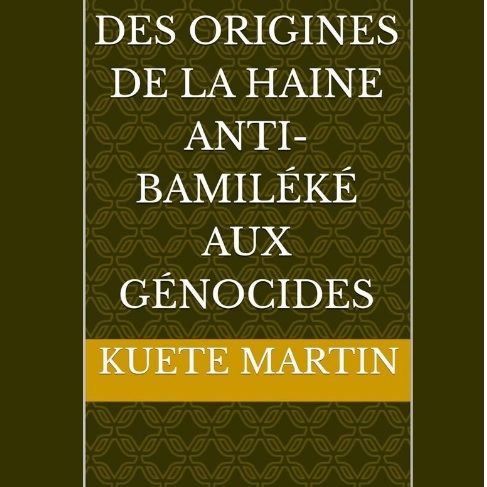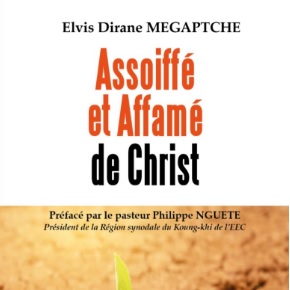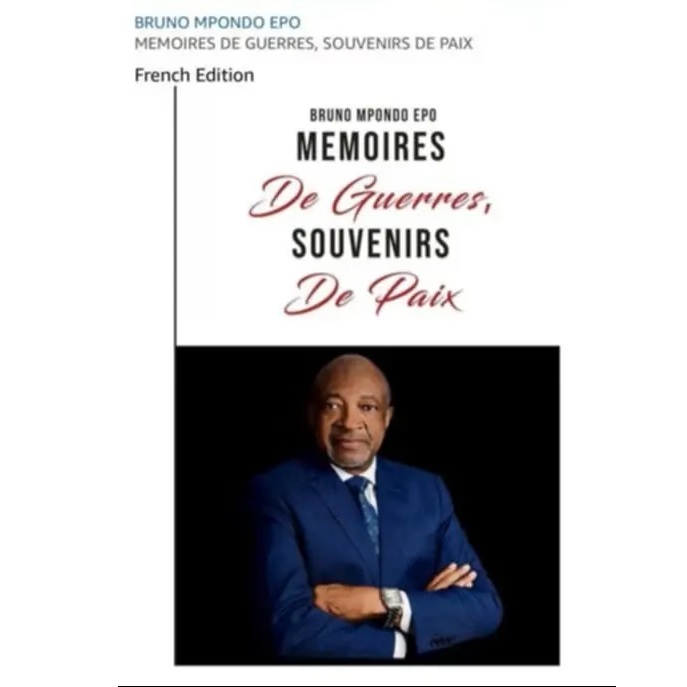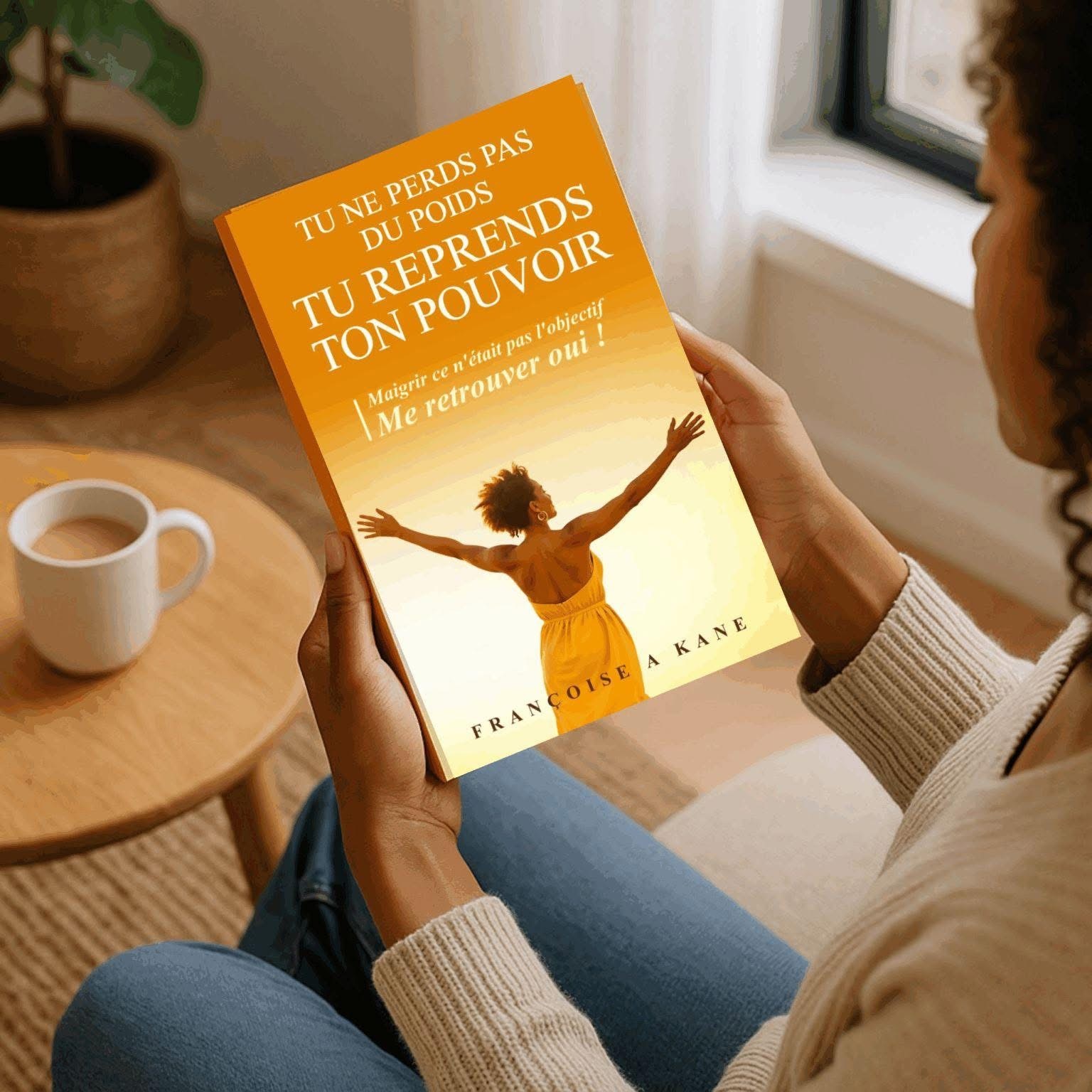-
© Correspondance : Enoh Meyomesse
- 15 May 2017 07:05:18
- |
- 7782
- |
Cameroun, Livre: Et le sang coula à Bonanjo… :: CAMEROON
L’agonie, puis la fin du colonialisme au Cameroun : tel est le sujet de ces chroniques portant sur des événements sanglants s’étant déroulés dans la ville de Douala entre 1945 et 1960, mais aujourd’hui effacés des mémoires…
Extraits.
1- La Rafle.
Chapitre II
Omandéwé était une ville coloniale classique, avec d’un côté un quartier européen, et de l’autre, un quartier indigène, les deux étant bien séparés. Toute l’administration publique était située dans la partie européenne de la ville, interdite d’accès aux indigènes avant 7h du matin, et après 6h du soir. Tout indigène qui y était surpris en dehors de ces heures était jeté en prison, sauf s’il était détenteur d’un « laissez-passer » attestant qu’il logeait chez un Blanc en qualité de boy ou de cuisinier, et habitait sa « dépendance », baraquement séparé de la maison principale.
Cette ségrégation avait été introduite dans le pays par les Allemands, du temps de leur protectorat qui avait duré de 1884 à 1916. Puis les nouveaux maîtres du pays, à savoir les Français, l’avaient reconduit dès 1917, à travers un décret du gouvernement Lucien Fournier. Ce dernier avait justifié sa décision par la nécessité de protéger la communauté blanche des maladies infectieuses dont pullulaient selon lui, les corps des indigènes. Au nombre des maladies dont il voulait épargner les Européens, se situait en bonne place la malaria. Elle opérait des ravages auprès d’eux. Beaucoup d’Européens, en effet, en mouraient.
Mais, les indigènes pour leur part, estimaient que ces maladies n’étaient simplement qu’un prétexte que les Blancs avançaient pour les tenir à distance dans leur propre pays, et leur interdire l’accès à leurs meilleures terres. Les Européens, dans la ville d’Omandéwé avaient, dès l’époque allemande, expulsé les indigènes du plateau Joss, endroit très convoité pour résider dans la ville à cause de la beauté du site, et les avaient obligés à s’installer dans les zones insalubres, généralement marécageuses.
La ségrégation entre Blancs et Noirs à Omandéwé s’étendait à tous les domaines. C’est ainsi que le marché, quoique situé en plein quartier indigène, était interdit d’accès aux Noirs qui désiraient y effectuer des achats avant onze heures. De son ouverture aux environs de huit heures à cette heure-là, seuls étaient autorisés à y accéder les Blancs et leurs épouses, leurs boys munis de laissez-passer, et les indigènes qui y possédaient des étalages. Tout Noir qui ne remplissait pas ces conditions et qui y était surpris avant onze heures était passible de prison.
Dans le quartier européen, la plupart des magasins étaient naturellement interdits d’accès aux Noirs. Tel était le cas de Printania et Monoprix, deux enseignes de renom d’origine française où même les manutentionnaires étaient des Blancs. Seuls les magasins tenus par des Grecs et des Libanais étaient d’accès libre aux indigènes. Les commerçants de ces deux communautés, pour attirer la clientèle noire, les avaient installés à la lisière du quartier européen. Bien mieux, très souvent, ils employaient du personnel indigène à la différence des autres Européens.
Au sein de la communauté blanche à Omandéwé, sévissait également une importante discrimination. Au sommet de la considération se trouvaient les Français, les Américains, les Suisses et les Allemands, bien que ces derniers fussent des mal-aimés par les Français. Venaient ensuite les Grecs, communauté qui s’était infiltrée partout dans le pays, jusque dans les coins les plus reculés, et qui y tenait parfois de toutes petites échoppes. Ils étaient de ce fait considérés un peu comme des indigènes à peau blanche. Les Libanais quant à eux étant des Arabes, étaient ouvertement méprisés par toutes les autres communautés blanches.
Quelques Blancs, davantage de Grecs et de Libanais que des Français et des Allemands, étaient mariés à des femmes indigènes. Naturellement, cela n’était guère bien perçu par les autres blancs. De même ces femmes noires elles-mêmes, les indigènes ne les portaient pas non plus dans leurs cœurs. Ils les considéraient comme des filles de joie, c'est-à-dire de mauvaise moralité.
Omandéwé était doté d’un hôpital et d’un dispensaire. La séparation entre les Européens et les indigènes y était également de rigueur. Les premiers avaient leur pavillon à eux, bien propre avec un lit par chambre et les seconds le leur, également mais insalubre et bondé de monde. Certains malades étaient couchés à même le sol sur des nattes.
Jusque dans les églises et les temples, la séparation entre communautés sévissait. Les Européens avaient leurs offices religieux bien distincts de ceux des indigènes, même lorsque les prêtres ou les pasteurs étaient blancs.
Même régime pour les cimetières. Il en existait pour les Blancs, bien distincts de ceux des Noirs.
Enfin, Omandéwé blanc était doté de belles avenues bien propres, bien fleuries et aux ordures ménagères régulièrement enlevées par le service de voirie municipale. Quant à Omandéwé noir, les chiens écrasés qui pourrissaient à longueur de journée sur la chaussée en dégageant des odeurs pestilentielles étaient le lot quotidien des indigènes. Les masures y étaient généralement en tôles de récupération ou en « karabot », planches de bois blanc peu résistantes.
………………………………………………………………
Chapitre IV
Les voix des miliciens noirs s’élançaient à la cime des arbres tout autour du commissariat de police dans le silence opaque de la nuit. Elles déchiraient insolemment la quiétude de tout Omandéwé blanc et parvenaient dans le même temps à Omandéwé noir où elles semaient la panique.
Elles terrifiaient des pauvres gens dans les masures et ce faisant leurs annonçaient l’arrivée imminente de malheurs.
Elles semaient par avance la mort dans les cœurs de la négraille au plus profond de leurs ventres. Le concert que donnaient dans la nuit ces gorges couleur noir ébène déployées était beau mais en même temps, il n’était rien d’au-tre qu’un macabre chant de guerre des Noirs dirigés par les Blancs contre les Noirs dans la ville d’Omandéwé divisée en deux selon les ra-ces.
Lorsque le chant avait pris fin, Boissonnier avait donné l’ordre aux miliciens noirs de monter par vagues de dix personnes dans le camion qu’Alonzeau avait déjà placé face au portail du commissariat en position de départ. A peine avait-il achevé sa phrase que ceux-ci, habités par la joie de monter dans une automobile s’était rués, on aurait dit un troupeau de bœufs en furie vers le camion, en soulevant de la poussière avec leurs pieds. Tout le monde voulait y monter en premier. La bousculade devint rapidement gigantesque. Les miliciens noirs se montaient dessus, retombaient, se relevaient aussitôt, se laminaient le visage avec leurs ongles, se déchiraient les guenilles, se suspendaient fermement aux corps de ceux qui étaient déjà parvenus, à force de coups de poings, et de pieds, à s’installer à l’intérieur du camion. Ils poussaient des grognements, des hurlements, des cris démentiels. Pourtant, le camion n’allait laisser nul milicien au sol, il allait emporter tout le monde. Mais, personne ne voulait rater cette occasion de monter dans une voiture, qui plus est, gratuitement, cela n’était pas souvent donné aux indigènes de le faire.
Dipita était abasourdi par ce que voyaient ses yeux. Il n’en revenait pas. Lui-même n’avait aucune envie de rater cette occasion merveilleuse de monter une nouvelle fois sans débourser de l’argent dans une automobile, mais il estimait que cela ne pouvait être une raison suffisante de s’étriper ainsi que le faisaient ses compagnons.
Le commissaire Boissonnier, à n’en pas douter, également abasourdi par ce qu’il voyait, s’était mis à aboyer comme il pouvait des ordres, demandant aux Noirs de faire la queue. Peine perdue, il n’était écouté de personne. Il avait finalement vociféré le nom de Bradet, son adjoint. Ce dernier avait accouru. « La chicotte ! », avait hurlé Boissonnier. Sans demander son reste, Bradet était reparti au pas de course dans son bureau et en était aussitôt ressorti une énorme matraque en caoutchouc de couleur noire à la main. Puis, il s’était mis à taper durement sur les miliciens noirs qui se battaient pour accéder au camion. Lui-même, dans sa furie, s’était retrouvé au sol, bousculé et finalement renversé involontairement par les Noirs à qui il était en train de distribuer violemment des coups de matraque. Ceux-ci s’étaient mis à lui marcher sur le corps. Boissonnier, hébété, avait posé les mains sur la tête. Il ne savait plus quoi faire. Son collaborateur était irrémédiablement pla-qué au sol et totalement dans l’impossibilité de se relever. C’est alors qu’il lui vint l’idée de sortir son revolver de son étui, et de tirer plusieurs coups de feu en l’air. Manque de chance pour lui, cela avait eu pour unique effet de centupler la folie de la foule déchaînée qui, prise de panique, s’était alors mise à courir, à qui mieux, dans tous les sens. En un tour de main, il s’était à son tour retrouvé au sol renversé par elle. Il n’avait plus demandé son reste. Plusieurs détonations de son arme avaient de nouveau retenti et le vide s’était rapidement opéré autour de lui. Les policiers indigènes avaient alors finalement, pour ceux qui ne s’y trouvaient pas encore, renoncé à grimper dans le camion et étaient partis se plaquer, tel des poussins à la vue d’un épervier, contre le long du mur de la clôture du commissariat de police.
Boissonnier et Bradet avaient enfin pu se relever. Ils avaient, tous les deux, les vêtements entièrement déchirés, le visage totalement rouge comme des tomates mûres, et le corps tout couvert de poussière. Aux côtés de Boissonnier gisaient plusieurs corps secoués par des spasmes, et qui se raidissaient finalement les uns après les autres. De ceux-ci s’écoulaient lentement des filets de sang…
Chapitre V
— Bon ! Vous avez montré que vous êtes des Nègres une bande de sauvages. Des sau-va-ges. Voilà ce que vous êtes. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Je vous ai dit, dix personnes à la fois, pas un de plus et vous, bande d’abrutis, vous vous êtes tous précipités vers le camion, apeurés à l’idée que celui-ci vous laisserait au sol. Nom de Dieu, nom de Dieu ! Quelle bande d’imbéciles ! Quelle bande d’imbéciles ! Macaques ! Nyakoué des Indes ! C’est pas vrai ça ! C’est pas vrai ça !
Boissonnier fulminait de colère debout devant les corps inertes de ses miliciens noirs, et le reste de la troupe au loin, toujours plaquée le long du mur. Il continuait à tenir son pistolet automatique en main. L’image de ce Blanc debout, entouré des cadavres de ces gens à qui il donnait des ordres il y avait un instant était luciférienne. Il avait, en plus des vêtements déchirés, les cheveux complétement ébouriffés, et arborait un regard mauvais. Des éclairs de rage en jaillissaient. Dipita comme tous les autres Noirs était terrifié. Il tremblait de tout son corps. Son cœur battait fortement dans sa poitrine tel un tambour. Ses mains étaient devenues toutes moites. Une grosse boule douloureuse était venue se loger en travers de son gosier, au point où lorsqu’il avalait la salive et que celle-ci le franchissait, il se produisait un bruit sourd dans ses oreilles.
Boissonnier, de son regard, contrôlait toute la foule. Il avait fini par se taire. Un silence de mort s’était alors installé dans l’enceinte du commissariat. Bradet avait été le premier à rouvrir la bouche.
— Bon ! Ce qui est fait est fait. Il n’est plus question de revenir sur cet incident. (Se tournant vers son patron). Mon commissaire, retournez, s’il vous plait, dans votre bureau. Je prends les choses en main.
…………………………………………………………
2 - La grève.
Chapitre III
Lundi 24 septembre 1945, dès le lever du jour, les cheminots s’étaient de nouveau retrouvés non plus dans les ateliers de la base de Bassaa, mais dans ceux de la gare du port, au bas du quartier Akwa, pour débattre de la poursuite de la grève. La population, au courant du conflit, s’était amassée tout autour d’eux. Elle désirait participer à l’affrontement inévitable entre Blancs et Noirs qui s’annonçait.
― Camarades, merci d’être revenus ici ce matin, ainsi que nous en avions convenu vendredi en nous quittant. Cela prouve à suffisance votre détermination. Je vous entends dire, « ça suffit comme ça », les Blancs nous ont déjà assez maltraités dans notre propre pays. Ça suffit. Eh bien, à partir de ce jour, camarades, ils ne le feront plus. (Manifestation d’approbation parmi les cheminots). Nous ne le leur permettrons plus. Nous ne courberons plus docilement l’échine devant eux comme nous l’avons fait jusqu’à présent. C’est fini, je dis bien, c’est fi-ni ! (Applaudissements nourris des cheminots et des gens venus les assister).
Subitement, la panique s’empara de la foule qui suivait depuis l’extérieur la réunion. La police, conduite par un commissaire blanc, venait de faire irruption dans la gare à bord de plusieurs camionnettes. Ses agents en descendirent au pas de course, matraques en mains, pénétrèrent avec fracas dans le hangar, et immédiatement, encerclèrent les grévistes.
― Vous êtes en état d’arrestation ! Personne ne bouge et pas de faux geste ! Toute résistance est inutile ! aboya le commissaire.
Il eut un flottement de la part des syndicalistes, ne sachant pas d’abord quoi faire. Puis, ils se ressaisirent rapidement, et ripostèrent avec audace.
― Pas question ! Nous avons le droit de grever, conformément à la loi, déclara effrontément leur leader.
Aussitôt, tous les autres se mirent à protester vivement : « pas question ! », « pas question ! », « pas question ! », « pas question ! » dans un brouhaha indescriptible.
L’échange de voix devint immédiatement houleux. Les policiers tentèrent de passer des menottes à quelques grévistes, en vain. Tous les autres s’y opposèrent en bloc, des coups de poings partirent. Une terrible bagarre se déclencha aussitôt entre les agents de police noirs commandés par le commissaire blanc et les cheminots. Les badauds à l’extérieur de la gare ne demandèrent pas mieux, ils se jetèrent dans la bagarre et rapidement, la police se retrouva en difficultés, submergée par le nombre de Noirs contre elle. Elle recourut aux armes. Elle tira sur les grévistes. La foule se dispersa dans un gigantesque sauve-qui-peut général, laissant sur le carreau plusieurs corps.
Une chasse à l’homme sans précédent se déclencha aussitôt à travers les rues des quartiers Bonanjo, du port et Akwa, la police n’opérant plus aucune distinction entre les grévistes et les personnes qui n’étaient pas concernées par la grève. Tout individu de race noire rencontré dans la rue fut bastonné, violenté, brutalisé, indifféremment du sexe ou de l’âge. La furie policière était terrible. Bien plus grave, alors que la population crût n’avoir affaire qu’à la police uniquement, elle découvrit, désemparée, que de nombreux Blancs de la ville avaient sorti leurs carabines, leurs fusils de chasse, leurs revolvers, et lui tiraient dessus, sans sommation. Pis encore, du ciel, un « Broussard », avion de reconnaissance de l’armée coloniale, se mit à voler en rase-mottes en mitraillant la « négraille ». Il avait décollé de l’aéroport de Bonapriso.
Le désarroi de la population atteignit son paroxysme lorsque celle-ci, croyant bien faire, se déporta en masse dans l’enceinte de la cathédrale pour y être protégée par les prêtres blancs. Monumentale erreur : ceux-ci, à leur tour, sortirent leurs carabines et se mirent également à tirer sur les « indigènes ».
………………………………………………
3 – Le couvre-feu.
………………………………………………………….
www.amazon.com, taper Enoh Meyomesse
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LIVRES
Les + récents
Nathalie Moudiki, l'influence informelle au cœur de l'or noir camerounais
Djaili Amadou Amal reçoit la Légion d'Honneur : un prix pour la littérature et les droits des femmes
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577

Vidéo de la semaine
évènement