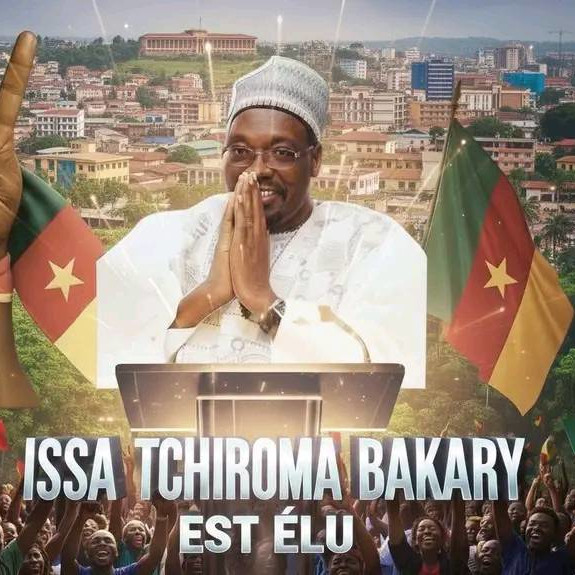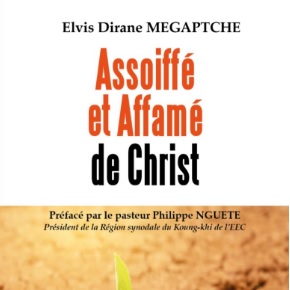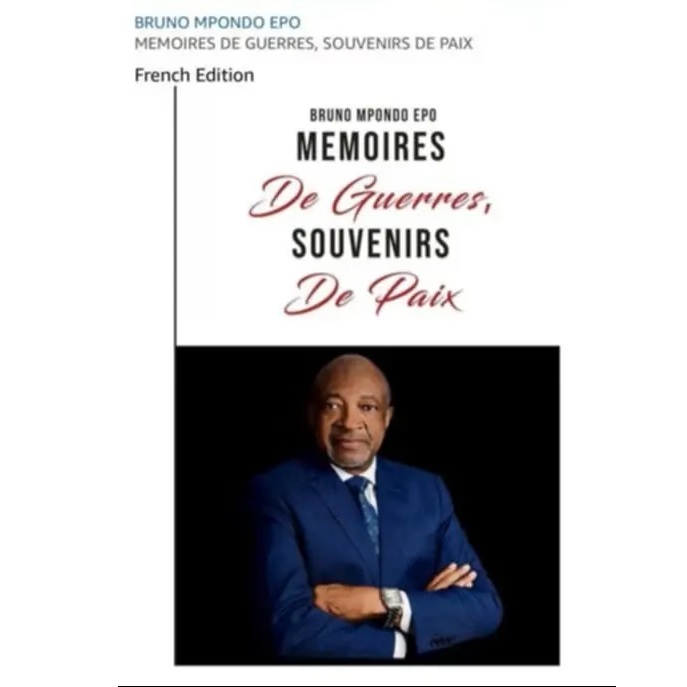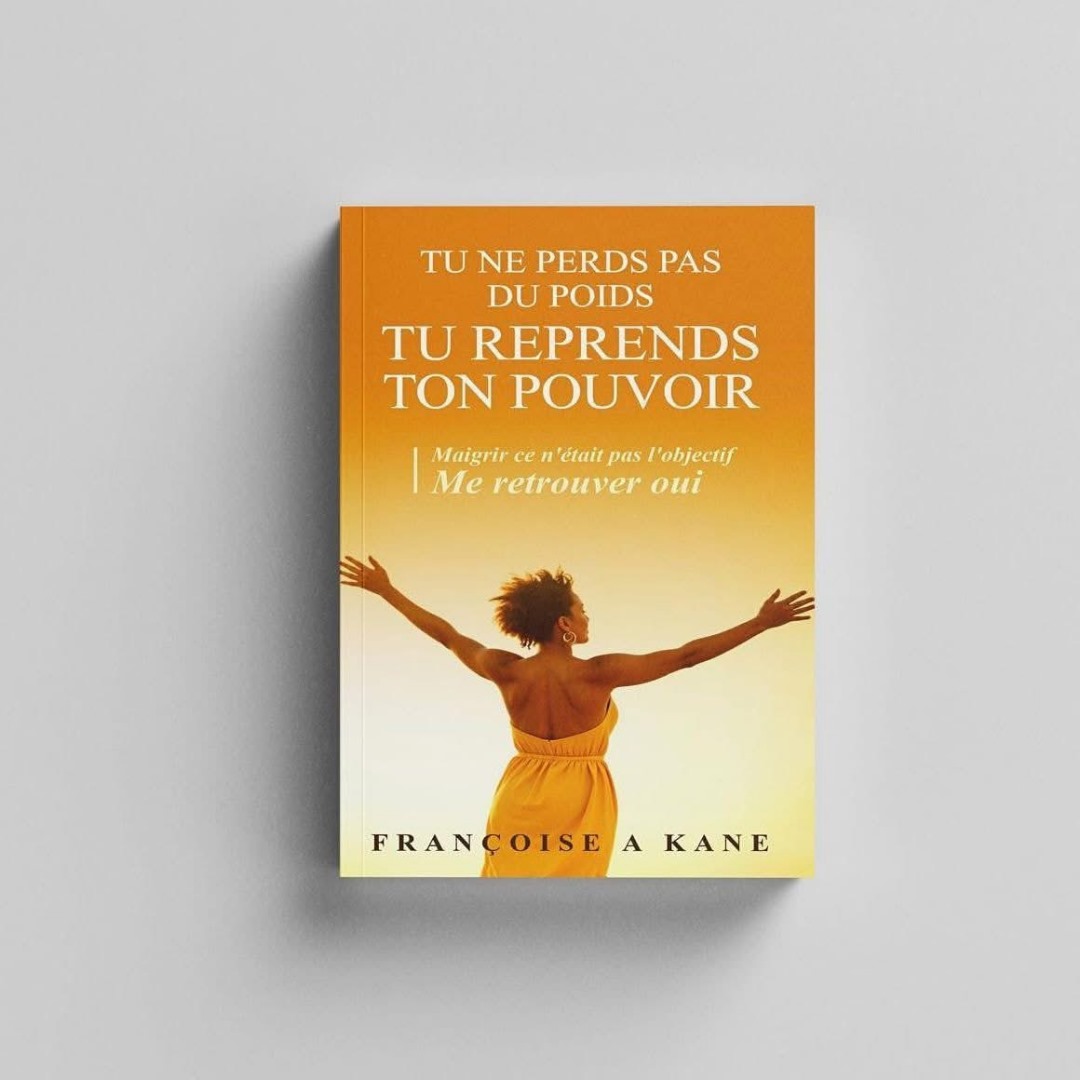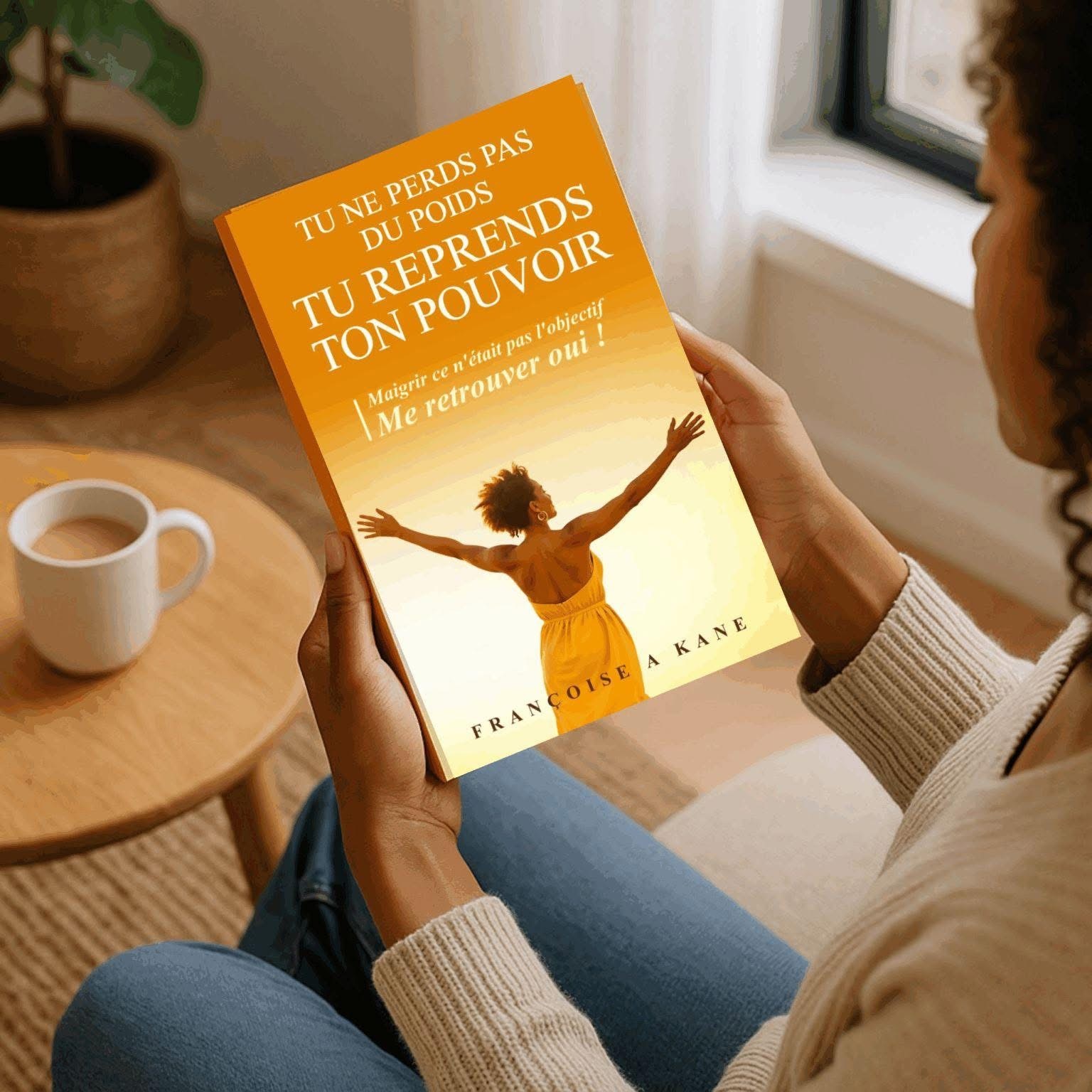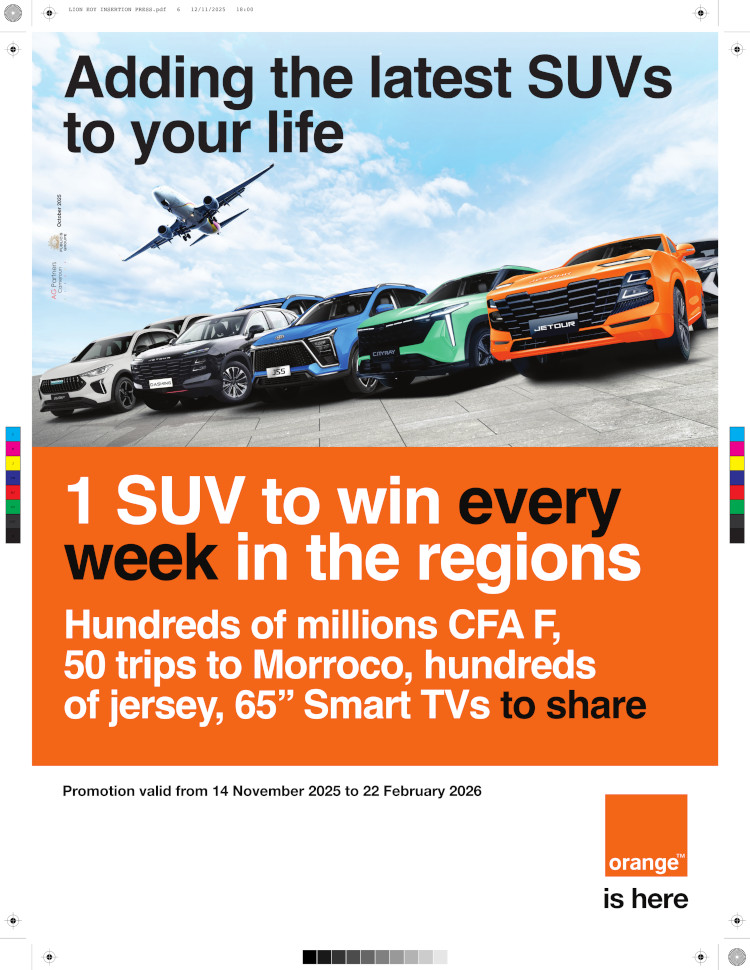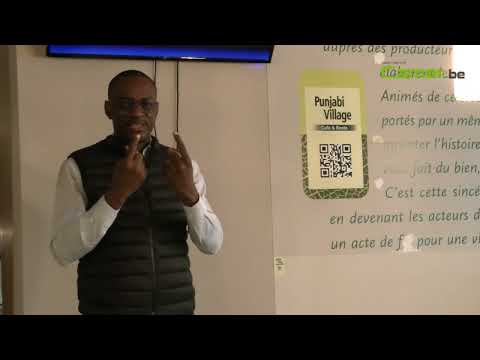-
© Avec l'auteur : La rédaction
- 19 Feb 2019 17:00:00
- |
- 18227
- |
Cameroun, Vient de paraître: "UNE IDEE CONTRAIRE DE LA REPUBLIQUE" de Enoh Meyomesse … :: CAMEROON
Le fondement premier de la république, c’est l’égalité des chances au sein de l’Etat. Même s’il est difficile de la réaliser sur le plan de la fortune, la république s’efforce de le faire néanmoins sur le plan du commandement des citoyens du pays ayant choisi ce type de gouvernement. C’est pourquoi existe l’équation suivante : république = démocratie, et démocratie = république. Il ne se conçoit pas de république dans l’acception authentique du concept, sans démocratie, sans choix des dirigeants par le peuple, et sans possibilité accordée à chaque citoyen de se porter candidat à la direction des autres hommes ( ).
Cette égalité des chances sur le plan politique, en république, part de la formation des hommes. Il faudrait que tous bénéficient de la part de l’Etat, d’une formation intellectuelle autant que possible égale quelle que soit leur origine sociale et leur fortune. C’est pourquoi la république a donné naissance à l’Ecole, à la fois publique et gratuite — un de ses piliers —, étant entendu que l’Ecole privée, dès lors qu’elle est payante, discrimine les gosses des familles démunies.
(...)
L’égalité des chances se traduit d’autre part par l’implantation de l’Ecole publique sur l’ensemble du territoire, que ce soit national ou urbain. C’est la question de la proximité de l’Ecole. Le but est que tous les gosses du pays, quel que soit le lieu de leur résidence, en ville comme en campagne, dans les quartiers riches comme dans les quartiers pauvres, puissent être formés d’égale manière.
L’égalité des chances se traduit enfin par l’ouverture des écoles de formation professionnelle, à tous les enfants du pays, d’égale manière, quelle que soit leur origine sociale, à savoir enfants de riches comme enfants de pauvres. La république bannit ainsi toute discrimination basée sur la fortune, tout comme sur l’origine ou les positions sociales. Elle part de l’égalité des citoyens en son sein.
C’est sur la base de ces principes fondamentaux que la république diffère de la royauté, et, pour ce qui nous concerne au Cameroun, de la chefferie traditionnelle.
……………………………
Chapitre I : Le régime inégalitaire avant 1960.
Le régime colonial était inégalitaire dans les rapports Blancs/Noirs mais instaurait paradoxalement une égalité des chances entre tous les gosses indigènes, c’est-à-dire les gosses des Camerounais, à travers l’école.
A – Les privilégiés du régime colonial.
Le régime colonial, dès lors qu’il ne visait guère à développer le pays, mais plutôt à en tirer le meilleur pour la métropole, ne s’est nullement préoccupé de la réalisation de quelle que justice sociale que ce soit. Bien mieux, il a privilégié une catégorie sociale, au détriment des autres, pour les besoins de sa cause. La société coloniale était ainsi stratifiée :
1/- au sommet : les Blancs, indistinctement de leurs nationalités ;
2/- au milieu : les agents indigènes de l’administration coloniale et les chefs traditionnels, grands collaborateurs de l’administration coloniale (Il importe d’opérer une distinction entre ceux-ci, selon qu’ils étaient du Nord ou du Sud. Ceux du Nord avaient grosso-modo un statut quasi-équivalent à celui des agents indigènes de l’administration coloniale les plus élevés : chefs de districts, sous-préfets, commissaires de police, commandants de brigades de gendarmerie, etc. ; tandis que ceux du Sud étaient tous inférieurs aux agents indigènes de l’administration coloniale) ;
3/- en bas, à savoir en-dessous de tous les Blancs et des agents indigènes de l’administration coloniale : le reste des indigènes.
L’administration coloniale s’appuyant sur les subalternes indigènes pour faire respecter son ordre et sa loi, à savoir, brigadiers de police, gendarmes, moniteurs d’écoles, infirmiers indigènes, greffiers indigènes, personnel administratif divers, elle a été la première à opérer une distinction entre ceux-ci et le reste de la population. Ils étaient gratifiés de nombreux avantages : petits stages réguliers en France, ou en Angleterre. (Les moniteurs de l’enseignement primaire par exemple en « zone française », bénéficiaient régulièrement de « journées pédagogiques » à Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. Le personnel de la Jeunesse et des Sports participait à des « camps de jeunes » en France. Le père de l’auteur de ce livre avait ainsi participé, en 1959, à un de ces camps à Perpignan, dans le Sud de la France, etc.), logement dans des « camps de fonctionnaires » spécialement construits pour eux, à savoir de petites maisonnettes en semi dur comme en dur (- La « Cité Chardy » à Douala a été construite en 1953, pour loger le personnel indigène de l’enseignement primaire, la « Cité des douanes » la même année, pour loger les agents indigènes des douanes ; à Yaoundé le « camp des fonctionnaires de Madagascar », tout comme celui du quartier Dakar ont été construits la même année), et, naturellement, leurs salaires étaient régulièrement payés. Ils étaient soignés avec leurs familles gratuitement dans les hôpitaux, bénéficiaient de « réquisitions » (Titre de transport délivré par l’Etat qui permettait de voyager gratuitement par autocars, par train ou par avion d’une ville à l’autre), pour se déplacer dans la période des congés du lieu de service au village, ou lors des affectations pour rejoindre les nouveaux postes de travail, et n’étaient nullement malmenés par la police et la gendarmerie comme l’étaient le reste des Noirs.
L’Etat avait construit pour ses agents des « cases de passage » à travers le pays, afin qu’ils y logent lorsqu’ils effectuaient des missions hors de leurs villes de résidence. De même, dans chaque unité administrative, chef-lieu de région (préfecture, C’est en 1959 que sont apparus les termes « préfecture », « sous-préfecture », « district », etc. Auparavant, c’était « région » et « subdivision ») et de subdivision, l’administration coloniale avait construit des logements pour chaque service. Il y avait ainsi la « résidence » du chef de région, naturellement, mais également du médecin, du procureur, du commissaire de police, du moniteur agricole, du directeur de l’école, du commandant de brigade de gendarmerie, etc.
Pour tout dire, ils étaient des privilégiés sous le régime colonial. Il n’y avait rien d’équivalent pour le reste des indigènes, qu’ils fussent boys des Blanches ou autres choses. Ceux-ci se débrouillaient comme ils pouvaient pour se loger, payaient les autocars ou le train de leurs poches lorsqu’ils se rendaient en vacances dans leurs villages, etc.
B – Les lésés du régime colonial.
Ce statut de privilégiés qui était celui des agents indigènes de l’administration coloniale reposait sur l’exploitation de la paysannerie. C’est celle-ci qui produisait la richesse coloniale, c’est-à-dire tout l’argent qui circulait dans la colonie, à travers le cacao, le café et le coton qu’elle cultivait. (Ce furent les principales ressources du Cameroun pendant la période coloniale. En 1960, le Cameroun produisait ainsi 30.000 t de cacao, et 10.000 t de café).
La règle d’or du régime colonial était que la colonie ne devait nullement se transformer en charge financière pour la métropole. C’est pourquoi il avait été instauré la douane pour les produits à l’entrée du territoire, ainsi que des impôts et diverses taxes que devaient payer les indigènes. L’argent récolté par ce biais servait au fonctionnement de la colonie : salaires de la totalité du personnel administratif, français comme indigène, construction de routes, hôpitaux, écoles, etc. Il garantissait son autonomie financière.
Mais, en dépit de cela, le régime colonial n’avait envisagé aucun avantage particulier pour la masse paysanne. Elle n’avait construit nul logement pour elle. Elle n’avait rien prévu non plus comme prise en charge en cas de maladie pour celle-ci. Elle ne lui faisait bénéficier que des campagnes de vaccinations qu’elle organisait régulièrement à travers tout le territoire.
Mais, en revanche, l’impôt de capitation, à savoir un impôt que l’on payait simplement parce que l’on existait et vivait dans le pays, s’abattait lourdement sur la paysannerie. Cet impôt constituait une véritable torture pour elle. Les indigènes résidant en campagne étaient régulièrement emprisonnés pour cela, sans oublier les coups de fouets en public qui leur étaient infligés lorsqu’ils ne parvenaient pas à s’en acquitter.
Mais, malgré tout, en matière scolaire, le régime colonial avait instauré l’égalité des chances entre les gosses indigènes. D’une part il avait introduit des bourses scolaires pour ceux-ci, d’autre part, les missionnaires catholiques et protestants accompagnant leur œuvre d’évangélisation d’hôpitaux et d’écoles en campagne, aux côtés des paroisses, compensaient les carences de l’administration coloniale dans le domaine de l’enseignement. Les petits indigènes bénéficiaient ainsi d’un enseignement gratuit, qu’il soit public ou privé, et, bien mieux, non discriminatoire qui les mettait tous sur un même pied d’égalité, fils de chef comme fils d’esclave.
Comme conséquence de cela, la société a connu une grande révolution, un grand bouleversement. Les chefs refusant systématiquement par instinct de conservation d’envoyer leurs gosses à l’école, sans savoir que la société était en pleine mutation, et que c’est l’instruction qui allait, désormais, faire la différence entre les hommes, et non plus le statut à la naissance à savoir, fils de chef ou fils de sujet, les personnes qui ont pris les rênes du pays à la fin du régime colonial, ne provenaient nullement des familles « royales ». Ils étaient des enfants de la plèbe qui avaient été à l’école, pendant que ceux des chefs traditionnels passaient leur temps au village à chasser les moineaux, en attendant tranquillement d’hériter du trône de leurs géniteurs.
En conséquence, avant 1960, traitement inégal des indigènes, mais, égalité des chances pour ceux-ci à travers l’école.
……………….
B – Les « listes » et la « méritocratie régionale »
Sous le Renouveau national camerounais enfin, « l’égalité des chances » a achevé d’être mise à mal, avec l’apparition de « listes » de protégés à chaque concours de la fonction publique ou recrutement. Tous les patrons des grandes administrations du pays en dressent au bénéfice de leurs protégés, sous le prétexte que ceux-ci proviennent de leurs régions natales. Ils abolissent ainsi toute signification du mot concours. L’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature, ENAM, l’Ecole Militaire Interarmes du Cameroun, EMIAC, l’Institut des relations Internationales du Cameroun, IRIC, et bien d’autres écoles de formation de cadres pour le pays, se sont désormais transformées à cause de cette pratique, en écoles des fils des barons du régime au point où si hier l’ENAM était qualifiée « d’Ecole du Nord », aujourd’hui, elle est tout bonnement devenue « l’Ecole des fils à papas », tellement les promotions, d’une année à l’autre, sont truffées de fils de…
Il y a quelques années, lorsqu’avait éclaté le scandale de l’IRIC, les idéologues du régime ont introduit une notion encore plus pernicieuse : « la méritocratie régionale », afin d’échapper aux critiques de la population. Quelle en est la signification ? « Retenir les meilleurs de chaque région du Cameroun ».
En d’autres termes, c’est l’officialisation de l’abolition de « l’égalité des chances nationales ». Une aggravation à ciel ouvert de la négation de l’égalité des chances tout court au Cameroun. Car, cette fois-ci, il ne s’agit même plus de « chances » régionale, mais bel et bien de « fils à papa de chaque région »… Nous assistons de ce fait à un projet de création de dynasties locales qui se coalisent sur le plan national pour régenter le pays tout entier dans les années à venir…
…………………………………..
Introduction
Chapitre I :
Le régime inégalitaire avant 1960
A – Les privilégiés du régime colonial
B – Les lésés du régime colonial
Chapitre II :
L’indépendance et le rôle déterminant des coopérants français
A – Les fonctionnaires : privilégiés de l’indépendance
B – L’enseignement aux mains des Français : promoteur de l’égalité des chances
Chapitre III :
La perversion de l’égalité des chances par le Cameroun indépendant
A – Le discours sur le « retard » des Régions
B – La mise en application de la politique d’égalités des chances régionales
Chapitre IV :
Le Renouveau et la politique de « la méritocratie régionale »
A – L’héritage inégalitaire du régime précédent
B – Les « listes » et la « méritocratie régionale »
Chapitre V :
La République du Cameroun : une confédération de groupes ethniques ?
A – La citoyenneté ethnique
B – Les « ethnies réunifiées » du Cameroun
Chapitre VI :
Revenir à l’égalité des chances pour le bien de tous.
A – L’abolition de la « méritocratie régionale »
B – La « Régionalisation »
Chapitre VII :
Une République nouvelle avec un esprit nouveau
A – La République des gagne-petit et des faibles
B – Une classe dirigeante nouvelle
Pour acquérir le livre : taper www.amazon.fr , ou de., ou com., ou co.uk., etc., puis le titre ou le nom de l’auteur, Enoh Meyomesse, prix : 10 euros.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LIVRES
Les + récents
Le Cameroun célèbre son unité en Amérique du Nord : une conférence de presse réussie pour le CCFNA
Washington se prépare à célébrer la culture camerounaise
La Nuit des Légendes du Makossa : Nanterre au rythme du patrimoine musical camerounais
Drames routiers : 18 morts et 16 blessés en deux jours
Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ?
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 218760

Vidéo de la semaine
évènement