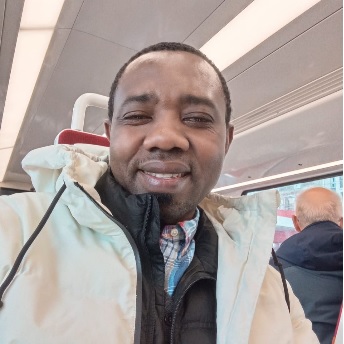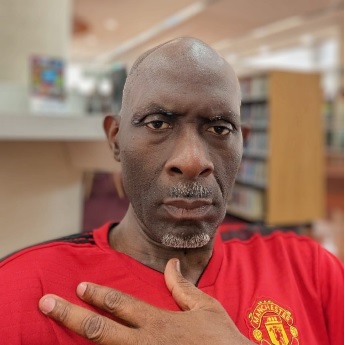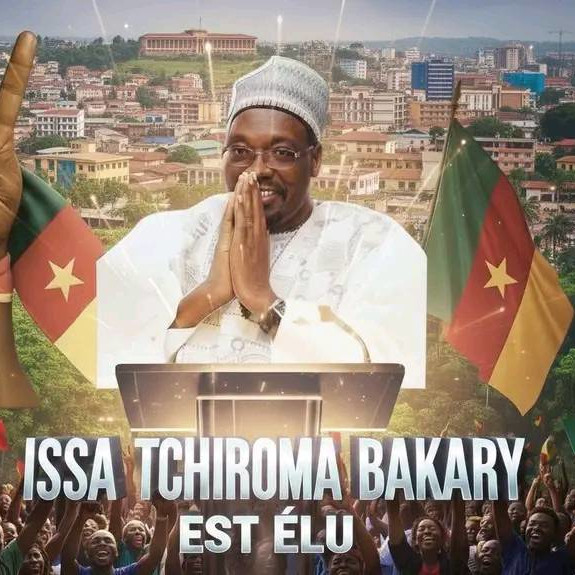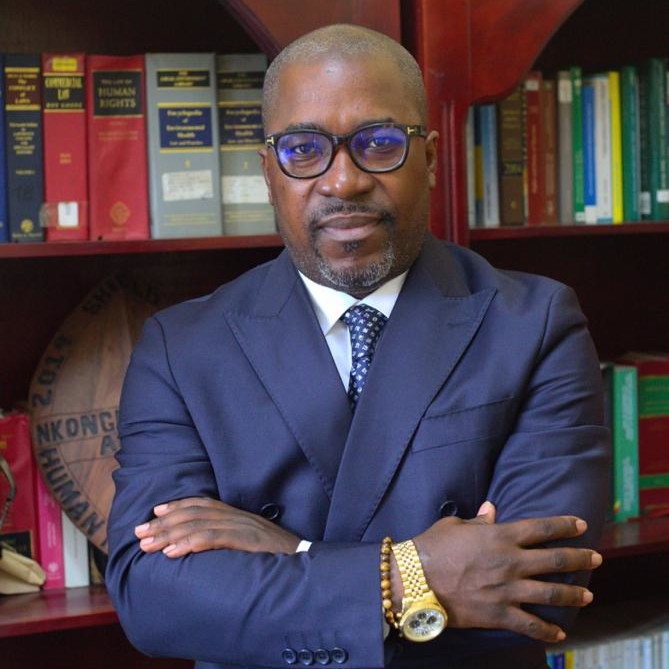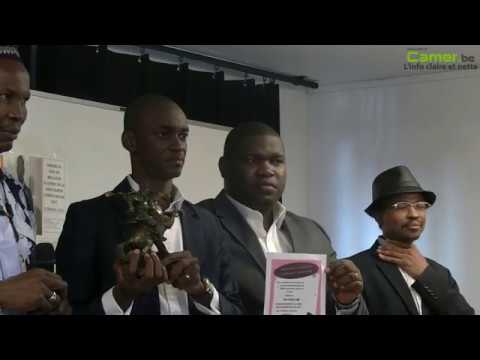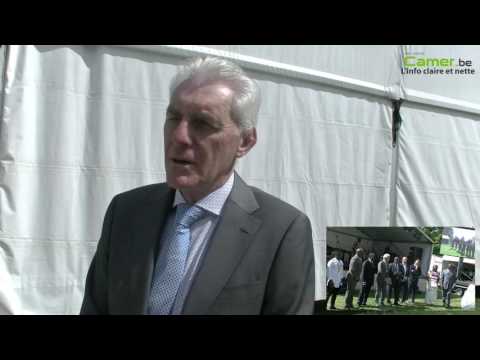-
© rolandtsapi.com : Roland Tsapi
- 08 Sep 2020 11:02:00
- |
- 2786
- |
CAMEROUN :: Droit du sol : qui est chez lui où ? :: CAMEROON
Les mouvements migratoires constituent le fondement de l’occupation des terres dans le monde, et chaque peuple a une histoire, une origine. Les récits de la bible, livre référentiel pour beaucoup, relatent à longueur de pages les histoires des mouvements des peuples et surtout celle du peuple juif, qui aurait même passé 40 ans à errer dans le désert à la recherche de la terre promise. Il finira par s’installer sur un territoire appelé Israël, mais à cause de sa désobéissance envers Dieu, il sera éparpillé dans le monde, torturé par l’Allemagne nazi et le territoire occupé par les Palestiniens. Après la deuxième guerre mondiale, le 15 mai 1948, les nations occidentales décideront de les ramener sur leur territoire d’origine, elles créèrent l’Etat d’Israël où devaient s’installer tous les juifs de retour. Les Palestiniens qui occupaient déjà les lieux n’ont jamais voulu entendre cela de leurs oreilles, ce qui a créé l’éternel conflit israélo-palestinien. Le fond du problème, c’est le droit du sol, à qui appartient cette terre.
Origines lointaines….
Le peuplement camerounais a aussi une histoire, racontée par différents auteurs chacun à sa manière. Une histoire faite de mouvements migratoires, parfois ponctués par des batailles de conquête de l’espace. Chaque village, chaque ethnie a ainsi son histoire à raconter. En nous arrêtant sur la région du Littoral, à ce jour objet de toutes les convoitises pour des raisons économiques, nous avons cette autre version de l’histoire des peuples Duala, racontée par Moïse EKEDI et reprise par le site internet peuplesawa.com. D’après lui, les Douala tirent leur origine de l’Égypte pharaonique vers le début du 4ème siècle avant J-C (3402) et l’ancêtre des Douala s’appellerait Makota. Parti de l’Égypte, le groupe Ewale passe par l’Éthiopie et le Soudan. Venu d’une des régions du Nil, le groupe devait être habitué à vivre à proximité de l’eau et d’espaces à cultiver et voulait vivre dans un environnement similaire. Ses recherches le poussent jusqu’à l’ex Congo Français où le groupe restera plus d’un siècle. Puis, il quitte le Congo et fait escale en Guinée Espagnole (Dikabo) où la progéniture devenant de plus en plus grandissante, de petits groupes se forment par affinités diverses : même famille maternelle, même orientation artisanale ou encore même objectif.
Ainsi, l’ancêtre des Soubou, Kole Mbedi, un pêcheur traverse l’Océan et va pêcher à côté de l’Île Soubou vers Victoria, actuellement Limbé, et ne reviendra plus à Dikabo. Le groupe resté à Dikabo continue son expédition vers l’Est, abandonne l’Atlantique à l’Ouest, contourne Manoka et emprunte la Sanaga. Il s’installe à Piti ; plus tard se déplace pour Long Ngassè actuel, un village où le groupe peut faire ses cultures vivrières ; Ngassè Mbongo y restera. Pour les mêmes raisons qu’à Dikabo le groupe se scinde encore, Dibongo (Malimba) et ses frères remontent le fleuve Sanaga et vont s’implanter tout le long de la Sanaga, Mongomajou, Lobetal, Bonagango, Yasoukou, Pongo Songo…. Les autres prennent Ewale qu’on appellera Douala par déformation sémantique de “du l’ewale” signifiant “est resté seul à du“, l’entrée d’un fleuve là où il se jette. Seul à la rive gauche du fleuve Wouri, Douala personnage à la recherche permanente de son indépendance, s’implantera définitivement de part et d’autre du fleuve avec ses deux grandes principales familles, nous sommes vers la fin du 16ème siècle. Les Bona Dooh se diviseront en deux grandes familles : les Bona Njoh à gauche du fleuve Wouri en aval, les Bonaku (Akwa) et les Bona Ebele (Deido) tous restés à la rive gauche du fleuve Wouri en amont. A partir de là se développeront les familles par générations, elles se doteront d’une organisation et d’un mode de gestion stricte, dont le respect assurait la cohésion et maintenait la paix en tout temps, bien loin des querelles connues de nos jours avec l’introduction des valeurs occidentales.
…et répétitives
L’histoire des Duala et de l’installation sur les terres n’est pas singulière, elle concerne presque tous les peuples du Cameroun. Dans une étude des mouvements migratoires au Cameroun datant de 1978, Jean-Claude Barbier nous renseigne qu’au Nord Cameroun, la plupart des ethnies “païennes” – on en dénombre plus de trente – sont nées de la rencontre au sein d’une même zone de micro-groupes en migration fuyant devant les razzias menées par les grands empires tchadiens musulmans (Kanem, Bornu, Baguirmi). Certaines d’entre elles étaient constituées depuis peu de temps, lorsqu’à la fin du 18ème siècle, les premiers Fulbé, venant du Bornu, pénétrèrent au Nord du Cameroun. Une meilleure connaissance de l’Ouest du Cameroun, révèle également l’importance des mouvements migratoires qui aboutirent à l’occupation des plateaux de l’Ouest. Dans la partie Centre et Sud du Cameroun, des rapports sociaux fondamentaux se sont noués lors du commerce de traite qui sévissait sur la côte et qui incluait d’autres produits que les seuls esclaves : notamment ivoire et huile de palme. Ce contexte économique a déclenché des mouvements de population de grande ampleur en direction de la côte des tribus dynamiques qui cherchaient à se situer comme “courtières”, à l’exemple des Fang, Duala), des conflits pour le contrôle des pistes et des lieux d’échanges des produits de traite comme à Yabassi, le refoulement des tribus de l’intérieur lors de l’apogée du trafic esclavagiste, entre le 17ème et le 18ème siècle. Les histoires des peuplades, on peut ainsi en raconter dans les livres.
A qui le tour ?
D’où venons-nous donc en définitive, à qui appartient le sol où nous sommes installés, avons-nous la certitude que personne n’y vivait avant nous, si non sommes certains que les droits de ces premiers occupants ont toujours été respectés, n’ont-ils pas par hasard été soumis et fait esclaves, pour que leurs descendants disparaissent ensuite purement et simplement, sommes-nous sûrs que demain un autre groupe ne viendra pas nous envahir et effacer complètement nos traces, vaut-il la peine de s’entretuer pour des terres et des titres que nous n’emporterons jamais ? Ces questions et bien d’autres méritent amplement d’être posées aujourd’hui, où le repli identitaire est devenu une véritable menace pour la cohésion sociale. En définitive il ne faut pas oublier que l’auteur du livre des Proverbes dans la bible ne cessait de répéter comme un refrain : « vanité des vanités…tout est vanité. »
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"
Paul Biya fête 93 ans : 43 ans de règne et un Cameroun à bout de souffle
Biya à la jeunesse : ce que j’en pense
POINT DE VUE :: les + lus





Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 106332
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 227663

Vidéo de la semaine
évènement