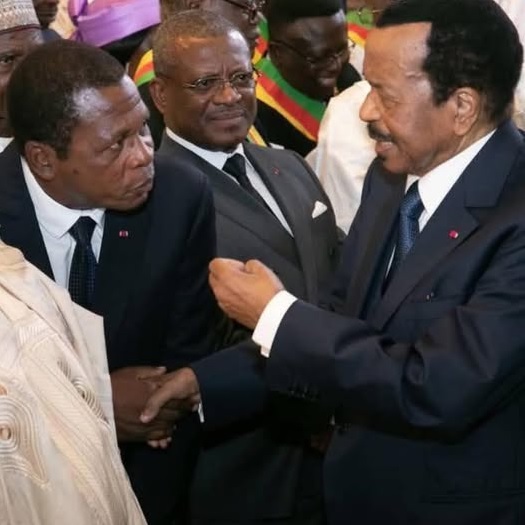-
© Correspondance : Guillaume-Henri NGNEPI, Philosophe
- 04 Jan 2018 12:09:32
- |
- 6124
- |
Cameroun: CONTRE LE DELIT D'OPINION :: CAMEROON
Agonir d’injures, diffamer, ou de mort, menacer quiconque, et à plus forte raison quiconque exerce une fonction à l’utilité commune solidement établie, cela, comme de juste, n’est certainement pas légal. Mais quand on a pu s’y employer déjà, le pire, convenons-en sans peine, est encore à venir, et c’est de passer à l’acte en commettant, par exemple, l’homicide à la menace agitée. Et dans la mesure où la menace n’est, de nul effet suivie, on peut dire que l’épouvantail de la mort est, et n’est agité que pour exorciser et répudier l’administration de la mort : le tueur véritable ne menace pas de tuer, il tue ; son projet formé, il ne l’annonce pas, il l’exécute et la réclame s’en fait seulement après coup, pour semer alentour une vague de psychose et de terreur, d’ailleurs propice au prochain meurtre qui, comme le précédent, prendra de court les prévisions les plus savantes. Qui donc parle de tuer, en parle pour ne pas avoir à le faire. A moins que ce ne soit parce qu’il n’est pas en état de pouvoir s’y employer. Ce qui, on en conviendra sans peine, n’est préjudiciable à personne : ni pour la personne menacée qui, ma foi, se porte comme un charme malgré la menace ; ni pour celle qui profère la menace, car au moins échappe-t-elle, malgré elle peut-être, voire à son insu, au flagrant délit et à ses éventuelles turpitudes judiciaires et pénales ; ni même pour la Totalité sociale dont la prison, souvent, est déjà l’expression de la bonne conscience tant elle regorge de gens qu’une institution judiciaire submergée y expédie, simplement en attendant d’y voir plus clair, et souvent par erreur, mais impunément.
Pas légal déjà, il n’est non plus guère légitime de mettre à mort : aussi supprime-t-on la peine capitale de ci, de là, de par le monde – au fait, à quand, son abolition, chez-nous ? Ce qui donne à penser que dans la relation aux Autres, bien moins que dans la tête, la plume et les mots, le seuil à ne pas franchir relève de l’ordre du factuel : on peut dans sa tête ou dans les mots, tuer le monde entier, et même s’y prendre à plusieurs reprises ; ce sera toujours mieux que si l’on était réellement passé à l’acte concret du meurtre collectif, du crime de masse, du génocide. Ou même, simplement, de l’homicide individuel.
Punir par prévention
Certes, le droit positif impute à délit la menace de mort pourtant simplement portée par l’esprit et les mots. Son credo en la matière semble être que de la menace à sa mise à exécution il n’y a pas loin, et sévir servirait donc à empêcher le passage à l’acte, ou bien à tenter d’en dissuader. Sans préjudice de l’efficience du procédé, une question tout fait à part, subordonnée à d’autres qui lui sont préjudicielles, en ce sens que l’efficace, sans se résorber dans les seuls mots ne se résout pas davantage dans le seul rapport de force, et ressortit en outre au registre de l’hégémonie qui fait fond sur le consentement : si l’impunité, souvent, décuple le délit, ce qui, dans la sanction l’amenuise, ce n’est pas la punition en tant qu’elle use de la force nue, mitraille ou contrainte, qu’importe : seulement sa propriété réparatrice, qui n’a que faire d’un climat de force, et suppose, en revanche, des rapports sociaux empreints d’humanité, c’est-à-dire, à tout le moins, de respect, pas d’obséquiosité, même et surtout quand on n’est pas d’accord avec les Autres.
Qui, dès lors, ne perçoit la connivence entre les deux postures que voici : dans l’une, on parle pour n’avoir pas à agir ; dans l’autre, on s’empresse d’agir, de peur de voir les mots prendre corps sous forme de maux, et l’on administre donc un mal pour en conjurer un autre : un, pour de vrai, mais uniquement pour en prévenir un autre, plutôt virtuel, ou qu’on juge potentiel. Dans l’une, on administrait la mort en pensée et en mots, une belle mort faite symboles sonores et graphiques ; dans l’autre, on s’autorise de la défense d’un présumé offensé ou diffamé censé être le Président de la République, pour faire, contre le présumé offenseur, ce qu’il est accusé d’avoir fait contre le Président de la République : dans l’un et l’autre cas, on plaide contre une personne et une fonction ; on fait une fixation sur le ‘’Qui’’, c’est-à-dire, sur la question de personne : au ‘’comment peut-on être Chef de l’Etat sans l’être à ma satisfaction !?’’, qui résume le point de vue de l’écrivain, répond le ‘’comment oser parler ainsi d’Untel, quand, de surcroît, on met en avant sa qualité propre de professionnel de la plume ?’’ qui récapitule la position des contradicteurs de l’écrivain, lesquels semblent avoir pour eux, la lettre du droit positif.
Rémanence de l’obscurantisme
L’insidieuse connivence entre partisans et adversaires du mis en cause qu’est l’écrivain est bien plus manifeste encore en ceci : ni les uns, ni les autres n’interrogent en direction de l’enjeu véritable de ce qu’il semble convenu de nommer ‘’l’affaire Patrice Nganang’’, lequel ne peut se trouver qu’en répondant à la question suivante : s’il y a délit, comment est-il possible, c’est-à-dire possible en toute objectivité ? Établir à proprement parler le délit, c’est en expliciter les motifs et mobiles, en déterminer les causes, de sorte à en saisir la nécessité et la prévisibilité, autant que les conditions de possibilité dans lesquelles la récidive ne serait pas réalisable. Au lieu de quoi, on appréhende le mis en cause, et fait contre sa personne le mal (privation de liberté) que ses mots n’ont pas occasionné sur la personne du Président de la République. Ni même à son image dans l’opinion, celle-ci n’ayant pas fait chorus aux propos du mis en cause sur le Président de la République – dont la réputation n’est, de la sorte, en rien écornée. Ce qui signifie qu’au-delà des individus qui, seuls auront retenu l’attention, se profile un enjeu autrement important : celui de l’examen critique de notre système judiciaire attentif à protéger les fonctions élevées et leurs détenteurs, non sans raison, certes, et en vertu, par exemple, du principe de leur utilité commune, publique ; mais tendanciellement porté à sonner l’hallali sitôt qu’un individu, qui ne représente guère que lui-même pourtant, exprime son désaccord, son désamour, son dépit, son amertume, sa colère ou son sarcasme, autant d’indices, parfois, de sa propre déréliction qui, ailleurs, susciterait, plutôt que l’hostilité, la compassion, et l’interrogation sur les mésaventures et les fondements du vivre-ensemble.
Ce que recèle et reproduit avec l’onction du Droit le vice ainsi détecté au cœur de notre système judiciaire, c’est proprement notre gestion collectivement calamiteuse du désaccord : notre incapacité de nous y employer sereinement ; notre propension et notre promptitude à la dispute en lieu et place de la discussion ; notre spontanéité à nous installer dans l’escalade de la violence, celle de la praxis comme de la lexis, la mitraille comme le verbe ; ce qui montre que chez-nous, souvent, recourir au langage, ce n’est point renoncer à la violence : seulement en user autrement. Longtemps, on a géré le désaccord en sectionnant, par centaines, des têtes à ras de tronc ; puis, moyennant le contrôle préalable des textes destinés à l’impression et à la diffusion, en censurant, caviardant des écrits, bâillonnant leurs auteur(e)s, les persécutant, et s’il se pouvait, les jetant en prison au terme de jugements expéditifs, ou les acculant à l’exil, y compris dans leur propre pays, sous forme d’ostracisme. Il n’est pas évident, je le crains, que les démons de ces pratiques soient tout à fait exorcisés. Il est même à craindre que nous en vivions bien plus que quelque banal effet de rémanence. Preuve, non pas du trop de démocratie comme l’entendent certains, pas davantage du trop peu comme rétorque l’opinion adverse, mais du pas assez, et même d’une erreur d’aiguillage surtout : comment en effet démocratiser sans s’atteler à construire la figure du démocrate de base qu’est le Citoyen? Sans fixer des limites expresses à l’expansion tendancielle du pouvoir d’Etat, sans ériger en paradigmes les principes d’isonomie et d’iségorie, au mépris désinvolte de l’avertissement suivant d’un Alain qui disait : « Il n’est point d’homme au monde qui, pouvant tout et sans contrôle, ne sacrifie la justice à ses passions » ?
On se retrouve, en effet, traquant jusqu’à la mort non pas administrée de fait, mais envisagée en pensée et en paroles ; non pas ourdie dans une cabale avec ses secrets et ses protagonistes, mais déclamée, comme imprécation ou déprécation, qu’importe : la mort mise en mots, mais point traduite en maux. Ce qui revient à ambitionner de contrôler la Totalité des espaces sociaux et humains, le réel comme l’imaginaire. En indiquant ce qui doit en être proscrit ;ce qui est une certaine façon de prescrire non seulement ce à quoi il faut penser, mais encore et surtout ce qu’il faut en penser.
Cette démarche s’autorise d’une double logique : d’abord celle de la protection, non pas tant de la Totalité sociale et du Droit que du Chef ; ensuite celle de la dangerosité de telle conduite ou telle autre, non pas tant envers le Corps social qu’envers la personne du Chef, individu incarnant une fonction à l’Utilité commune indiscutable, certes, et néanmoins individu, mais individu spécifique, à part. Cette double logique autorise, en conséquence, la mise du Droit au service non pas tant de l’Universel que du Particulier. Une fois la Loi ainsi devenue serve, ne peut qu’apparaître le caractère éminemment subjectif de l’appréciation de la dangerosité d’une conduite, celle par exemple du mis en cause : elle serait dangereuse en raison de la haute fonction du diffamé, du menacé de mort, mais pas mis à mort ! Il faudrait donc sanctionner, punir pour cette raison. Mais, réfléchissons un peu : punir cependant, est-ce réparer le dommage, en l’occurrence, à en supposer un qui ne soit pas seulement abstraitement énoncé dans le Droit, mais actualisé ?
Mais il est significatif que le droit positif qui, en toute légalité, autorise de sévir par prévention, prévoie une place et fasse jouer un rôle à l’Avocat de la Défense : c’est l’aveu tacite de la conscience et de la reconnaissance de ses propres limites. L’existence de l’avocat en effet signifie que rien n’est sacré, tout est relatif, en ce sens que tout peut être appréhendé diversement : si de la lecture du Droit et de la reddition de la justice il n’y avait que la version du Procureur, l’univers judiciaire deviendrait le Royaume ou l’Empire du Sacré. Relèverait de l’ordre du Sacrilège ou du Blasphème tout autre propos que le sien. Seulement voilà, l’Avocat existe : s’impose, en conséquence, la nécessité de l’examen contradictoire qui repose sur le fondement suivant : atténuer, non pas la rigueur, mais seulement la rigidité, forcément obtuse, de la Loi, par la prise en compte de l’exigence de proportionnalité entre le dommage commis et la peine encourue ; ce qui suppose qu’on explore les faubourgs de l’acte incriminé : cela signifie, non pas se saisir de la personne d’un malfaiteur présumé, mais établir la facticité de ses méfaits, leur sens et leur valeur qui ne sont jamais de banals donnés s’offrant à notre observation passive, mais toujours des constructions. Quel peut bien en être l’enjeu pour la Totalité sociale ? Rapporter des faits, par goût immodéré de l’anecdote et par souci de coller simplement, autant que possible, à la Lettre du Droit ? Certainement pas : le Droit, quel qu’il soit, si progressiste même puisse-t-il sembler, est toujours par ailleurs diversement controversé. A juste titre : c’est la rançon du progrès, le prix à payer pour ne pas confiner le Droit au statut d’une banale codification de ce qu’il peut y avoir de plus misonéiste dans nos conduites réelles.
Lettre et Esprit
Plutôt que la Lettre, c’est donc l’Esprit de la Loi qu’il faut préserver. Or, quel est-il, chez-nous, aujourd’hui ?Il est perceptible dans l’arborescence des droits divers tels que notre Histoire pratique la déploie. Pas seulement cette Histoire telle qu’elle nous apparaît à nous, mais bien telle que les Autres aussi ont pu l’appréhender : ce n’est pas un hasard si en 1941, signée de Churchill et de Roosevelt la Charte de l’Atlantique reconnaît aux Peuples colonisés le droit à la libre-disposition d’eux-mêmes. Avancée indéniable, tout à la fois pratique, car historique, et théorique : la Grande Révolution, c’est-à-dire la révolution bourgeoise de 1789 en France avait consacré les droits de l’Homme et du Citoyen, en établissant que dans la société politique, le respect des droits de l’homme suppose la reconnaissance et le respect préalable de ceux du citoyen ; que ce sont donc les droits du citoyen qui garantissent le respect des droits de l’homme ; ce qui n’est possible qu’à la faveur d’une certaine forme d’organisation du Pouvoir politique, à savoir la Démocratie. La Charte de l’Atlantique, qui n’a échappé ni à l’attention, ni au commentaire explicatif de Ruben Um Nyobè, innove en ceci qu’elle nous fait passer des droits individuels à ceux des Peuples ; ce qui, déjà reflète la situation historique réelle des colonisés ; ce qui surtout revêt un sens qu’une philosophe comme Hannah Arendt met en lumière dans son livre sur L’Impérialisme. L’auteure, en effet, bien mieux que la corrélation, souligne l’identité entre droits de l’homme et droits des peuples dans l’Histoire pratique moderne, après la révolution bourgeoise. Le passage de l’individu aux peuples s’explique en raison de la prégnance de la question de l’émancipation nationale. Ce qui signifie que pour que l’individu soit à l’abri des abus du pouvoir politique, il faut que soient émancipés les peuples. Il y a là le fondement du caractère ‘’inaliénable’’ des droits de l’homme, qui procède de ce qu’ils sont supposés indépendants de tout gouvernement : les droits de l’homme en effet sont des libertés qui, exercées dans le cadre des droits civils, permettent de soustraire à l’emprise du pouvoir politique la conduite de l’existence individuelle, privée ; tandis que les droits du citoyen sont des pouvoirs qui s’occupent des droits publics ou droits politiques, et permettent, au contraire, de participer au pouvoir politique, à la marche des affaires publiques, en vertu du principe de la non-existence de l’apolitisme, et de l’existence de l’engagement compris non pas comme un devoir auquel il est possible de se dérober à volonté, mais comme un fait qui est toujours déjà là, et dont le devoir consiste simplement à tirer les conséquences, en commençant par prendre conscience du sens de son propre engagement. Prendre part à la chose publique, en votant sans doute, mais auparavant, en définissant l’orientation à imprimer au cours du monde, les assises sociales du pouvoir, sa forme peut-être mais sa nature surtout, laquelle ne se décline guère que de deux façons, comme serf ou comme souverain par rapport à quelque puissance externe. Cela dit, il faut aux peuples, une institution qui garantisse leurs droits de peuples, de citoyens, d’hommes, et une autorité qui les protège ; ce qui ne peut être qu’ un gouvernement bien à eux, propre à eux, attaché non pas à résoudre leurs problèmes à leur place et sans eux, donc contre eux, mais à les poser avec eux, et à créer les conditions propices à l’examen public et libre desdits problèmes.
Voilà pourquoi les peuples comme les individus sont fondés à exiger des comptes aux gouvernants, et ceux-ci, tenus à la redevabilité, tenus de s’expliquer sur leur conduite des affaires publiques. Qu’ils en portent la responsabilité signifie qu’ils doivent en répondre, en rendre compte au peuple des gouvernés, et non pas à quelque puissance étrangère, en assumer les conséquences. Les révolutionnaires de 1789 avaient même constitutionnalisé le droit à la révolte, leur idée étant que l’individu, ni les peuples n’ont pas à s’astreindre au respect de lois que les gouvernants, qui les prennent, ne respectent pas eux-mêmes. Cette thèse, qui n’est encore qu’un droit à l’Article 2 de la Déclaration de 1789, devient même un devoir à l’Article 35 de la mouture imprimée à cette Déclaration en 1793.
Il n’est pas anodin qu’en 1948 la Déclaration des droits de l’homme « et du citoyen » ait été tronquée et soit devenue Déclaration « universelle des droits de l’homme », sans plus : sans plus de référence à la citoyenneté : la Bourgeoisie n’est plus alors la classe montante qu’elle a été au long des 17è et 18è siècles, mais une classe triomphante, oublieuse de ses racines, et désormais agrippée à la défense de ses seuls intérêts, au mépris des principes qui les fondent, notamment dans les colonies, où elle n’a nul intérêt à promouvoir le citoyen dont elle a autrefois conquis le statut contre la Noblesse, l’Aristocratie.
Nous payons à ce jour encore, au prix fort, cette élision : en caviardant le concept de citoyen, on lui a substitué celui de membre d’une tribu sous lequel on a accoutumé de nous saisir, et par lequel on croit pouvoir rendre compte de notre histoire pratique, mais à tort, et du reste en vain.
L’Esprit de la Loi, chez-nous, aujourd’hui, consiste à rétablir le cours véridique de notre Histoire pratique : en sortant du colonialisme, nous n’avions pas à devenir des membres de tribus, mais des citoyens. L’enjeu de nos luttes actuelles est donc, au bas mot, la promotion du citoyen comme individu qui n’est pas tel du seul fait de l’économie monétaire et de l’instruction reçue à l’Ecole de type occidental qui, l’une et l’autre, le détachent du groupe qu’est l’ethnie ; mais l’individu doit, aujourd’hui être, en outre, institué par le Droit, et dans le Droit, comme parcelle de souveraineté, et par suite, comme la limite opposée à l’expansion tendancielle du pouvoir d’Etat, ainsi que l’avaient bien vu les révolutionnaires de 1789. Nous peinons à retrouver le sentiment national, patriotique qui, hier nous a menés sur le chemin de la libre-disposition de nous-mêmes sous la conduite des Ruben Um Nyobè, et nous peinons bien davantage encore à réaliser notre Unité continentale parce que l’Individu, sujet de Droits, n’existe pas : le Citoyen en effet est, hier comme aujourd’hui, le plus court chemin
vers la Nation comme vers le Continent parce qu’il est déjà ce qui s’exhausse au-dessus de la Tribu, et le vecteur d’un espace de transcendance. L’Individu, pas l’individualisme, évidemment. S’il n’est collectivement institué, nous sommes tous perdus. Et si envers lui le milieu politique reste étouffant et dissolvant, il ne sera guère étonnant qu’il tente de s’auto-instituer, y compris par cette sorte de révolte lexicographique, langagière, verbale ou imprimée, avec ses démesures éventuelles, qu’on peut surprendre sous une plume, ou sur des lèvres, mais qui, tout bien considéré, n’appelle pas, au premier chef, la mitraille, la pendaison, le cachot ou quelque autre modalité de la répression, ne nous en déplaise. Sauf à consacrer et instituer, tout à la fois contre la Démocratie et surtout contre la République, le Délit d’opinion : si, de fait, la Démocratie donne la parole à la multitude, la République ne s’inquiète pas de l’usage qu’elle en fait : seulement de la manière dont elle acquière ses croyances, ses sentiments et ses pensées, l’enjeu fondamental étant son libre-arbitre à préserver. Si, comme l’a dit Brice Parain, « les mots sont des pistolets chargés », c’est avec d’autres mots, au sens propre du terme, qu’on leur répond : pas avec les Tribunaux et les Prisons. Du moins, si l’on ambitionne de créer un milieu socioculturel humain et riche de tous les talents et de tous les génies. Ou de promouvoir une opinion publique avertie, la liberté pour la vérité d’apparaître supposant une égale liberté pour le mensonge, et donc le débat contradictoire entre les tenants de l’une et de l’autre. Mais en tétanisant le cerveau, en empêchant de penser, la peur pour ce qui est rend la classe dominante incapable de conquérir et d’établir son hégémonie sur la Totalité sociale, et la dispose, en conséquence, seulement à user et abuser de la répression.
Je vois dans la sortie de l’écrivain Patrice Nganang l’expression bruyante d’une révolte diffuse et muette, rarement, c’est bien connu, un écrivain parlant pour lui seul, son rôle, sans s’y réduire, consistant souvent à prêter sa plume aux malheurs du Tout-venant, à sa protestation contre un donné mal vécu. Les Japonais disent : « Quand le doigt montre la lune, l’imbécile regarde le doigt ». L’affaire Patrice Nganang, avec les outrances des uns et des autres, est le révélateur de notre déficit collectif en matière de Tolérance comprise comme modalité de gestion du Désaccord. En lieu et place de la censure portée par d’expéditives et sempiternelles mesures politico-administratives et judiciaires, d’ailleurs invariablement vouées à l’inefficience, malgré l’abus du bâillon dont le recours repose sur l’arrière-pensée que le réel serait et ne serait que ce qui se dit : le silence supprimerait la réalité qui n’existerait qu’autant qu’on en parle. Mais le musèlement, même et surtout subrepticement justifié par des lettrés de haute volée, est signe de la psychasthénie d’une classe dominante qui peine à établir son hégémonie politico-idéologique sur la Totalité sociale.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
CAN 2025 LE GABON PERD SA DEUXIEME RENCONTRE DE LA COMPETITION
ZAMBO ANGUISSA RETOURNERA UN JOUR DANS LES LIONS INDOMPTABLES
L'aéroport, miroir d'une crise migratoire et d'un racket institutionnalisé
Paul Atanga Nji défend le bilan de Paul Biya et menace les critiques
Paul Biya et le Pape Léon XIV : une visite historique pour la diplomatie du Cameroun
POINT DE VUE :: les + lus





Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 105991
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 220548

Vidéo de la semaine
évènement