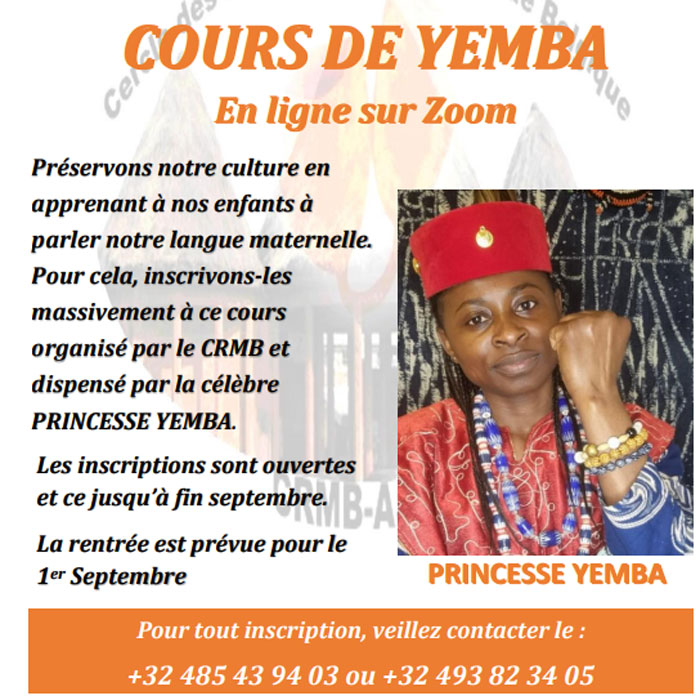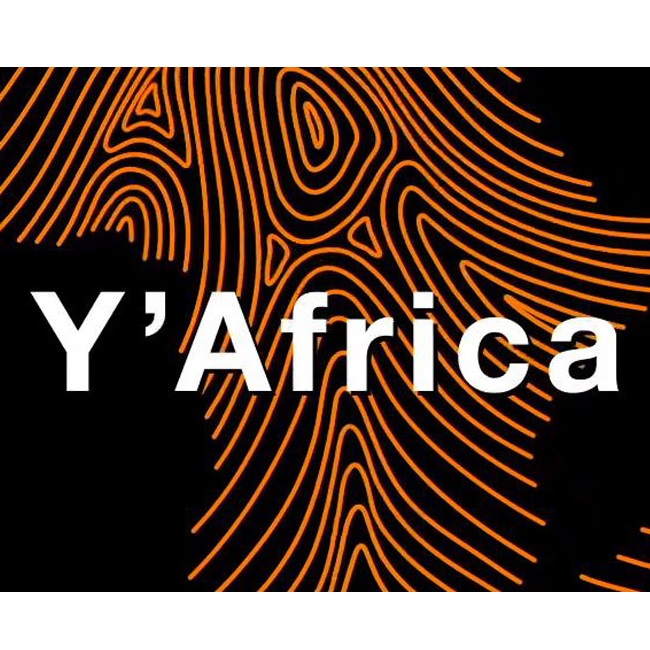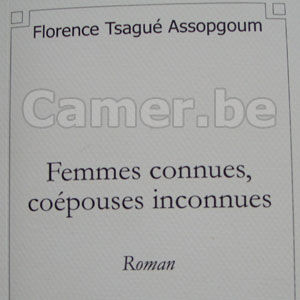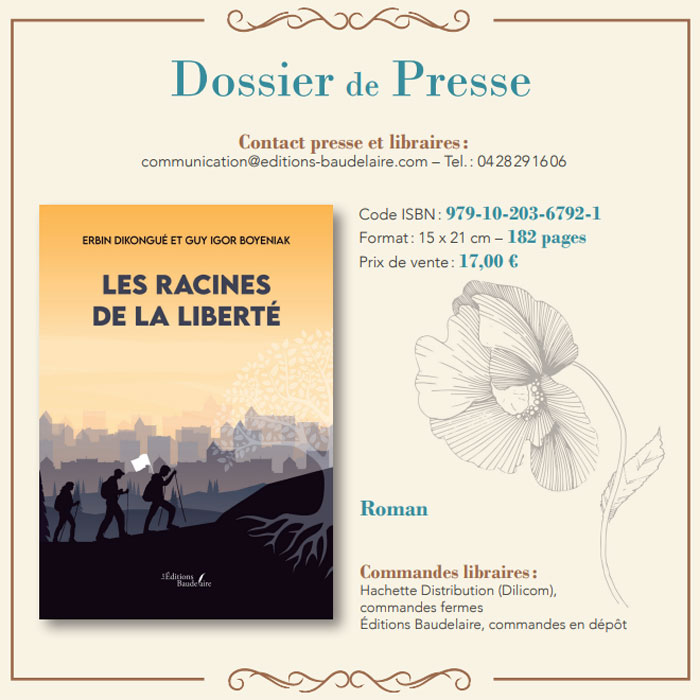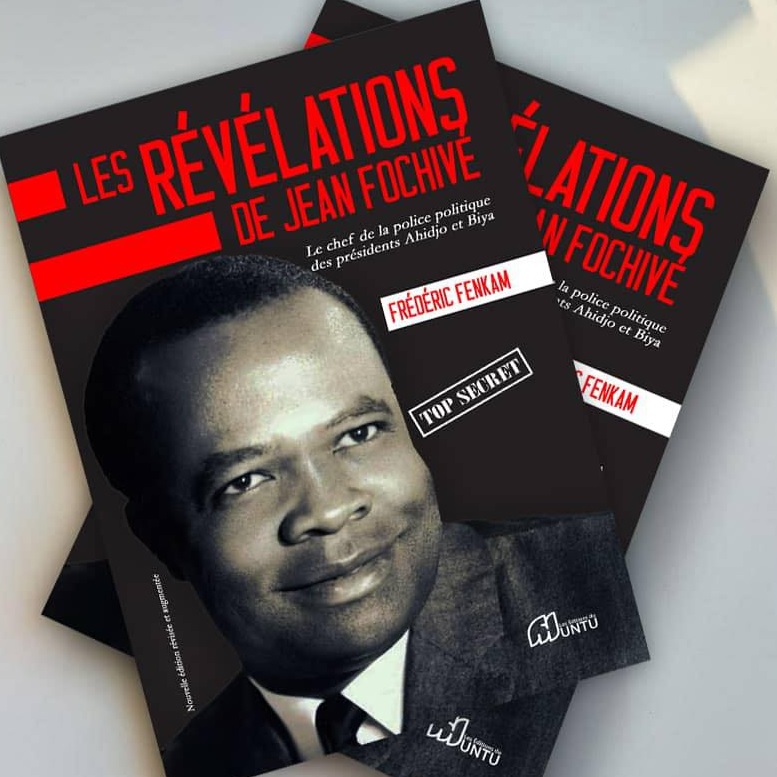-
© Camer.be : Avec L'auteur
- 31 Dec 2017 13:41:53
- |
- 7385
- |
Cameroun, Cadeau de fin d'année et de nouvel an, Vient de paraître: « Le retour de l'Allemagne » de Enoh Meyomesse :: CAMEROON
Lorsqu’en 1938 Adolf Hitler initie l’Anschluss, à savoir sa politique de rattachement de tous les peuples allemands, les Camerounais, qui estiment en faire partie, se mettent à rêver d’un retour de leur pays sous protectorat de Berlin, et n’attendent plus que le jour imminent où cela va se produire.
Dans le même temps, entre les colons allemands demeurés dans le pays et les Français, la tension devient vive…
Ce roman revient sur cette page ignorée de la rivalité franco-allemande au Cameroun.
……………………..
I
Nous sommes au mois de janvier 1938 au Kamerun.
Ernst Hillgruber tenait un magasin non loin du centre-ville à Misositown, en plein quartier des Européens. A la devanture de celui-ci, flottait majestueusement de manière provocante, un grand drapeau aux trois bandes horizontales, noire, rouge et jaune. C’était le drapeau de l’Allemagne, jusqu’en 1934. Tout Français qui venait à passer par-là et apercevait celui-ci, l’abreuvait copieusement à voix basse d’injures. Ernst Hillgruber le savait, mais n’en avait cure. Ou plutôt, en jubilait. Il ne se cachait pas pour dire que les Français, un jour ou l’autre, seront jetés hors de ce territoire que Dieu a confié à l’Allemagne. Il était probablement l’Allemand le plus influent de tout Misositown et des environs. Il regroupait régulièrement ses compatriotes dans son domicile situé à l’arrière de sa boutique, pour faire la fête. On les entendait alors chanter, pratiquement en beuglant, des chants de chez eux, après avoir ingurgité des litres et des litres de bières. Il ne s’adressait aux indigènes d’un certain âge qu’en allemand. Ce n’est que lorsque l’un d’eux ne pouvait lui répondre en cette langue, signe qu’il ne l’avait pas apprise à l’école ou qu’il était en train de l’oublier faute de la pratiquer, qu’il enchaînait en Français. Naturellement, il faisait exprès de parler un mauvais français, manière pour lui de manifester son profond mépris et dégoût pour cette langue.
Il faisait partie des ressortissants allemands qui avaient quitté le Kamerun à la suite de l’invasion franco-britannique de 19-14 à 1916.
Il était revenu après la décision des traités de Versailles ayant décidé qu’en dépit de l’installation d’administration française et britannique sur ce territoire à la place de celle allemande, celui-ci n’allait pas passer sous le contrôle de la France, mais, plutôt de la Société des Nations, SDN, l’organisation destinée à préserver la paix, que le Président Wilson des Etats-Unis, avait fait créer. En clair, le Kamerun, qui cessait d’être un protectorat allemand, était devenu un territoire international. A ce titre, toutes les nations européennes pouvaient y faire vivre leurs ressortissants. De nombreux colons allemands étaient revenus, et avaient repris leurs activités d’avant, leurs magasins, leurs plantations, leurs églises, etc.
L’administration coloniale française était totalement impuissante face à ceux-ci. Elle ne pouvait les expulser.
II
Ejenguélé, le cœur battant, avait franchi la porte du magasin d’Ernst Hillgruber, après avoir contemplé un moment cet impressionnant drapeau qui flottait au vent. Comme à son habitude, Ernst Hillgruber, assis derrière son comptoir, avait levé les yeux et le visage, arrêté ce qu’il était en train de faire, l’avait dévisagé pour deviner son âge afin de savoir s’il pouvait s’adresser à lui en allemand ou pas. Mais, Ejenguélé n’avait que la trentaine. Il était donc impossible qu’il eut fréquenté de manière suffisante, au cas où il l’aurait fait, l’école allemande pour être en mesure de soutenir une conversation en allemand. Ernst s’adressa donc à lui dans son français exprès de mauvaise qualité.
— Bonjour jeune homme, que dé-sires-tu ?
Il vendait de tout dans son magasin. C’était un bazar. Il l’avait dénommé : « Bazar de Berlin » en français, « Berliner kaufhof » en allemand, les deux dénominations étant écrites l’une en-dessous de l’autre, naturellement celle en allemand figurant au-dessus, et étant plus grosse, par conséquent, plus voyante.
Le regard d’Ejenguélé s’était posé sur une photo géante d’un homme au regard sévère, à la mèche de cheveux rebelles barrant son front, et à la moustache taillée en long sous les narines, qui ornait le mur du fond du magasin. De part et d’autre de la photo pendaient deux grands drapeaux rouges avec au milieu d’un cercle blanc, une croix d’un type singulier. Ernst s’était aperçu qu’Ejenguélé était impressionné par ce qu’il voyait. Il s’était alors levé, s’était tourné, s’était avancé vers la photo, avait levé le bras droit en avant, avait claqué les talons et s’était écrié d’une voix forte : « Heil Hitler ! ».
Puis, avait baissé le bras et s’était de nouveau retourné, en souriant, vers Ejenguélé, encore plus impressionné.
— C’est le Fürher, notre guide, le guide du peuple allemand. C’est Adolf Hitler, l’homme que le ciel a dépêché sur terre pour venger l’Allemagne du diktat de 1919 à Versailles. C’est lui qui, dans bientôt, ne manquera pas de bouter les Français hors de ce territoire. (Se ravisant). Mais, jeune homme, tu n’as pas répondu à ma question, que désires-tu ?
— Euh…euh… je viens de la part de Dikongué Milton Théodore…
— Oh ! Mein Gott ! Herr Dikongué est un type chic. Il fait partie de mes amis.
Ernst avait pris Ejenguélé par le bras et l’avait entraîné au fond du magasin.
………………………….
Après avoir mangé, Ernst avait amené Ejenguélé dans la salle de séjour et lui avait offert de s’asseoir dans le canapé face à lui. Puis, il avait servi un digestif. Il avait ouvert une bouteille de Pedro Domec, une marque de whisky fort prisée à Misositown, et en avait rempli deux verres entiers à Ejenguélé.
Au moment de se séparer, il lui avait offert plusieurs portraits, en format réduit, de l’hom-me dont la photographie géante trônait insolemment sur le mur de son magasin, Adolf Hitler, et lui avait dit, en lui serrant vigoureusement la main, sur le trottoir, et à très haute voix pour bien se faire entendre de loin :
— Junger Mann, va distribuer ça à tes amis, et en garde un pour toi. Cet homme représente l’avenir du Kamerun. Reviens me voir quand tu veux, ma porte t’est ouverte.
Puis, il avait de nouveau claqué des talons, avait levé le bras droit face au drapeau qui flottait devant son magasin, et avait aboyé : « Heil Hitler ! »
…………….
IV
(…)
— Ce sont les Amerloks qui ont occasionné cette pagaille. Wilson, leur président, avait émis l’idée ô combien saugrenue pendant la conférence de la paix à Versailles en 1919, de priver la France de ces territoires qu’elle avait conquis de haute lutte en les soustrayant à la servitude allemande. Il avait imposé son concept totalement débile de « sécurité collective ». Pour cela, il fallait créer une organisation en charge de celle-ci, on peut le comprendre, mais également, malheureusement, de nos territoires nouvellement conquis. Le nôtre, ici, est ainsi passé sous le contrôle de ce qu’il avait dénommé « League of nations », en français « Société des Nations », en abrégé SDN. Moi je l’ai toujours dit et le soutiendrai toujours, ce Wilson est un allié objectif des Schleus. Nous, Français, nous conquérons un territoire
des mains de Allemands, mais lui l’Amerlok, il nous oblige à accepter que les Bosch continuent à vivre tranquillement ici, comme si de rien n’était. Et voilà, ils se livrent actuellement à de la subversion, revigorés par l’accession au pouvoir chez eux du plus grand démagogue de tous les temps, Adolf Hitler. Ils excitent les Noirs contre nous. Ils les poussent à la rébellion, que dis-je à la révolte.
………………….
IX
La fête avait duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, environ 22 heures. Les indigènes y étaient restés à une heure aussi tardive, à savoir après 18 heures, en plein quartier européen, parce qu’ils estimaient qu’ils étaient les invités d’un Blanc. Cela était suffisant pour leur permettre de transgresser la loi. Autrement, ils auraient quitté les lieux à temps, c’est-à-dire avant 18 heures.
Finalement, ils s’étaient mis, un à un, à s’en aller, chacun en remerciant profondément et sincèrement Ernst et son épouse pour l’honneur qu’ils leur avaient fait de les inviter à leur domicile, eux de misérables individus qui ne pénétraient jamais dans les maisons des Européens, certains passant même des mois sans mettre les pieds au quartier blanc de la ville. En s’éloignant, le même commentaire revenait, ainsi en pidgin, la langue la plus parlée par eux, systématiquement sur leurs lèvres : « white man pass white man, dan white man no like frenchmen ».
Mais, au bout de la rue, et sans qu’ils ne le sachent, les attendait une fort désagréable surprise : « sans pitié » et sa milice étaient planqués dans le noir. Impossible de les apercevoir de loin à cause de l’obscurité. En avançant, de robustes bras, surgis du néant, se saisissaient aussitôt de chacun d’eux. Toute résistance était vaine. Chalandois en personne supervisait les arrestations.
—Alors, on oublie la loi, hein ? Parce que l’on va boire chez les Bosch ? Hein ? A terre !
Il raclait rageusement d’un coup de pied le malheureux qui se retrouvait, sans rien y comprendre, étalé au sol. Celui-ci dessaoulait immédiatement.
Par bonheur, un des invités d’Ernst, en se renversant au sol, était parvenu à donner à haute voix l’alerte à ses congénères qui sortaient encore de chez Ernst pour rentrer chez eux. « Sans pitié arrête les Noirs !» La nouvelle avait sonné tel un coup de tonnerre dans les oreilles des Allemands, et plus particulièrement celles d’Ernst. Celui-ci était entré d’un pas colérique dans sa chambre à coucher, et en était ressorti, aussitôt après, en bousculant tout le monde, avec une carabine en mains, tout en aboyant en allemand : « je vais tuer ce Français, je vais tuer ce Français, je vais tuer ce Français ». Puis il avait armé son fusil, était sorti dans la rue, avait tiré deux coups de feu en l’air dans le noir, tout en continuant à aboyer : « je vais tuer ce
Français, je vais tuer ce Français, je vais tuer ce Français ». Les détonations dans la nuit avaient produit un bruit terrible et dont l’écho était parti se perdre au loin. Il s’était mis à avancer en direction du bout de la rue, là où se trouvait Chalandois.
— Halte ! avait crié celui-ci, à sa vue. Je dis halte !
Ernst n’avait voulu rien entendre, il avait de nouveau armé sa carabine et avait encore, au hasard, tiré un coup dans le noir, en direction de la voix. Par bonheur, Chalandois l’ayant vu dans la pénombre, grâce à la lumière qui sortait de sa maison, armer son fusil, s’était, en un geste désespéré, jeté au sol, et le coup était passé au-dessus de sa tête. Il s’était aussitôt relevé, avait bondi sur lui et s’était saisi de sa carabine. Une terrible bagarre s’était alors déclenchée entre Ernst et lui. Pendant celle-ci, partaient encore des coups de feu. Les Noirs que Chalandois avaient arrêtés, et qui étaient as-sis à même le sol, n’avaient plus demandé leur reste. Ils s’étaient tous évanouis à toutes jambes dans la nuit. Les autres Allemands avaient accouru et non sans mal et sans risque, avaient entrepris, d’arracher le fusil des robustes mains d’Ernst et de séparer la terrible bagarre, aidés à cela par les miliciens de Chalandois.
……………………….
XVIII
Dès le 5 septembre 1939 au soir, soit le lendemain de la diffusion de la nouvelle de l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne, par radio France à Brazzaville, les Allemands de Misositown et des environs, avaient tenu une grande assise au domicile de Ernst Hillgruber. Pendant de longues heures, ils avaient analysé la situation, et étaient arrivés à la conclusion qu’il leur revenait de quitter au plus vite le territoire, et de se réfugier tout d’abord en Guinée Espagnole, avant de regagner éventuellement leur pays, ou alors choisir une autre destination, par exemple l’Afrique du Sud. Sandot, le délégué du haut-commissariat à Misositown pour sa part, leur avait tout juste accordé 72 heures pour quitter les lieux. Le 7 septembre 1939 à minuit, il ne devait par conséquent plus y avoir l’ombre d’un Allemand à Misositown et ses environs faute de quoi celui-ci serait arrêté et jeté en prison en qualité de prisonnier de guerre.
En vérité, l’administration coloniale française était soulagée par cette déclaration de guerre du 3 septembre 1939, car elle lui permettait d’expulser enfin du territoire une communauté blanche fortement non désirée : les Allemands.
En partant, ils n’ont plus emmené avec eux une forte colonie d’indigènes, ainsi qu’en 1916, ils l’avaient fait …
www.amazon.fr, taper le titre du livre, ou Enoh Meyomesse.
Lire aussi dans la rubrique LIVRES
Les + récents
Influence des Épouses Présidentielles au Gabon : Zita et Anouchka Avome
Président CAF sur Affaire Trucages Matchs : « Personne au-dessus de la Loi »
Affaire Martinez Zogo Club: Une liste de témoins explosive attendue au tribunal
Atanga Nji octroie illégalement un récépissé au PCRN de Robert Kona : une reconnaissance frauduleuse
Contrat de travail de Marc Brys: Issa Tchiroma Bakary met la pression sur Narcisse Moelle Kombi
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 162219

Vidéo de la semaine
évènement