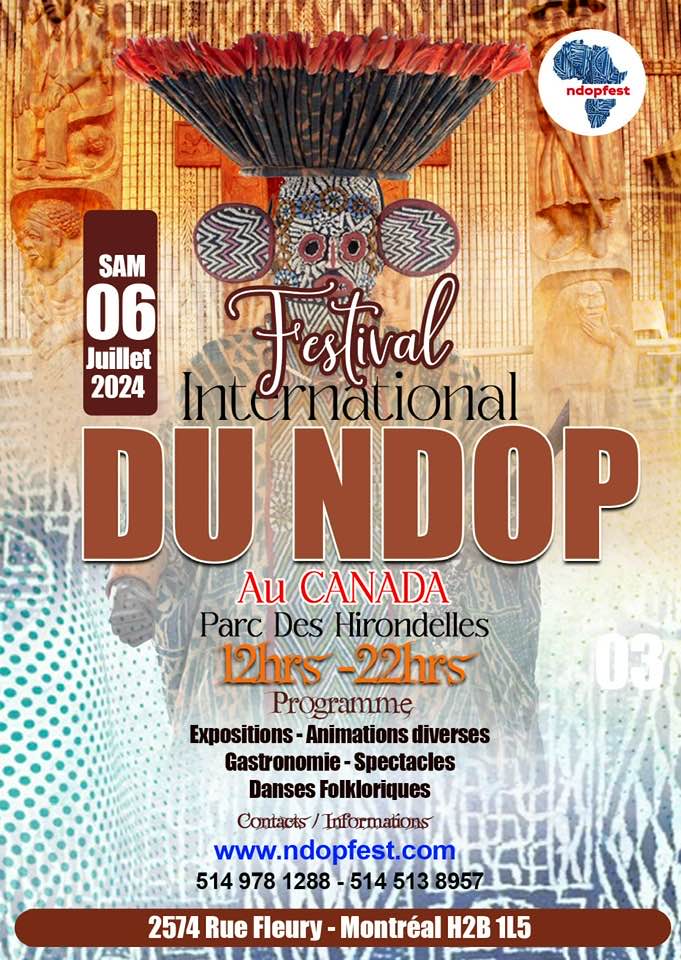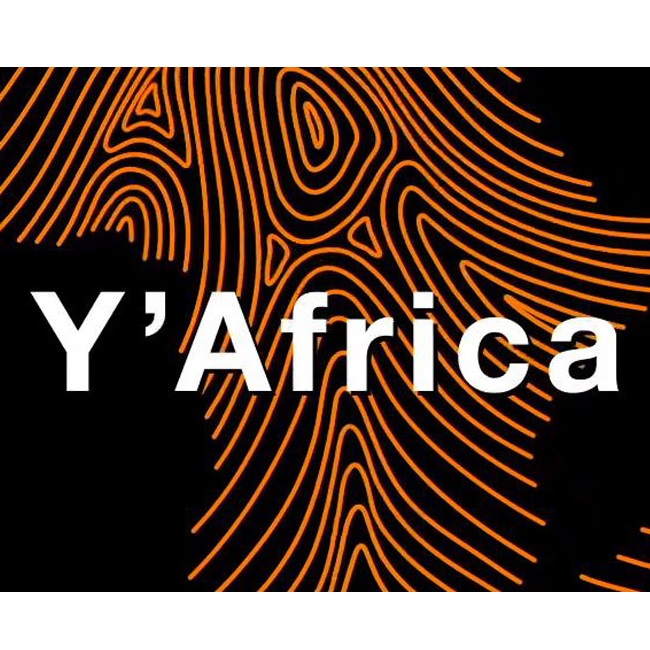-
© Correspondance : Guillaume-Henri NGNEPI, Philosophe
- 18 Sep 2017 13:57:33
- |
- 4221
- |
Cameroun :SORTIR DE L’IMPASSE :: CAMEROON
Si fort hier, du temps des Um, pourquoi notre parti se trouve-t-il, à ce jour, si faible ? Non certes dominant mais assurément hégémonique hier, il ne l’est plus aujourd’hui : il a perdu jusqu’à l’attrait qu’il exerçait, hier, sur le monde intellectuel et sur les jeunes ; ainsi, de force politique efficiente et novatrice, il semble être devenu une simple et plutôt quelconque attitude politique.
L’explication décisive d’un tel ravalement est, certes, à chercher dans les infrastructures économiques et sociales. Mais sans doute aussi dans la quasi extinction de notre propagande politico-idéologique : loin d’impulser les évènements, ou même d’en assigner, voire régenter la signification comme hier, le parti semble, à ce jour, ne pouvoir guère faire mieux qu’y réagir, donnant de la sorte l’impression, peut-être fausse, de prendre pour acquis les thématiques, problématiques et idéologèmes dominants qui pourtant, pour l’essentiel, heurtent l’esprit même de son credo de toujours.
A défaut de restaurer son aura d’antan, il s’agit, aujourd’hui, de rendre à nouveau le parti maître de sa stratégie et des expressions tactiques qui peuvent en être données au quotidien. Mieux, il s’agit, consécutivement, d’influer sur les idées, de sorte à impulser, au-delà du mouvement des idées, celui des opinions et des esprits, dont il est possible d’escompter une influence consécutive sur le mouvement des institutions.
Que pourrait donc bien être, avantageusement, notre ligne de conduite générale sur les plans politico-idéologique, électif et social ? Répondre à cette question c’est, en un certain sens, souligner, de manière cursive, ce qui, faisant notre spécificité, nous démarque du tout-venant sur l’échiquier politique.
I- Sens efficient d’une politique frontiste actuelle
Jusqu’à présent la politique frontiste est l’axe de la stratégie du parti, la colonne vertébrale de sa ligne de conduite générale. Il en va ainsi parce que nous sommes encore à l’ère des fronts. Ceux dont il s’agit dans l’histoire pratique ne sont pas des agrégats de tribus et/ou de personnalités. Ce sont des alliances passées entre des classes sociales, c'est-à-dire des groupes sociaux différant par leur insertion socio-économique, leurs intérêts et aspirations, leur représentation du monde, leur projet englobant la Totalité sociale.
Historiquement, le front-uni est la résultante d’une situation dans laquelle différentes classes sont affrontées à un identique problème qu’aucune d’elle ne peut, toute seule, résoudre à la satisfaction de toutes. La mutualisation de leurs forces devient alors nécessaire. Elle prend fin au terme de la solution dudit problème. Un front qui n’a pu s’acquitter de sa tâche disparaît et fait place à un autre si dure l’ère des fronts.
Hier, c’est un front qui a conduit à l’unification et à l’indépendance. Cette tâche politique reste inachevée en ce sens que la conquête d’hier concerne le droit dont l’exercice effectif est la tâche de l’heure : là où chacun parle de néo-colonialisme, la véritable indépendance demeure encore un objectif à atteindre. Aussi l’inachèvement de la tâche politique des Um nous fait-elle obligation de la poursuivre jusqu’à son terme.
Mais quel peut bien être le point commun des classes ou fractions de classes à regrouper dans les fronts actuels ? Si hier c’était, pour les Um, l’unification, l’indépendance et l’essor socio-économique des déshérités, ce tryptique à l’inachèvement signalé demande à être autrement poursuivi.
Or, un front se construit sur la base d’une alliance dont la politique a pour axe les intérêts et les aspirations de la classe dont la conscience est la moins élevée. Ce niveau le plus bas de la conscience politique est aujourd’hui l’aspiration à la démocratie, ce qui, en termes pratiques renvoie à l’exigence de l’exercice effectif d’un droit autre dont la qualité nouvelle se reconnaît à la promotion du citoyen. C'est-à-dire à l’émergence de l’individu qui n’est plus simplement séparé du groupe du fait de l’économie monétaire et de l’instruction acquise à l’école de type occidental, mais du fait même du droit qui le pose comme parcelle de souveraineté. C'est-à-dire comme disposant non seulement de son libre-arbitre mais encore et surtout du pouvoir de prendre part à la marche des affaires publiques. Certes en choisissant le personnel politique au moyen des élections, ou en se faisant élire comme tel. Mais, surtout en définissant, auparavant, la politique dont il exige l’application, son assise sociale, son orientation, son contenu, ses bénéficiaires, sa vision de l’avenir commun. Ainsi saisi comme parcelle de souveraineté le citoyen est, en conséquence, la limite opposée à l’expansion débridée du pouvoir d’État compris comme raison d’Etat. Il est, de la sorte, la forme aboutie de la démocratie.
Mais celle-ci, qu’est-elle au juste ? Elle n’est surtout pas, comme certains1 le prétendent, et l’exigent même, une rotation ethnique du pouvoir politique, ni une répartition tribale de tous les pouvoirs, chaque tribu devant en détenir sa parcelle, ni même un gouvernement dit d’ « Union nationale », d’ailleurs invariablement entendu comme agrégat de tribus différentes autour d’un homme dit « fort », détenant un pouvoir dit « fort » lui aussi, renouvelable par intégration graduelle de ceux qui sont dits les « cadets sociaux », parcimonieusement cooptés au sein de ceux qui se donnent pour des « élites » et des « leaders ».
La démocratie est, n’est que, et ne peut être que l’expression d’un rapport entre Pouvoir, Droit et Force. Ainsi n’y a-t-il pas de démocratie si le pouvoir repose sur la force. En revanche, il y en a quand il se fonde sur le droit, mais à deux conditions : il faut d’abord que ce droit reflète les intérêts, les aspirations que véhiculent les idées, l’opinion de la majorité des citoyens ; il faut en outre que les idées, l’opinion traduisant les intérêts et les aspirations de la minorité soient autorisées à s’exprimer en toute liberté, libre expression du fait de laquelle elles pourraient, le cas échéant, devenir l’expression de la majorité du lendemain. La force, dès lors, ne sert qu’à protéger cette relation entre pouvoir et droit.
Au-delà cependant de cette exigence démocratique qui interpelle des fragments de classes diverses, il ya l’exigence de la suppression des inégalités injustes, l’exigence de la conciliation entre l’essor économique et cette suppression des inégalités injustes. Elle ne saurait s’effectuer automatiquement. Elle suppose, en conséquence, une qualité nouvelle et autre de la conscience politique qui ne réclame plus simplement ce que presque tout le monde veut, mais exige ce qui est favorable, en priorité, à une classe déterminée, et en l’occurrence la classe la plus déshéritée, dominée, exploitée, opprimée, réprimée. L’on n’accède pas à cette conscience politique nouvelle simplement par bonté d’âme : seulement pour s’être avisé de ce que l’unique moyen de mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme, c’est de mettre fin à l’exploitation du travail des classes les plus basses sur l’échelle des rémunérations.
Ainsi, par sa politique frontiste, le parti entend contribuer à produire effectivement, véritablement le citoyen. Et après coup, il entend se mettre au service d’une cause encore plus noble, celle de la production de la justice en faveur du citoyen le plus déshérité. Mais pourquoi ? Parce que la liberté et le pouvoir du citoyen n’ont de sens et d’efficience pratique qu’une fois dotés d’un contenu socio-économique, fruit de la justice distributive. C’est là une tâche dans laquelle les Um voyaient l’élévation du standard de vie des populations. Ce qui n’est possible aujourd’hui qu’en ayant bien à l’esprit l’idée que les populations dont il s’agit ne sont pas un agrégat de tribus et de personnalités, mais un peuple au sens où ce mot désigne des personnes ayant en commun un destin, et désireuses, chacune, de le transformer en un commun dessein fait de souveraineté. Cette idée du peuple était déjà celle des Um qui n’ont appelé le parti union des « populations » qu’en raison du contexte colonialiste qui ne reconnaissait d’ailleurs dans les colonisés qu’un agrégat d’habitants dénommés des « peuplades », avec un bien pesant import péjoratif. Le vocable « populations » était, dès lors, un compromis lexical dénotant l’idée d’habitants ou de peuplement, sans connoter celle, péjorative, de ‘’peuplades’’ renvoyant à une entité dans laquelle l’on ne voit pas un corps politique, et se refuse, en tout cas, à en admettre un.
II Quel droit pour quelle société aujourd’hui ?
Réaliser la démocratie aujourd’hui c’est transformer le contenu du droit, en le faisant passer du droit à privilèges en vigueur, à un droit égalitaire pour tous. Cette conversion est, au plan politico-idéologique, ce qui distingue les partisans de l’exercice effectif de la démocratie, des tenants d’un processus indéfini dit de démocratisation qui, toujours, s’invente un peuple immature, et se découvre la mission de le guider lentement, fort lentement, vers l’horizon sans cesse fuyant d’une improbable démocratie.
Le droit à privilèges a pour éléments distinctifs toutes les références à l’ethnicité comme légitimation du droit à l’instruction, à la formation, à l’emploi, et à l’occupation du sol. C’est la colonne vertébrale de l’ordre existant, la clé de voûte du système sur lequel repose le régime que certains visent, certes, à changer, du moins le disent-ils, mais en gardant, peu ou prou, la constitution, c’est-à-dire l’essentiel du droit dominant, et, bien sûr, les rapports sociaux foncièrement inégalitaires qui le sous-tendent.
Le droit à privilèges ne traite pas l’individu comme personne et comme citoyen : seulement comme membre d’une tribu, et d’une seule, celle du père, scotomisant du même coup celle de la mère, et méconnaissant, par le fait même, les brassages interethniques, les métissages, au profit d’on ne sait quelle pureté génétique. Il pose qu’entre tribus différentes, il n’est rien de commun, pas même un commun destin, ni à plus forte raison la possibilité de le convertir en un commun dessein.
En conséquence, le droit à privilèges n’unit pas, il sépare. Cette séparation a pour effets l’extinction quasi inexorable du sentiment national, l’essor consécutif des identitarismes au référentiel ethnique, et le repli communautariste tendanciel. Tout cela donne de la Totalité sociale l’image bien connue mais fausse d’un agrégat de tribus dont l’affrontement serait à la merci d’un rien, à moins qu’elles ne se rassemblent, contraintes, dans le giron de quelque homme « fort ».
La pseudo solution proposée par le pouvoir en place, mais aussi par une frange pourtant éclairée, paraît-il , de son opposition, c’est la démocratie qu’un Thierry Michalon dit « consociative », qu’un Basile Louka appelle « de concordance », et dont les traits caractéristiques sont : la rotation ethnique du pouvoir d’Etat ; le partage ethnique des pouvoirs ; la représentation ethnique de la Totalité sociale à l’Assemblée, au Sénat, à la Mairie ; les quotas ethniques dans les concours et les emplois ; le rejet du principe de la majorité en fait de démocratie au motif que venant à se dégager, une telle majorité serait démographique et ethnique, qu’elle permettrait de gagner une élection mais pas de gouverner au lendemain de la victoire ; et qu’il faudrait, en conséquence, lui préférer la pratique invariable du gouvernement dit « d’union nationale » rassemblant sous la férule d’un homme « fort » l’hétérogénéité ethnique réputée belligène, sans expliquer par quel miracle l’homme dit « fort » échappe au bellicisme présumé atavique des tribus. Mais à quoi bon des élections invariablement onéreuses, s’il faut, le lendemain, battre le rappel de tout le monde, gagnant et perdant, pour participer au même pouvoir d’Etat ? A quoi bon, si ce n’est parce que mis d’emblée au service de la manducation, le pouvoir est appréhendé comme d’office désorbité de tout idéal et de tout projet d’intérêt public, ayant pour enjeu explicite le destin commun saisi comme ordonné à quelque dessein commun ?
Toujours est-il que c’est cet échafaudage politicien qui est censé générer ce qu’on appelle, fort improprement à dire vrai, « l’équilibre ethnique, régional, etc. », sans préciser ce qu’on veut « équilibrer », ni seulement déjà le sens de ce mot et du projet qu’on lui fait porter. Que veut-on et que peut-on équilibrer en effet : la production ? La distribution ? Mais surtout que vaut-il mieux équilibrer, à supposer qu’on entende par ce mot l’éviction du trop et du trop peu, au profit du plus et du moins ? Et en quel domaine procéder : celui de la production, au risque de plomber les ailes du génie créateur des gens en nivelant par le bas les possibilités de tous ? Ou celui de la distribution, au risque de créer, artificieusement, sans nécessité, une catégorie sociale vivant au crochet de l’autre, vouée, elle, à se tuer à la tâche, comme c’est déjà le cas là où se trouve surexploité le travail des paysans pauvres, des ouvriers et autres producteurs mal récompensés de leurs efforts ?
Toutefois, que d’une tribu à l’autre se déplore invariablement, sous forme de mémorandum, les mêmes déficits en infrastructures comme en services divers, signifie qu’au fond, la tribu n’a rien à y voir et qu’il s’agit des tares inhérentes à un système sociopolitique impropre à l’organisation efficiente et satisfaisante pour les démunis, de la protection sociale collective. Cela dit, si à l’évidence, une tribu donnée accuse du déficit en matière d’instruction, de formation, d’emploi, ou en quelque autre domaine, il suffit d’une politique incitative, d’ailleurs limitée dans le temps, pour y remédier, et non pas d’une doctrine anthropologique et sociale, ou plutôt ethnologique, vouée à quelque application permanente, et qui consiste, en fait, mine de rien, à somatiser, biologiser le culturel, le psychique, l’intelligence, la compétence, le mérite, mesurés à l’aune de l’extraction tribale.
Aussi s’agit-il, pour le parti, non pas de « consolider » les institutions existantes comme cela est, parfois, recommandé de divers côtés, et pas non plus de les réformer superficiellement, mais de les transformer en profondeur. Le droit égalitaire pour tous est, au plan strictement politique, la voie royale de cette transformation. C’est aussi l’unique voie de la résolution des questions occultées par le droit à privilèges qu’il faut détruire. Voici lesdites questions :
1. Il y a d’abord, comme on l’a montré, la question de la démocratie qui désigne un pouvoir fondé non pas sur la force, mais sur un droit dégagé à la majorité d’opinion, et faisant droit à l’expression libre d’une minorité d’opinion susceptible de devenir la majorité du lendemain.
2. Vient ensuite la question de l’égalité et de la justice qui se pose ainsi : si le juste n’est pas le simplement et strictement égal mais le proportionnellement égal, à quoi mesurer cette proportion ?
Au parti nous répondons : pas à la naissance ni à l’extraction familiale, ethnique et sociale ; pas à la fortune non plus ; ni à l’héritage et au legs ; ni même au degré d’instruction et au parchemin consécutif : seulement à l’aune du principe de l’utilité publique ou encore, de l’utilité commune, qui désigne ce que l’on fait de bien et de profitable à la totalité sociale, à la communauté nationale, à la patrie, à la communauté continentale, à l’humanité : il n’y a pas de mérite à naître, hériter, posséder. Seulement, en revanche, à créer, et à mettre sa création au service de la Totalité sociale, ce qui exprime bien le principe d’utilité publique, ou d’utilité commune comme disaient les révolutionnaires français de 1789.
Ainsi, les différences de statuts et de privilèges doivent se mesurer à l’aune de l’utilité commune. Pour être tenues pour justes, les inégalités, non pas de nature mais de droit, celles qui sont instituées par le droit, dans le droit, doivent être ouvertes à tous, selon d’identiques modalités, à la faveur d’une réelle égalité de chance.
3. Autre question occultée par le droit à privilèges, celle du pouvoir dont le fond du problème ne concerne pas tant la modalité de sa dévolution que sa nature, son essence : il ne s’agit pas de savoir qui est habilité à le détenir, individu ou tribu, qu’importe. Mais plutôt que faut-il qu’en soient le socle, l’assise sociale, la fonction sociale, l’orientation et surtout les limites à ne pas enfreindre. Le problème est donc le suivant, comme l’enseignait déjà Ruben Um Nyobé, en juin 1957, enseignement qui n’a pris nulle ride à ce jour : quel pouvoir, pour quoi faire, au profit de qui, et quel contre-pouvoir pour le contenir et l’empêcher de dégénérer en dictature, despotisme, autocratie ? Préoccupation cardinale de Ruben, la qualité du pouvoir, plutôt que son exercice à tout prix demeure, pour nous, aujourd’hui encore, l’objet d’une quête essentielle : contre les autocratismes, despotismes, totalitarismes, dictatures de toutes sortes, nous avons à penser le pouvoir, notamment le pouvoir d’Etat, puis à déterminer le profil qu’il requiert, avant de chercher les hommes convenant à l’emploi. Esquisser la démarche inverse, c’est reproduire le mal du pouvoir contre lequel Um nous a mis en garde depuis 1957 lorsqu’il s’interrogeait et demandait si l’Assemblée Territoriale où certains le pressaient d’occuper un strapontin, au motif du reste louable d’une « détente politique et morale », était habilitée à décider du destin des kamerunais. On n’a plus cure, aujourd’hui, de ce genre de scrupule et de souci, on aime mieux travestir en finesse tactique de haute volée son incapacité de cracher dans la soupe, et son appétit plantureux pour les menues gratifications du pouvoir à tout prix, qui ne représente nulle menace pour les intérêts et aspirations de ceux qui, depuis toujours, dominent, exploitent, oppriment et répriment, avec un succès sans cesse croissant.
Démocratique, le pouvoir d’Etat est forcément limité par et dans le droit ; et devenu citoyen, l’individu est, comme personne, la limite à l’expansion échevelée du pouvoir, parce qu’il est alors une parcelle de souveraineté.
4. Il y a enfin la question foncière, saisie à travers le prisme du sang et de l’argent, du moins, aujourd’hui où, coincée entre le Capital et le droit du sang, elle fait les délices du plus offrant, et par suite des seuls possédants. Et se trouve, de la sorte, vouée à une forme insidieuse d’apatridie, l’immense majorité des déshérités. Comment mettre fin à cette situation ?
A la terre, il faut ôter son caractère marchand actuel. En substituant, au droit de propriété, le droit de jouissance. En faisant valoir le droit du sol, en lieu et place du droit du sang. Ce qui suppose que les chefferies, royautés, sultanats et lamidats deviennent des communes au pouvoir, non plus dynastique mais électif, où l’on accède, non plus parce que ‘’né de…’’, mais plutôt parce que ‘’élu de…’’.
III- Elections : comment en gagner vraiment ?
Battre électoralement un adversaire, c’est d’abord tâcher de faire le plein des voix de ses propres partisans à soi. Mais, personne, jamais ne gagne avec les seules voix de ses partisans. Il faudrait donc réussir à rogner les voix adverses, et engranger celles des hésitants. Mais comment ? En formant un projet assez ouvert pour contenir, au-delà de ses propres intérêts et aspirations, une partie de ceux de l’adversaire et des hésitants.
Se concilier ainsi des voix adverses ne relève pas d’une question de dominance, ni de force et de contrainte : seulement d’hégémonie. Qu’est-ce à dire ? Elle consiste à obtenir une conduite déterminée sans recourir à la contrainte, et seulement à la persuasion, à la séduction, en somme par l’appel aussi bien à la raison qu’au sentiment. Ce qui suppose qu’on apporte au problème du devenir de la Totalité sociale la solution la moins critiquable possible, la plus juste et la plus praticable possible, et qu’on la formule de telle sorte qu’au-delà de ses propres partisans, d’autres concitoyens puissent y reconnaître leurs propres intérêts et aspirations non encore advenus au jour clair de leur conscience, et lumineusement anticipés et articulés dans le projet qui leur est présenté.
L’hégémonie venant à se réaliser, ferait basculer l’opinion publique des conceptions propres au pouvoir d’Etat à d’autres, nouvelles, qui ne les contestent pas seulement, mais les dépassent, à la satisfaction de la majorité de nos concitoyens, du point de vue de la qualité et de l’utilité commune.
Il y faudrait un ensemble cohérent d’idées propres à devenir l’objet d’une croyance, et d’une croyance commune, vouée à remplacer, en divers domaines, les croyances diffusées à partir des cercles de pouvoir, du haut de l’Etat, quand et parce que critiquées, celles-ci perdent de leur valeur d’usage et deviennent incrédibles, obsolètes, et désormais hors d’usage.
L’hégémonie n’est nullement, contrairement à un préjugé répandu, une question ethno-démographique, une question de nombre : cette représentation erronée procède de ce qu’un paradigme a pu, dès longtemps, dès les premiers moments de l’ethnologie colonialiste, nous être inculqué dans la saisie de nous-mêmes, le paradigme des entités ethniques, tribales que nous constituerions, et qui symbolise ce qu’on a accoutumé d’appeler notre exceptionnalisme du fait duquel les concepts en usage ailleurs (ceux de classes sociales en lutte) pour se rendre le monde intelligible manqueraient de pertinence une fois appliqués à nos sociétés, et l’on devrait les remplacer par d’autres, spécifiquement africains. C’est ce paradigme reçu sans critique qui empêche de dissocier l’hégémonie de l’ethnicité, de la démographie, du nombre et de la penser seulement comme une question de qualité, d’ustensilité de la croyance, et comme une question de congruence entre cette croyance et le réel.
Il est nécessaire de conquérir l’hégémonie politico-idéologique antérieurement aux élections et à la prise effective du pouvoir d’Etat : c’est à ce moment- là qu’on examine à loisir le passé, interroge le présent, sonde l’avenir, et fournit à l’électorat les raisons, bonnes ou mauvaises, c’est selon, de se déterminer en vue de la poursuite ou de l’interruption d’une politique donnée.
Pour devenir hégémonique, point n’est nécessaire qu’une idée soit vraie. Cette proposition est choquante sans doute. Mais elle fait bien voir que l’hégémonie s’établit au travers de la propagande et de la campagne de presse, qui, en elles-mêmes, ne sont pas conditionnées par des valeurs telles que la justesse, la vérité, la véracité, etc. Mais, naturellement, il vaut mieux, au parti, et pour les classes laborieuses qui nous intéressent, que l’hégémonie à conquérir repose en même temps sur le juste, le vrai, le bien, le beau, le digne plutôt que l’inverse : c’est que nous avons, comme peuple trop souvent martyrisé, grand besoin de « la paix des cœurs » comme disait Um qui l’appelait de ses vœux et de ses actions ; or, porteuse de la paix sociale qui est à distinguer du simple calme social2, cette ‘’paix des cœurs’’ ne s’accommode pas de l’opacité dans les rapports sociaux, et nécessite, en conséquence, la transparence qui repose sur les valeurs de vérité et de justice, à tout le moins. L’hégémonie cependant doit nécessairement emprunter le canal de l’agitation, de la propagande et de la campagne de presse. Pour saisir la justesse et la profondeur de ce propos, il n’est que de songer aux nombreux mensonges dont les médias, capitalistes pour la plupart, nous arrosent, et qu’ils nous font avaler, à force de nous les corner au quotidien, en l’absence de tout démenti, et même de toute possibilité instantanée de démenti, ce qui montre bien que répété sans contredit le mensonge passe pour vrai, du moins un certain temps : les armes de destructions massives prêtées à Saddam Hussein et à l’Irak naguère ? Du vent. Mais on ne le sait qu’après-coup. Kadhafi, dictateur impénitent et odieux ? Qui peut y croire vraiment maintenant que son pays, prospère sous lui hier, est retourné à l’ère des hordes sanguinaires ?
On peut donc dire que pour nous autres, au parti, conquérir l’hégémonie, c’est faire campagne sur le nécessaire passage du droit à privilèges au droit égalitaire pour tous. Une telle thématique, et surtout le projet qu’elle enveloppe, sont insatisfaisants, subjectivement, pour quelques uns, mais subjectivement et objectivement satisfaisants pour l’immense majorité de nos concitoyens. Et cela seul suffit à en indiquer l’utilité publique, la valeur commune pour tous, en termes de valeur d’usage.
Conclusion
Pour que le parti redevienne maître de sa stratégie et des diverses expressions tactiques de celles-ci, il lui faut, à nouveau, reconquérir son hégémonie politico-idéologique sur la société kamerunaise. Définie, ou plutôt redéfinie en 1974, sa stratégie est ternaire :
1. Promouvoir un courant d’opinion ;
2. Assurer sa transcroissance en mouvement autonome des masses ;
3. Puis, en mouvement révolutionnaire des masses lié à lui, disons, si possible, puisque nous ne sommes plus seuls dans la lutte, comme ce fut hier, et longtemps, le cas.
C’est principalement au niveau de la promotion du courant d’opinion que doit se ressentir l’hégémonie du parti. Il nous faut penser les problèmes essentiels de la Totalité sociale en leur donnant une telle expression que le reste de la société, en dehors de nos rangs, se sente comme obligé d’en référer à elle chaque fois qu’il lui arrive de penser ses propres problèmes singuliers. C’est ce que Ruben Um Nyobé et ses camarades ont fait, hier, avec le prodigieux tryptique de l’Unification, de l’Indépendance, et de l’essor du niveau de vie des masses populaires.
Aujourd’hui nous avons à mener à bonne fin ce travail commencé par nos prédécesseurs. L’Unification, après Um, a été ordonnée aux intérêts du capital extérieur quand, pour faire main basse sur le pétrole situé en zone dite anglophone, le capitalisme français s’est mis à l’abri de la concurrence du mastodonte anglo-saxon, en bricolant, à la hâte, l’Etat ‘’unitaire’’ de 1972, mettant fin à un fédéralisme à deux Etats, qui n’était pas déjà gratifiant pour le bas peuple. Et cela s’est fait avec la complicité de la petite bourgeoisie nationale, des deux langues officielles, toutes tribus confondues. Et le problème que cela soulève serait, selon certains, celui de la forme de l’Etat qui, disent-ils, devrait être fédérale, le nombre d’Etats fédérés restant à être déterminé, moyennant débat ; et là-dessus, les supputations et propositions vont de deux à dix, ce chiffre-là renvoyant à la partition antérieure fondée sur les langues officielles, l’anglais et le français, et ce chiffre-ci recoupant les régions administratives de notre pays.
Pour nous autres, au parti, et cela depuis Um, l’essentiel n’est pas la forme mais la nature de l’Etat. Quelle différence ? La forme désigne son aspect extérieur, le mode singulier selon lequel il est organisé, et qui peut, le cas échéant, aisément, être sujet à variation. La nature ou l’essence renvoie à la qualité intrinsèque, à ce qui fait que cet Etat-ci est ce qu’il est, et non pas autre chose : son assise sociale, son orientation politico-idéologique, son fondement socio-économique, les bénéficiaires fondamentaux de ses décisions et de ses actes.
Ainsi entendue, cette nature se détermine par rapport au droit et à la force d’une part, mais aussi et surtout, par rapport au capital extérieur, aux oligarchies aujourd’hui militaro industrielles et politico financières qui entendent faire la pluie et le beau temps sur la planète, en contrôlant ses ressources minières, où qu’elles se trouvent, et pour cela même, les Etats sur les territoires desquels elles se trouvent. Le problème, dès lors, est moins de multiplier, sous forme d’entités étatiques distinctes, des potentats dont chacun sera, en soi-même, fragile à souhait, que de réaliser, dans l’esprit de Ruben Um Nyobé, un Etat unitaire effectivement et véritablement démocratique et décentralisé politiquement, économiquement, financièrement, militairement même et culturellement.
Certes, tout Etat, quelle qu’en soit la forme, unitaire ou fédérale, peut aujourd’hui éclater sous les assauts de l’impérialisme. Mais le fédéral plus que tout autre : la première clause du fédéralisme stipule que tout Etat fédéré peut, à sa guise, prendre sa liberté et ses distances par rapport à la fédération, à tout moment. Ce qui peut d’autant se produire que l’impérialisme, lui, sait où trouver les minerais, et donc où séparer, diviser et recomposer le monde à sa guise, réaménager les rapports de forces internationaux, géostratégiques, selon ses appétits, ses intérêts, ses aspirations et les nécessités du marché mondial.
Sans qu’il préserve de tout nouveau partage du monde, ni de toute division suscitée par des intérêts et aspirations exogènes, ni même simplement de toute vulnérabilité éventuelle, l’Etat unitaire et largement décentralisé fait obligation, à ses citoyennes et citoyens, de tenir ensemble, en se pensant comme soumis à un même destin à convertir en un commun dessein. Sans que ce soit le retour au parti unique, ni à la pensée unique : le pluralisme ne se décrète pas, il est toujours déjà inhérent aux peuples comme aux cultures.
Bon ailleurs sans doute, l’Etat là-bas n’étant pas soumis aux assauts de l’impérialisme, puisqu’impérialiste lui-même en général, le fédéralisme, chez-nous, sous nos climats, le paraît d’autant moins qu’on nous propose çà et là une forme de fédéralisme marqué du sceau de ce qu’on tient pour un exceptionnalisme africain : le fédéralisme ethnolinguistique dans lequel, chez-nous par exemple, l’anglophonie passe aisément pour une variété d’ethnie à côté de la francophonie qui en serait une autre, quand à dire vrai, l’une et l’autre ne sont guère que les vestiges de deux impérialismes concurrents dans nos pays d’Afrique. Sans compter que, pour être une belle chimère, l’idée d’une confédération d’ethnies n’en séduit pas moins certains esprits, qui en forment le projet, le recommandent chaudement, puis mollement, sous la pression des événements. La confédération des ethnies est en effet une forme d’Etat effectivement proposée par Thierry Michalon dans son livre « Quel Etat pour l’Afrique ? » qui, soit dit en passant, fait des adeptes enclins au psittacisme dans l’intelligentsia de nos pays. En tout cas, l’idée d’entités ethniques étatiques est bien, toute proportion gardée, une sorte de couronnement logique des doctrines du partage ethnique du pouvoir, c’en est la consécration que seuls quelques-uns poussent la hardiesse jusqu’à la théoriser. On l’a fait pour le Soudan du Sud devenu, comme on le voulait, un Etat ethnique, ou racial ‘’homogène’’, à population noire. Fort bien. On n’y redoute pas moins à présent un génocide ! Preuve que ce qui divise, ce n’est pas la tribu, l’ethnie, la race, mais les intérêts exogènes défendus becs et ongles, inconsidérément, par la bourgeoisie nationale qui trouve son propre compte dans la dépendance, parfois, faute de disposer de sa propre expertise, souvent, et par suite obligée, de toujours en appeler à celle du Capital international qui ne peut que lui marchander sa technicité à prix d’or : au Soudan du Sud, le caractère ethnique de l’Etat s’accommode sans peine de la surexploitation des minerais que l’Etat n’a pas le moyen d’arrêter, du moment que l’accapare une guerre dite ‘’civile’’, ‘’locale’’, expressément allumée pour l’occuper, à toutes fins utiles.
Par conséquent, question pratique ardue s’il en fût : comment mettre sur pied cet échafaudage politicien de la confédération des ethnies ? Comment assigner un terroir à chaque tribu, dans un monde où l’expansion du Capital, qui s’exige sans limite aucune, et sans régulation autre que celle du seul marché, les velléités des Etats en ce domaine étant combattues et brocardées, comment donc, dans ce monde où le mouvement des capitaux provoque ceux des hommes, engendrant des migrations à l’échelle planétaire, comment prescrire aux hommes, chez nous, d’apprendre à ne vivre qu’entre gens de la même tribu, comment vraiment ?
Il faut, pour cela, avoir dès longtemps, posé que le monde tel qu’il est fait est bien fait, qu’il n’est ni à faire ni à refaire et qu’il n’ y a qu’à conformer sa volonté à son ordre tel que le veulent et l’exigent les puissants qui le tiennent drastiquement, ce qui ne les empêche d’ailleurs nullement de pérorer sur la démocratie à perte d’haleine, et d’en faire l’alibi de la destruction des Etats et des pouvoirs récalcitrants, dont l’exercice gêne, tant soit peu, la recomposition en cours du monde, et par suite, le réaménagement des rapports de force internationaux.
Mais ce monde ainsi déjà fait, et où il ne s’agit plus que de ‘’bien’’ gouverner, en préservant les intérêts du Capital surtout, ce monde-là n’est pas le nôtre. Le nôtre, il nous revient de le bâtir, non pas pour le peuple, mais avec le menu peuple des paysans pauvres, des ouvriers, des chômeurs des bidonvilles, des jeunes diplômés sans emploi, des employés de toutes sortes, des petits entrepreneurs étouffés par les appétits plantureux des riches propriétaires, etc. Bâtir selon les préceptes de Ruben Um Nyobé, en commençant par gagner à ce projet les esprits et les cœurs, à ce jour confrontés au dilemme suivant : la créativité endogène ou le nouveau péril collectif, l’esclavage du XXIè S étant fondamentalement celui du cerveau, comme on n’en disconvient plus en Occident, depuis les écrits édifiants d’Alvin Toffler sur
Les Nouveaux Pouvoirs.
Aujourd’hui qu’à droite on promeut des slogans à succès destinés à empêcher de penser plus avant, en profondeur, des slogans qu’on tient d’ailleurs des oligarchies externes, politico-financières et militaro-industrielles, des slogans comme « bonne gouvernance », « émergence », « alternance », nous avons, nous, peuple de gauche africaine, à mobiliser l’opinion autour des alternatives, c'est-à-dire des possibles autres, qui n’enveloppent pas seulement le changement de personnel politique mais induisent le changement même de la politique poursuivie. Qui ne plombent pas les initiatives de notre peuple, mais en stimulent la créativité.
De ces alternatives, il faut commencer par élaborer le concept. C’est la démarche préjudicielle, préparatoire au succès, même en matière d’élection quand celle-ci viendrait à être transparente, juste, équitable : c’est dans ce débat liminaire que s’élabore le monde autre entendu et visé comme projet et programme, l’élection proprement dite se bornant à modifier, le cas échéant, le personnel politique. Une tâche est d’abord définie, le profil de son exécutant dressé ensuite, avant que ne soit enfin choisie la personne préposée à son exécution. L’élection représente l’étape ultime de cette démarche ternaire : elle est un couronnement, pas un commencement.
Aussi coure-t-on au fiasco électoral en faisant l’économie de la théorie : c’est qu’au fond le terrain électoral est un vaste champ d’idées, de projets, de possibles, d’alternatives, où normalement, l’on ne récolte pas ce qu’on n’a pas eu la patience de semer.
Certes, une rumeur rampante, aussi pense-petit que crétine, fait croire et répéter niaisement que le monde étant devenu « unipolaire », il n’y aurait plus besoin de nul débat d’idées dans ce « village planétaire » où désormais, tout le monde ne pourrait se consacrer qu’à la promotion dévote du capitalisme.
Là-contre, il faut observer que l’expansion du capitalisme génère l’expansion consécutive de la lutte des classes, et sa dissimulation dans les replis des prétendus conflits de génération et de tribus autant que dans les migrations incompressibles à travers le monde.
La répression continue, la loi scélérate induisant un contrôle étatique subreptice de la scène politique, les procès en chaîne, sont autant de facteurs ayant affecté le parti et généré en son sein des désaccords mal gérés, implosifs, et finalement des démembrements périodiques, sorte de scissiparité indéfinie.
Il faut aujourd’hui assumer de façon critique cette douloureuse expérience de lutte en tâchant de la rendre féconde, riche en enseignements pour le parti et la classe sociale que nous entendons représenter, et dont nous nous efforçons de défendre les intérêts et de porter les aspirations, la classe des travailleurs.
La principale leçon à en tirer est qu’il faut encourager l’expression du désaccord et tirer parti des contradictions et des différences pour asseoir notre lutte sur le socle de la tolérance. D’autant qu’une situation absolument non conflictuelle est une vue de l’esprit. Il est sans doute bon de la rechercher. Mais il est mieux encore de savoir qu’elle n’existe pas, et que le mal n’est pas dans le désaccord : seulement dans la gestion qu’on peut en avoir : calamiteuse ou féconde. Aussi, plutôt que la division cellulaire permanente, peut-être gagnerions-nous à admettre et tolérer en notre sein l’expression de courants dont il faut cependant réguler le fonctionnement par quelques exigences simples dont je me borne à suggérer une seule, l’attachement aux « principes marxistes vérifiés » comme disait Ruben Um Nyobè.
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
La justice ordonne l'expulsion immédiate du port de Douala des immeubles de l'ex- Onpc
ENQUETE: DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INNOVATION EN AFRIQUE
Zoom sur les technologies de l’énergie solaire thermique
Y’Africa, le magazine TV des talents africains : Orange annonce une troisième saison ...
Crise au PCRN: Robert Kona Affiche Son Soutien au RDPC
POINT DE VUE :: les + lus





Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 100520
LE DéBAT




Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 162219

Vidéo de la semaine
évènement